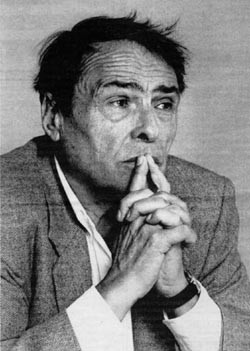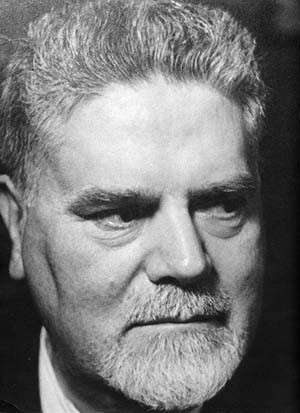vendredi, 27 novembre 2009
Panajotis Kondylis: Pouvoir et décision
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Panajotis Kondylis: Pouvoir et décision
Les livres les plus intéressants de Panajotis Kondylis, décédé en juillet dernier, sont: Geschichte des Konservativismus, Theorie des Krieges, Der Niedergang der bürgerlichen Lebensform et Macht und Entscheidung (= Histoire du conservatisme, Théorie de la guerre, Le déclin de la forme vitale bourgeoise et Pouvoir et décision). Dans Pouvoir et décision, Kondylis plaide pour une forme de la pensée qui a été copieusement décriée au cours des dernières décennies, et qui est le fondement de la démarche philosophique de Carl Schmitt. Kondylis justifie l’option de Schmitt en défendant le décisionnisme, tombé dans le discrédit depuis que les penseurs “héroïques” de la “révolution conservatrice” s’en sont emparé. Dans son ouvrage sur la décision, Kondylis démontre, appuyé sur ses innombrables connaissances, que toutes nos identités collectives et individuelles, y compris leurs expressions philosophiques ou rationnelles les plus élevées, reposent sur un fondement inaliénable qui est toujours une décision initiale, irrationnelle en dernière instance, révélant un rapport ami/ennemi.
Les idées sont dès lors des armes, qui servent l’objectif biologique de la lutte pour la survie ou pour l’accroissement de ses propres forces. La croissance et l’augmentation volontaire de ses potentialités dépendent étroitement, en fin de compte, de l’impératif de survie, auquel on ne peut se soustraire. Justement, c’est dans les périodes de crise que les individualités et les collectivités reviennent aux racines de leur propre identité, pour se renforcer et maintenir leurs forces. De ce fait, dans la formation des systèmes de pensée identitaires, la logique est un moyen parmi d’autres moyens, mais auquel on peut finalement renoncer.
Dans les systèmes théologiques, les principes de l’homme-créé-àl’image-de-Dieu et la faillibilité humaine constituent des contradictions sur le plan logique; de même, dans l’anthropologie de l’émancipation (Aufklärung), on trouve une contradiction: l’homme est une fraction de la nature, et, en même temps, les normes culturelles conditionnent le libre exercice de la volonté. Mais ces contradictions s’évanouissent dès qu’on les considèrent comme l’expression d’une volonté de pouvoir légitime. Les idées et les formes du savoir ne cherchent pas à “reflèter” la réalité: elles sont bien plutôt des constructions et des interprétations qui servent d’armes dans la confrontation ami/ennemi.
Comme Odo Marquard l’a remarqué: vouloir exprimer des vérités éternelles soustraites au temps est l’illusion majeure de la classe bourgeoise, qui pense qu’elle est au-dessus de toutes les autres classes. Les mythes, les religions et les idéologies sont donc des décisions au niveau de la Weltanschauung, qui assurent la permanence et la stabilité des identités. Souvent, la situation historique fait qu’il devient nécessaire de faire subir aux identités des mutations complètes, parce que la communauté politique ou nationale doit survivre. Le maintien de l’identité est un impératif existentiel que l’on ne peut toutefois pas détacher des circonstances spatio-temporelles. Même si l’identité est une fiction, elle demeure un impératif inaliénable. Si une individualité se rencontrait elle-même en temps que personne, mais dans un état antérieur à celui qu’elle revêt aujourd’hui, elle ne s’identifierait pas nécessairement à elle.
Holger von DOBENECK.
(article paru dans Junge Freiheit, n°34/1998; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, pouvoir, décision |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 novembre 2009
Le rapport politique-ésotérisme: entretien avec le Prof. G. Galli
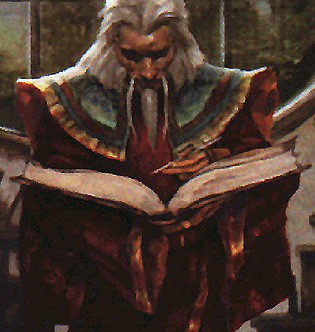 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Le rapport politique-ésotérisme
Entretien avec le prof. Giorgio Galli
Pendant de nombreux siècles, les rois, les empereurs, les hommes politiques, toujours isolés de leurs contemporains, ont demandé les conseils de “mages”, d'astrologues, de voyants, d'alchimistes, avant de prendre des décisions importantes. Ces curieux conseillers étaient toujours présents, plus ou moins officiellement, dans l'orbite des hommes qui les consultaient fidèlement. La révolution scientifique nous a fait croire que le mystérieux filon occulte qui s'insère entre la politique et les pratiques ésotériques s'était dilué et avait disparu. Mieux vaut être prudent avant de l'affirmer péremptoirement! Même à notre époque pleinement sécularisée, marquée par un grand scepticisme, par l'athéisme généralisé, on peut repérer les liens obscurs unissant de mystérieuses congrégations aux hommes du pouvoir.
Giogio Galli, professeur d'histoire des doctrines politiques à l'Université de Milan, s'est préoccupé de ces thématiques, en écrivant des livres qui ont suscité la curiosité, l'intérêt mais aussi causé une certaine inquiétude. Nous lui avons demandé de nous expliquer dans quelle mesure l'ésotérisme influence les lieux du pouvoir dans le monde occidental, au seuil du troisième millénaire.
GG: «Les rapports entre l'ésotérisme et la politique n'ont plus de nos jours la continuité qu'ils avaient dans les temps passés, mais le phénomène n'est pas pour autant épuisé depuis l'avènement de la révolution scientifique. Il est moins apparent, mais il est néanmoins présent. En notre siècle qui s'achève, à côté des idéologies de masse qui ont favorisé l'avènement de l'homme nouveau, dominateur de la technique et de la science, forgé dans l'acier des fabriques et prêt à se jeter dans les tempêtes d'acier comme l'a décrit Ernst Jünger, nous voyons réémerger des cultures anciennes qui, bientôt, influeront les événements historiques. De la mystérieuse figure de Raspoutine installée à la cour des Tsars aux voyants consultés par Hitler pendant la guerre, on constate que les hommes à la tête de la politique mondiale contemporaine ont consulté des astrologues connus: autant de phénomènes qui contredisent l'apparent cynisme de notre société contemporaine et démontrent que l'homme, même s'il est puissant, a besoin de croire en quelque chose».
Q: Depuis plusieurs années, vous avez étudié les rapports entre la culture politique et les anciennes cultures ésotériques. En lisant vos livres consacrés à cette thématique, comme Hitler e il nazismo magico, La politica e i maghi, Alba magica, des pans obscurs des époques historiques récentes se révèlent et j'ai noté que l'ésotérisme en politique intéresse davantage la droite que la gauche. Comment cela se fait-il?
GG: «Je crois plutôt que la présence de l'occultisme est transversale et se retrouve dans tous les camps politiques, même si divers penseurs auxquels la droite extrême fait constamment référence, comme Julius Evola ou Ernst Jünger, ou l'entourage des SS de Himmler, ou les savants nationaux-socialistes qui se préoccupaient du Graal, se sont profondément intéressés aux arts ésotériques. Les écrivains Pauwels et Bergier, auteurs d'un livre devenu rapidement très célèbre, Le matin des magiciens, ont donné une définition lapidaire du national-socialisme: «C'est Guénon plus les Panzerdivisionen». René Guénon fut un grand connaisseur des cultes traditionnels pré-chrétiens et est devenu une sorte de “phare illuminant” pour certains cercles de la droite dure en Europe. Ces phénomènes idéologico-politiques nous amènent à constater ce que vous venez d'évoquer dans votre question: l'ésotérisme semble être un engouement des droites dures, mais, à l'analyse, on doit constater qu'il est présent dans toute la sphère politique et n'est nullement un apanage exclusif des droites. La recherche de l'irrationnel est profondément ancrée dans l'âme humaine. La science ne peut pas expliquer aux hommes pourquoi ils sont nés, pourquoi ils tombent amoureux, pourquoi ils meurent, etc.».
Q.: D'aucuns prétendent que lorsque l'on ne croit plus en Dieu, on croit en tout le reste...
GG: «Nous nous trouvons face à une grande crise des religions institutionalisées de modèle occidental. Le christianisme s'est transformé, alors que le mystère nous accompagne tout au long de notre vie. Le sacré connait une éclipse, aussi parce que l'Eglise catholique ne réussit plus à donner une réponse convaincante aux questions que les hommes lui posent. L'illusion des Lumièresa réduit les mystères de l'univers, ce qui s'est avéré une erreur. En outre, dans le monde entier, on assiste à un retour aux peurs ataviques de la fin des temps, parce que nous approchons le passage d'un millénaire à un autre. Toutes ces situations sont le terrain de culture de doctrines plus ou moins ésotériques, présentes en filigrane dans la société moderne: de l'homéopathie au New Age, de la prolifération des cartomanciennes aux prédicateurs itinérants. Ce vaste champ, qui a été jusqu'ici ignoré des historiens et des sociologues, pourrait être défini comme celui de la “fantapolitologie”: il pourrait révéler des indices intéressants sur la société actuelle. C'est pour cette raison que j'étudie le phénomène avec une attention soutenue».
Q.: Les symboles utilisés par les mouvements politiques peuvent avoir une signification dépassant le message politique proprement dit et renouer avec des mythes très anciens. Que pensez-vous de la récupération par la Lega Nord de Bossi des traditions celtiques et lombardes-germaniques? Et du symbole de la Padanie, le “Soleil des Alpes”?
GG: «Il me semble que la Ligue, qui existe depuis bientôt quinze ans, a connu des évolutions diverses. Le concept de Padanie est très récent et s'est imposé dans une phase de l'évolution du mouvement, où l'aspect symbolique est devenu plus important, où l'on assiste à la réémergence graduelle de cultures alternatives, y compris dans le champ politique. Aujourd'hui, la Ligue cherche à créer une identité padanienne, mais qui ne pourra pas se profiler sur une base seulement économique, religieuse ou linguistique, vu que la Padanie n'est pas l'Ecosse. D'où le projet de fonder cette identité sur un symbole fort. Indubitablement, la symbolique padanienne semble jouir d'un certain succès: la couleur (le vert) et le symbole (le Soleil des Alpes) sont immédiatement et clairement perceptibles. Evidemment, nous ne sommes pas en mesure de jauger de l'efficacité d'un tel message à court terme. Je ne crois pas que la référence à la culture celtique soit adaptée à la Padanie actuelle. Les Celtes possédaient une vision du sacré fortement liée à la nature. Les prêtresses druidiques y jouaient un rôle important. Les croyances celtiques n'ont rien de commun avec la culture des habitants de la Padanie en 1997».
Q.: De quoi parlera votre prochain livre?
GG: «Il traitera d'un aspect social particulier de l'Italie contemporaine. Je vais me référer au premier livre que j'ai écrit et j'intitulerai mon nouvel ouvrage Italia e meriggio dei maghi (= L'Italie et le midi des mages). Je parlerai des innombrables personnes qui se sont rapprochées des cultures restées jusqu'ici marginales dans la société post-industrielle. Je vais démontrer que ces personnes n'ont pas choisi cette voie parce qu'elles se défient de la science, ou qu'elles ne l'ont pas empruntée uniquement en raison d'une telle méfiance. En Italie, un quart de la population se tourne désormais vers la médecine alternative, croit aux horoscopes, visite les cartomanciennes ou se rapproche des philosophies orientales. L'Italie est en train de changer, sous bon nombre d'aspects».
(propos recueillis par Gianluca Savoini, parus dans La Padania, 22 oct. 1997; trad. frtanç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ésotérisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, histoire, traditions, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 18 novembre 2009
Elk volk zijn socialisme!
 Elk volk zijn socialisme!
Elk volk zijn socialisme!
Opmerkelijk is dat een aantal mensen uit de rechtse traditionele Vlaamse Beweging (voor zover daar nog “bewogen” wordt) plots het solidarisme herontdekt hebben, en daarbij menen te kunnen stellen dat het N-SA ten onrechte van de term “solidarisme” gebruik maakt. Ik verwijs hierbij naar een artikel van de hand van Stijn Calle dat verscheen bij het internetmagazine ‘Bitterlemon’. Omdat hierbij op een aantal vlakken nogal kort door de bocht werd gegaan, dit artikel als antwoord.
Ten eerste meent de heer Calle het verzamelbegrip “solidarisme” te moeten definiëren. Goed, en ook nodig, maar wat ons betreft kan de verscheidenheid binnen wie en wat zich doorheen de tijden als solidaristisch bestempelde niet zomaar plotsklaps ingeperkt worden tot de eigen visie. Solidarisme is en blijft een verzamelbegrip. De Fransman Léon Bourgeois, de christendemocraat Leo Tindemans, Verdinaso-leider Joris van Severen… noemden zich allen ooit “solidarist”. Hun mening(en), visies en initiatieven kunnen onmogelijk los gezien worden van het tijdskader en de maatschappelijke omstandigheden, en wijken vaak sterk onderling af en dus ook van wat vandaag het N-SA zegt of doet. Om maar te stellen hoe uiteenlopend de invullingen van dat solidarisme kunnen zijn. Niemand die dat betwist, maar toch meent de heer Calle dat hij bijvoorbeeld de Franse vrijmetselaar Léon Bourgeois kan verbannen uit het solidaristische kamp, omdat Calle aan het solidarisme een uitdrukkelijke Rooms-katholieke spirituele basis toekent. Het is juist dat de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in de ontwikkeling van haar sociale maatschappelijke leer in zeer belangrijke mate heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van diverse solidaristische stromingen (cfr. Pesch, Rerum Novarum,…). Net omwille van die grote verscheidenheid binnen “het solidarisme” en het feit dat wij deze niet willen inperken door eenzijdige definities, heeft het N-SA destijds de benaming van het “nieuw-solidarisme” aangenomen.
Maar in zijn definiëringsijver gaat de heer Calle nog wat verder en stelt dat het solidarisme een “concretisering van wat gemeenschappelijk in tijd en ruimte de derde weg wordt genoemd”. Die “Derde Weg” is een al even problematisch verzamelbegrip als politiek “links” en “rechts” of zoals “het solidarisme” zelf. Die Derde Weg betekent in de eerste plaats afstand nemen van het politieke en maatschappelijke bestel dat door de heersende ideologie wordt gevormd met haar politiek-filosofisch centrum, linker- en rechterzijde. En dat doet Calle niet, integendeel hij wenst er een uitdrukkelijk rechtse (“radicaal rechts”) invulling aan te geven. Dat “het solidarisme” tot nog toe steeds leefde bij mensen en groepen die als “rechts” te catalogeren zijn, verandert niets aan het feit dat die Derde Weg de facto betekent dat er kruisverbanden worden gelegd uit diverse filosofische, wetenschappelijke, politieke… richtingen. Het N-SA bekent zich tot die Derde Weg, en neemt bijgevolg dus afstand van wat gemeenzaam “extreem-rechts” of eufemistisch door henzelf als“radicaal rechts” wordt omschreven. Net omdat het om een nieuw project voor een nieuwe tijd gaat, die op zowat alle vlakken lijnrecht ingaat tegen de heersende ideologie en haar politieke, maatschappelijke en institutionele systeem. Die Derde Weg betekent afstand nemen van het (conservatieve) status quo of van reactionair gedachtegoed. We raken hier onmiddellijk aan de kwestie van het nationaal-revolutionaire denken, waarover verder meer.
Een gebrek aan die eerdergenoemde spirituele basis van het solidarisme wordt het N-SA verweten, en daarmee zijn we bij het tweede punt van kritiek aanbeland. Onterecht, maar allicht heeft de heer Calle hier zijn mening gevormd op basis van wat op het debat van 3 oktober werd besproken, en waar die spirituele basis nauwelijks of niet aan bod kwam. Kern van zijn betoog is dat het solidarisme een beroep doet op een spiritualistische inhoud en zich daarmee onderscheid van zowel liberalisme als socialisme. Dat is juist en N-SA erkent dit ook, voor zover met dit socialisme de marxistische varianten bedoeld worden! Calle situeert die spirituele basis echter – in tegenstelling tot het N-SA - uitdrukkelijk en exclusief binnen het katholieke geloof. Dit anno 2009 doen, betekent zo veel als het organiseren van de begrafenis van het solidarisme. Immers de sociale leer van de RKK en de geloofsmatige basis daarvan, kan niet los gezien worden van het instituut die de Kerk op zich is. De Kerk socialiseert nauwelijks nog, haar macht en invloed bij de brede bevolking krimpt, nog slechts een kleine minderheid van Vlamingen is overtuigd katholiek gelovig en leeft ook volgens haar geloof, een grote maar slinkende groep Vlamingen bewijst er nog latent lippendienst aan. Bovendien wordt die grotendeels inhoudelijk gelijklopende spirituele basis evengoed geboden door andere filosofische overtuigingen, die soms diametraal tegenover het katholicisme staan. Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de Franse Nouvelle Droite rond Alain de Benoist met haar Manifest voor Europees Herstel en Vernieuwing dat aan de vooravond van de eeuwwisseling werd gepubliceerd.
In Vlaamse conservatief-katholieke en andere Vlaamsgezinde kringen die zich bij tijd en wijlen op solidarisme beroepen, is het echter al decennia lang (ongeveer sinds eind de jaren ’70 van vorige eeuw) oorverdovend stil aangaande theorievorming en concrete stellingname inzake solidarisme. Is het intellectuele luiheid en/of desinteresse? In elk geval is het claimen van of het ontzeggen aan anderen van “het solidarisme” vanuit die hoek dan ook op z’n zachtst gezegd potsierlijk te noemen. Het heeft er ook toe geleid dat – zeker op partijpolitiek vlak – conservatieve liberalen en zelfs neoliberalen de kaas van tussen het solidaristische brood namen. Wat men nog onder solidarisme kan verstaan bij de overblijvers, is niets meer dan een vorm van liefdadigheid die de bittere pil van economisch (neo)liberalisme moet vergulden. Tenzij deze mensen standpunten zouden verdedigen waar ze eigenlijk niet achter staan… Het soort solidarisme dus, waar destijds de katholieke baron Woeste zich op beriep toen zijn Bokken pensen mochten uitdelen aan de arbeiders en Daens door hen als… socialist werd versleten. Structurele wijzigingen in het sociaal-economische en maatschappelijke bestel zijn dan ongewenst, het conservatieve status-quo ten voordele van de machthebbers en het heersende regime kan er maar wel bij varen, maar dat is geenszins wat het N-SA wenst.
En daarmee komen we bij een volgende punt van “kritiek”: rond het N-SA hangen er te veel socialistische zwaveldampen, hetgeen wel des duivels moet zijn voor de gemiddelde conservatief. Zoals eerder gezegd, het N-SA heeft daar geen probleem mee, op voorwaarde dat we het hebben over niet-marxistisch socialisme. Het is een onderscheid die men ter klassieke rechterzijde wel eens durft te vergeten. Geen oubollige 20ste eeuwse retoriek en/of achterhaalde begrippen en inzichten, maar een nieuwe analyse die gebruik maakt van het eerder aangehaalde leggen van kruisverbanden over filosofische grenzen heen, zowel historisch als hedendaags.
Als nieuw-solidaristen menen wij dat we een kader kunnen aanreiken voor een vorm van socialisme dat vorm kan geven aan de maatschappij voor de Lage Landen. Elk volk zijn socialisme, wars van elke vorm van internationalisme en wat ons betreft voortbouwend op de brede en zeer gedifferentieerde solidaristische traditie (bewegingen, personen…) in de Lage Landen. Dit socialisme is zonder meer een ethisch socialisme, het is niet de abstracte ideeënconstructie maar de bezielende idee die de voornaamste taak van het nieuw-solidarisme omlijnt: de vorming van de gemeenschapsdienende persoonlijkheid bevorderen in deze tijd van een ontworteld begrip inzake persoonlijke vrijheid en een massaal verspreid materialistisch egoïsme. Voor nieuw-solidaristen is dit socialisme geen systeem, geen wetenschappelijk omkleedde constructie, maar eerder een vorm van geloof. Een geloof in het zinvolle van mens-zijn, een geloof in zelfontwikkeling en –ontplooiing voor elke mens in een omgeving waar welzijn hoger geacht wordt dan welvaart, zonder het belang van het materiële te willen ontkennen of verwaarlozen. Immers, om het even welk beleidssysteem dat er niet zou in slagen om de productieve krachten in de bevolking arbeid te verschaffen en een zekere mate van materiële welvaart te verzekeren, kan mensen hun zelfachting niet teruggeven. Een dergelijk systeem is op zich verwerpelijk en als het zichzelf niet naar de ondergang werkt, verdient het enkel maar op weg naar die ondergang gezet te worden.
Concreet betekent dit dat het N-SA de onzalige belangenstrijd door een solidariteitsbewustzijn tussen alle lagen van de bevolking wenst te vervangen en bijgevolg ook aanstuurt op de structurele en institutionele veranderingen die dit moet helpen mogelijk maken. Het N-SA bepleit de vorming van een volksfront en wijst bijgevolg automatisch klassenstrijd af! Er gaapt een zeer wijde kloof tussen het ethische socialisme van het nieuw-solidarisme enerzijds en het belangensocialisme van het marxisme anderzijds. Toch moet gesteld dat we in tegenstelling tot de klassieke conservatieven wel geloven in een – weliswaar beperkte – mate van maakbaarheid van de maatschappij. Zoniet, blijft elk solidarisme steken in liefdadigheid binnen het bestaande politieke, economische en institutionele systeem dat uitblinkt in wankelmoedigheid, immobilisme en willoze, besluiteloze regeringen. Het N-SA pleit dan ook voor de vorming van een nationaal-democratie, waar orde, gezag en autoriteit als wapen tegen willekeur en dictatuur gelden en waar medemenselijkheid niet langs het dwaalpad van liberale “vrijheid” loopt maar wel langs vrij aanvaarde plicht. Enkel plichtenleer is ethisch verantwoord, want wie de absolute individuele vrijheid als het hoogste goed erkent, aanvaardt onmiddellijk ook het recht ze naar eigen goeddunken te gebruiken en dus ook te misbruiken.
Ondanks de afwijzing van het marxisme, moeten we ook hier een kanttekening maken. Marx en zijn theorie kunnen op diverse wijzen worden benaderd. Wie een correct oordeel over Marx wil vellen zal en kan niet uit het oog verliezen dat in de maatschappelijke toestand en de kapitalistische verhoudingen van die tijd, de arbeiders wel degelijk proletariërs waren en dat de klassenstrijdleer van toen de belichaming was van de socialistische drang naar menselijke waardigheid. Marx wenste een menselijkere wereld, maar hij heeft zich vergist. Marx was fout indien hij dacht dat door het vervangen van het kapitalistisch productieproces door het collectivistisch model, meteen ook het egocentrische individualistische mensentype zou vervangen worden door een altruïstische, sociaalgezinde mens. Een betere maatschappij vergt boven alles een betere mens, en beter word je als mens door ethiek hoog in het vaandel te voeren en door het streven naar een zinvoller leven dat in ruime mate aan medemensen tegemoet komt. Marxisme kan beschouwd worden als een wetenschappelijke theorie en dan is het boven alles een analysetheorie van het kapitalisme van de 19de en begin 20ste eeuw, niet van het socialisme! Marx was correct toen hij het klassenbewustzijn van de arbeiders vooropstelde als sociologische integratiekracht met het oog op hun politieke en sociaal-economische ontvoogding, hij was fout toen hij daarop meende een sociale theorie te kunnen bouwen wegens te abstract, te gelijkschakelend, en vooral voor de dag van vandaag te sterk verouderd. Als dit woord (“klasse”en andere terminologie) dus voorkomt in discours van politieke militanten zowel binnen het N-SA als daarbuiten in niet-marxistische kringen, moet dit gezien worden in het licht hiervan. Het nieuw-solidarisme is geenszins gebaseerd op dit klassebegrip, wel integendeel!
Meteen raken we nog een volgende punt van kritiek aan, onder andere door de heer Calle aangehaald op het debat van 3 okt. jl., namelijk dat het principe van een vakbond tegengesteld zou zijn aan “het solidarisme”. Vakbond, syndicalisme, klasse, revolutie… zijn dan allemaal termen die toegewezen moeten worden aan het marxisme (of varianten daarvan) en die zogezegd niet zouden passen in het solidarisme. Dit is zowel historisch als inhoudelijk fout. Historisch gezien hebben diverse vakverenigingen in de eerste helft van de 20ste eeuw bijgedragen aan het ontstaan van een sterke solidaristisch geïnspireerde beweging in het toenmalige katholieke Vlaanderen. De Werkmansbond tot Zelfverdediging en het Vlaams Nationaal Vakverbond zijn maar twee voorbeelden hiervan. Of de rol die Jules Declercq speelde binnen het Verdinaso, wat vooral te maken had met het syndicalisme. Het Verbond van Nationale Arbeiderssyndikaten (NAS) vormde de belangrijkste wervingsbasis voor het Verdinaso, ondanks het gestook van nogal wat clerus tegen het NAS en het Verdinaso. Meermaals namen Dinaso-publicaties het op voor nationaalsyndicalisten.
De kritiek op de klassieke partijvakbonden van toen geldt ook nu nog: het zijn partijsyndicaten die een staat binnen de staat vormen, en waarvan de top belang heeft bij het status-quo. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bestaande toestand en wat daarmee aangevangen moet worden enerzijds, en de gewenste toestand in de toekomst zoals de nieuw-solidaristen dit zien anderzijds. De gewenste toestand is eenvoudig: syndicalisme is een systeem binnen hetwelk de economie kan worden geordend, sociale orde en rechtvaardigheid kan worden uitgebouwd. Nu is onderhand genoeg gebleken is dat correcties op het liberaal-kapitalisme voortdurend onder druk staan van neoliberale dwaalideeën. Het is een geheel waar verplichte samenwerking nieuwe instituten (vroeger corporaties genoemd) creëert, die voortbouwen op de Europese continentale traditie van sociaal overleg en waarin een vakbond dus een nieuwe invulling krijgt van haar taken die meer afgestemd zijn op de noden in de 21ste eeuw. In een tijd waarin zowat alles is gedegradeerd tot koopwaar (niet enkel arbeid), is het noodzakelijk dat echte oppositie een vakvereniging voorstelt die een dergelijke nieuwe invulling van haar taken en wezen krijgt. De bestaande wettelijke toestand daarentegen, zorgt er voor dat een dergelijke vakvereniging niet vanuit het niets kan worden opgebouwd naast de bestaande partijvakbonden die zich goed hebben beschermd tegen mogelijke nieuwe concurrentie. Bovendien is het bereiken van een werkbare ‘Orde’ binnen het huidige vroeg 21ste-eeuwse demoliberale bestel niet (meer) mogelijk. Dit betekent dat het regime in zijn geheel als politieke vijand beschouwd moet worden, en niet de belangenorganisaties van werknemers op zich die hoe dan ook de zwakste partij zijn binnen het bestaande systeem. Dit betekent volgens N-SA evenzeer dat de klassieke betekenis van syndicale actie en het nut van stakingen niet enkel mogelijk moeten zijn maar zelfs aanmoediging verdienen, zo lang dit demo-liberale systeem niet in de gewenste existentiële crisis verkeert.
Tot slot kan nog ingegaan worden op de – in principe reeds tot op de draad versleten – “kritiek” op de leiding van het N-SA en dan meer bepaald de hoofdcoördinator, zijnde Eddy Hermy, of het op de man spelen in het commentaar op gastsprekers (de heer Reitz). Ik verwijs hierbij naar commentaren van de heer Calle in meerdere artikels van het conservatieve internetmagazine Bitterlemon. Los van het bedenkelijke niveau die dergelijke “kritieken” meestal slechts halen, en het bijgevolg ook dit antwoordartikel niet ten goede komt om erop in te gaan, kunnen we dergelijke zaken maar moeilijk laten passeren. Dat sommigen, onder wie de heer Calle, het moeilijk hebben of hadden met bepaalde debattechnieken kan best zijn en daar is weinig aan te verhelpen, maar in het licht van bovenstaande verduidelijking omtrent nieuw-solidarisme, de verschillende vormen van socialisme en de eraan verbonden terminologie en visies, lijkt het verwijt van “intellectuele oneerlijkheid” die door eerdergenoemde werd gemaakt gewoon fout te zijn. Uiteindelijk komt het wat Eddy Hermy betreft telkens weer uit op de aloude insinuaties omtrent het verleden als Amada-militant. Dit in het licht van het discours en de visie die het N-SA erop nahoudt, wordt logischerwijs verdacht gemaakt door de klassieke extreem-rechtse zijde. Tenslotte is de heer Calle deeltijds medewerker van het VB en partijgenoot Philip Dewinter meende de insinuatie in een vraaggesprek in het links-liberale weekblad Humo van 27 okt. j.l. nog eens fijntjes te moeten overdoen. De voorbeelden van personen in de brede radicale Vlaamse Beweging en daarbuiten (ook in het buitenland) die de overstap maakten van marxistisch-revolutionair naar nationaal-revolutionair zijn veelvuldig. Ook het toekennen van een soort absoluut “Führerschap” aan de “leider” van het N-SA is op niets meer dan gebakken lucht gebaseerd. Het N-SA-bestuur bestaat uit een groep mensen die gezamenlijk, in consensus beslissen en waarvan elk lid heus wel voor zichzelf kan nadenken en voorstellen formuleren, onder wie ondergetekende.
Coördinator N-SA
00:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, flandre, socialisme, solidarisme, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
A Call to the Alternative Right
 A Call to the Alternative Right
A Call to the Alternative RightAs one might surmise, one doesn’t get rich by serving the HL Mencken Club. Unlike other organizations, which have claimed the “conservative” label, belonging to our club is not a ladder to social acceptability or a means of increasing one’s income or deferred annuity allowance. Investing time and energy in an organization like ours is not a wise career move but something reminiscent of the fate that Mustafa Kemal thought would await Turkish troops as they prepared for the British attack at Gallipoli in 1915: “I am not asking you to stand and fight here; I am asking you to die in your tracks.” I doubt that even my favorite American military commander, the grim Stonewall Jackson, would have given his cavalry troops orders that were as bleak as this. But this is what the future founder of the Turkish republic said to his soldiers. I mention this not because I intend to order anyone to his death, but because I’m underlining the extraordinary dedication shown by those who have joined our ranks.
I’m especially impressed by those young people who are here. To say they have embraced the non-authorized Right indicates more than simply an ideological address. It betokens their willingness to become non-authorized dissenters, that is, to turn their backs on the characteristically stale conversations of media debates and the allowable differences of opinion within the Beltway.
Turning one’s back on this prescribed discourse means forfeiting the perks that flow from those in power. It also means being labeled as a troublemaker or extremist—and for those who persist in their orneriness, this choice may also mean being pushed out of magazines for which one previously wrote and having one’s books snubbed by the arbiters of acceptable political concerns.
A question I sometimes hear from my Republican son is this: Why do we believe that what we discuss here could not be discussed at conservative foundations or, say, on FOX-News? Presumably our conversation would be welcome in such outlets, unless we did something as shocking as badmouthing ethnic minorities. But there are two problems with this contention. One, the fact that we, or at least most of us, are kept from these outlets would suggest that whatever we discuss most definitely does not suit Republican- or neoconservative-sponsored forums or publications. This is the case even though we do not seek to insult any ethnic or religious group.
Two, we are obviously raising issues that for ideological or social reasons movement conservative organizations do not engage. A few illustrations might help make this point. Arguing that democracy and freedom are on a collision course, that modern liberal democracies, which combine universal rights with massive welfare states, necessarily undermine communal and family authorities, and that character and intelligence are largely fixed by heredity are not positions that neoconservative Beltway foundations would be eager to take on.
And if one considers the tight connection between movement-conservatives and the Republican Party, having authorized conservative organizations think outside the two-party box becomes even more problematic. After all, GOP partisans and clients do not want to hamper Michael Steele and the Republican National Committee from reaching out. And “reaching out” in this context means frantically trying to raid the other party’s base. Although GOP operators don’t hesitate to put down Democrats, what this amounts to is railing against the high costs of Democratic programs, while ignoring those incurred by the GOP in power.
Movement conservatives have assumed the task of airbrushing positions that GOP politicians are taking or would like some people to think they’re taking. Movement conservative publicists, for example, tried to convince us that Republican presidential candidates Rudolph Giuliani and Mitt Romney had shifted their social views, shortly before the presidential primaries in 2008. These supposedly genuine conversions had occurred on such delicate issues as late-term abortion, gay marriage, and the treatment of illegal immigrants. Nonetheless we were urged to take these timely shifts seriously, because someone at National Review or Weekly Standard has a thing for Rudy or struck up a friendship with Mitt. We were assured that Rudy was solid on the war and that he had once stiffed some Arab leader who came to New York. I would also call attention to a law prepared by Heritage, and introduced in 2005 by Governor Romney in Massachusetts, making sure that every Massachusetts resident had health insurance. Although this measure has contributed to towering state deficits, former Governor Romney, we are told, had nothing to do with this folly. It was supposedly altered by a Democratic legislation beyond recognition. Thus movement conservatives proclaimed, after they had tried to explain away Romney’s earlier support for gay marriage and other positions identified with the social Left.
Conservative journalists have done the GOP establishment other noteworthy favors. They scolded black civil rights leaders and more recently, former President Carter for suggesting that opponents of Obama’s health care plan are driven by racism. But this torrential indignation was almost entirely absent from GOP congressional leaders. Republican whip in the House, Eric Cantor of Virginia, pointedly refused to respond to the charge against his party. Cantor side-stepped the question when it came up in a press interview. Senate Minority leader Mitch McConnell became equally taciturn when confronted by the same charge.
What speaks volumes about how the GOP is handling Carter’s reproach is what GOP National Chairman Michael Steele said at a black institution Philander Smith College, in Little Rock, on September 22. Steele stressed his party’s urgent need to win over the black vote, and he denounced “the subtle forms of racism” that blacks encounter in both employment and college admissions. The GOP would take steps to deal with these subterranean forms of prejudice, and this audience should have no trouble figuring out what these countermeasures are. At last we can see the real value of movement conservative outcries against Democratic accusations of Republican racism. The apparent outrage is a mere diversionary noise for Republican politicians who are trying to make nice to the civil rights lobby. Some movement conservatives may have noticed this but are too ambitious or too comfortable to point out what is taking place.
Also illustrating the difference between us and movement conservatives, especially those who are joined at the hip with the GOP, are the differing ways in which we and they would react to something that recently happened at my college, which was the introduction of an elaborate plan for diversity training among students and faculty. This is something movement conservatives and the alternative Right may conceivably agree about, but here first impressions can be deceiving. Of course, we and they might scoff with equal disdain at our “Five-Year Plan for Strengthening Campus Diversity”—entitled “Embracing Inclusive Excellence”—which talks about the malice being vented against the handful of Jews, Muslims, and Hindus on campus. There is no evidence of these malicious outbursts, and the only evidence for discrimination cited is a methodologically dubious survey answered by 5 students, who were asked if they noticed white Christian students “glancing” suspiciously at them.
We and the neoconservative establishment would recognize (I hope) that these reports were invalid; and even if they were not, the solution offered, recruiting inner-city populations and providing them with scholarships, would not likely end the marginalization of Hindus. We might also have objected with equal annoyance to the plan for sending our faculty to affirmative-action training sessions; finally our two sides might have ridiculed the lop-sided 5 to1 majority by which the diversity plan passed the faculty—without any expectation that this document would be amended to conform to reality.
But having noted this conceivable area of agreement, I would also stress the divergence between our sides when it comes to extricating ourselves from the multicultural fever swamp. Possible neoconservative alternatives to what I’ve described, by such characteristic advocates as Lynne Cheney, David Horowitz and Bill Bennett, might include a compulsory course on the American heritage. This course would showcase our country as a self-perfecting global democracy; and it would take students on an inspirational journey from the Declaration of Independence’s proclamation that “All men are created equal” through FDR’s Four Freedoms down to Martin Luther King’s “I Have a Dream” speech. This and other similar measures would be used to teach students of all races and creeds “democratic values,” the spread of which, we would be told, is the high moral end for which the U.S. was brought into existence.
We might also hear a recommendation from neoconservative social commentator Dinesh D’Souza, calling for extraordinary efforts to integrate college students of all different ethnic backgrounds. D’Souza would accuse our administration of not going far enough to commit students and faculty to a universally exportable democratic way of life. We would also likely be told that recruiting minorities for the wrong reasons would create islands of separateness on our campus instead of making everyone into a member of the world’s first global nation. Finally we might be warned, perhaps by Cal Thomas or David Horowitz, that lurking behind calls for diversity is a hidden plea for anti-Zionism or a defeatist response to the War On Terror. Such hidden agendas characterize the advocates of diversity; who in any case are deviating from the goal of the saintly Martin Luther King, a firm opponent of all forms of quotas, even for black Americans.
Needless to say, I couldn’t think of anyone on the Alternative Right who would take any of these stands. Our side would stress that not every adolescent can do college work. Colleges that are serious about traditional disciplines might appeal to, at most, 20 percent of the young, which is the percentage of those who have the cognitive skills for doing college-level study. Given the fraudulent product that now passes for college education, it is not surprising that most students and faculty can neither learn nor teach what was once deemed appropriate as college subjects.
One could easily point to speakers at this conference who have taken the positions outlined. These fearless critics have questioned the transformation of American higher education into a devalued consumer product, made available to those who are incapable of real learning. Small wonder that colleges are turned into centers of multicultural social experiments and diversitarian gibberish! What better use could one find for a falsely advertised institution that is trying to entertain young social work, communication and primary education majors while taking their parents’ money!
Neoconservative educationists, we might also hear from the Alternative Right, have their own fish to fry. They are seeking to defend their version of the democratic welfare state as the best of all governments. They also have another far-reaching goal that is explicit or implicit in their college outreach. Neoconservatives, to speak about them specifically, wish to limit any disagreement on campuses generated by their aggressively internationalist foreign policy. In pursuit of this end, they happily falsify or obscure certain embarrassing historical facts, e.g., the massive deceit applied to pushing the U.S. into past foreign wars, and the published views of such neocon heroes as Churchill and Wilson dealing with racial and ethnic differences.
Neoconservatives and their defenders would accuse our side of taking positions that have no chance of being accepted. And they might be right on this last point. Our positions would infuriate the educational establishment and much of the public administration apparatus. Many of us, moreover, are strict constitutionalists, who would argue, to the consternation of the political class, that the federal government is excessively entangled in state and local education. It should be of no concern to public administrators whether a private college has or has not been recruiting designated minorities. Academic education should not be an occasion for government social planners to impose their vision on the private sector. Indeed private colleges, if they were truly concerned about being independent, would reject federal and state aid, and they would do all in their power to keep our managerial government from interfering with their institutions.
Note I am not defending “our side” in these debates. I am only making clear that we and they do not hold the same views about American education or about how its problems are to be engaged. I would also concede the obvious here, namely, that some people on our side of the divide may occasionally work for those on the other side and that the GOP out of power will occasionally get behind books and authors presenting arguments that would not please Republican administrations. Not all who make the arguments of the alternative Right have been subject to equally oppressive sanctions or have been uniformly denied a place in the sun. There are disparities in the ways that the GOP-movement conservative establishment has treated individual critics on the right. What seems beyond dispute however is that we and they disagree fundamentally on a wide range of questions, far more than we in this room would disagree with each other. The conventional conservative movement is therefore justified in recognizing that we are more different from their movement than establishment conservatives are from those on the center left. Movement conservatives and neoconservatives dialogue openly with the liberal Left while ignoring or ridiculing us—and this happens for a very good reason. The authorized version of the conservative movement understands that we and they are not of the same spirit. Unlike them, we do not serve the GOP; nor are we obliged to go along with neoconservative whims and fixations lest we lose our jobs or media outlets.
Most of us have already been confined to outer darkness; and there is no way we can change this unless we force our way, screaming and kicking, into the neoconservative-liberal conversation. The reason we must exist is that we dare to raise the questions that are anathema to the conventional media. And this is the reason that we lack corporate money and that our devotees are not writing for the Wall Street Journal, New York Times or Washington Post. We stand outside the egalitarian, managerial-state consensus, a consensus that in the end moves in only in one direction, which is leftward.
Those who opposed this trend were long an isolated minority, but now dissenters can be heard on talk radio, some of whom are even gaining a widespread popular appeal. This for me is a heartening development, despite the sad fact that most of us remain excluded from this turn of events, and although what is being described lacks any deep intellectual content. Note that nothing in these remarks would question the shallowness and histrionics of what I’m characterizing as the conservative talk-show phenomenon. As anyone who knows me can testify, it is hard for me to listen to Limbaugh or Beck for a protracted length of time without suffering an upset stomach. But what I’m noting here are long-range trends. There are forces on the American Right which have attracted mass-democratic attention, forces that the neoconservative media do not entirely own and which they can only provisionally preempt. This may bedevil our adversaries, especially if such populist heroes as Rush Limbaugh, Glenn Beck and Mike Savage strike out on their own, that is, decide to go after the GOP and the neoconservatives with the same fury that they’ve vented on the Democrats.
As the onetime isolated Right continues to gain adherents and visibility, what increases apace is the possibility for a breakthrough. And as one observes the sudden rise of our group, it seems to me that those who were once marginalized have become like lilies in a junkyard. Let us hope this junkyard, which is the conservative movement of programmed party-liners and GOP hacks, will eventually become something else. Perhaps the lilies that have sprung up amid the trash and debris will come to replace the present movement conservative wasteland—together with its FOX-News contributors.
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, politologie, sciences politiques, philosophie, droite, conservatisme, etats-unis, alternative |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La subsidiaridad, entre la libertad y la autoridad
| LA SUBSIDIARIEDAD, ENTRE LA LIBERTAD Y LA AUTORIDAD
Stéphane Gaudin (*) | |
| |
| |
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, subsidiarité, sciences politiques, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 16 novembre 2009
Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation
 Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation
Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation
Intervention de Philippe Banoy lors de la 10ième Université d’été de “Synergies Européennes”, Basse-Saxe, août 2002.
I. Volkoff et la subversion
Vladimir Volkoff, fils d’immigrés russes en France, est principalement un romancier prolixe, qui s’est spécialisé dans le roman historique, dont les thèmes majeurs sont la Russie et la guerre d’Algérie, et dans le roman d’espionnage.
Lorsqu’il servait à l’armée, il a entendu, un jour, une conférence sur la guerre psychologique. Pour la petite histoire, il fut le seul, parmi ses camarades, à avoir apprécié ce cours. Ses compagnons tournaient ce genre d’activité en dérision. Volkoff, lui, s’est aussitôt découvert un intérêt pour ces questions.
Son héritage familial le prédisposait à être attentif aux vicissitudes du communisme et aux techniques mises au point par les Soviétiques en matières de manipulation. Poursuivant ses investigations, Volkoff découvre le livre de Mucchilli, intitulé La subversion, où la guerre subversive se voit résumée en trois points:
◊ 1. Démoraliser la nation adverse et désintégrer les groupes qui la composent.
◊ 2. Discréditer l’autorité, ses défenseurs, ses fonctionnaires, ses notables.
◊ 3. Neutraliser les masses pour empêcher toute intervention spontanée et générale en faveur de l’ordre établi, au moment choisi pour la prise non violente du pouvoir par une petite minorité. Selon cette logique, il convient d’immobiliser les masses plutôt que de les mobiliser (cf. : les révolutionnaires professionnels de Lénine, avant-garde du prolétariat).
Après le succès de son roman Le retournement, dont le thème central est l’espionnage soviétique en France, Volkoff est engagé par le SDECE pour écrire un autre roman, sur la désinformation cette fois et avec la documentation que le service avait rassemblée. Volkoff commence par réfléchir, puis accepte cette mission. Résultat: son livre intitulé Le montage. Il connaît vite un succès important. Sollicité par ses lecteurs, qui veulent savoir sur quoi repose ce livre, il publie Désinformation, arme de guerre, une anthologie de textes sur le sujet. Rappelons que Volkoff, dans Le montage, fait référence à Sun Tzu et à l’objectif du stratège de l’antiquité chinoise : gagner la guerre avant même de la livrer. Citations : «Dans la guerre, la meilleure politique, c’est de prendre l’Etat intact; l’anéantir n’est qu’un pis aller». «Les experts dans l’art de la guerre soumettent l’armée ennemi sans combat. Ils prennent les villes sans donner l’assaut et renversent un Etat sans opérations prolongées». «Tout l’art de la guerre est fondé sur la duperie». Sun Tzu, et à sa suite, Volkoff, formule ses commandements :
◊1. Discréditez tout ce qui est bien dans le pays de l’adversaire.
◊2. Impliquez les représentants des couches dirigeantes du pays adverse dans des entreprises illégales. Ebranlez leur réputation et livrez-les, le moment venu, au dédain de leurs concitoyens.
◊3. Répandez la discorde et les querelles entre citoyens du pays adverse.
◊4. Excitez les jeunes contre les vieux. Ridiculisez les traditions de vos adversaires [Volkoff ajoute : Attisez la guerre entre les sexes].
◊5. Encouragez l’hédonisme et la lassivité chez l’adversaire.
Comme le fait remarquer Volkoff, la subversionne peut faire surgir du néant ce type de faiblesses. Comme dans toute pensée de l’action indirecte, il faut savoir détecter, chez l’adversaire, toutes formes de faiblesse et les encourager. Tout peuple fort, en revanche, échappe à cette stratégie indirecte; il n’est pas aussi facilement victime de ces procédés.
2. De ce que n’est pas la désinformation
Avant d’expliquer ce que n’est pas l’information, il convient de formuler une mise en garde et de bien définir ce qu’est l’information à l’âge de la “société de l’information”. Le militaire distingue l’information, d’une part, et le renseignement, d’autre part. L’information est ce qui est recueilli à l’état brut. Le renseignement, quant à lui, est passé par un triple tamis : a) l’évaluation de la source (est-elle fiable ou non fiable, est-elle connue ou inconnue, quelles sont ses orientations philosophiques, politiques, religieuses, etc.?); b) l’évaluation de l’information (est-elle crédible ou non?); c) le recoupement de l’information. Dans toute information ou pour tout renseignement, il y a un émetteur et un récepteur. Les questions qu’il faut dès lors se poser sont les suivantes : Pourquoi l’émetteur émet-il son message? Pourquoi le récepteur est-il visé par l’émetteur et pourquoi écoute-t-il son message? L’officier de renseignement, en charge du recoupement, doit savoir que chacun est marqué par sa subjectivité. Il doit pouvoir en tirer des conclusions. Ce qui nous amène à constater que l’objectivité, en ce domaine, n’existe pas. Ceux qui prétendent donner une information objective sont soit idiots soit malhonnêtes.
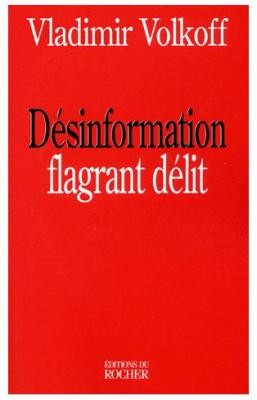 ◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.
◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.
Quand on fait de la propagande, on sait que c’est de la propagande. On sait qui émet et on sait qui est visé. La propagande est claire. Elle vise à convaincre en semblant s’adresser à l’intelligence mais, en réalité, elle vise les émotions.
◊B. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PUBLICITé.
Le but de la publicité n’est pas de tromper mais de vendre. Le mensonge n’est qu’un moyen d’influencer le consommateur. Elle s’adresse aux pulsions et à l’inconscient des gens. La propagande feint de convaincre, alors que la publicité cherche à séduire, et son but est clair : “achetez Loca-Laco” ou “votez Clinton”.
◊C. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE L’INTOXICATION.
Elle ressemble à la désinformation puisqu’elle vise, via des informations, à tromper et à manipuler subtilement une cible. Mais l’intoxication ne vise que les chefs, pour les amener à prendre une mauvaise décision, qui doit causer leur perte.
3. Qu’est ce que la désinformation?
La désinformation dépend de trois paramètres:
◊1. Elle vise l’opinion publique, sinon elle serait de l’intoxication.
◊2. Elle emploie des moyens détournés, sinon elle serait de la propagande.
◊3. Elle a des objectifs politiques, intérieurs ou extérieurs, sinon elle serait de la publicité.
Ce qui nous conduit à la définition suivante : la désinformation est une manipulation de l’opinion publique, à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés.
4. Comment la désinformation est-elle conçue?
Au niveau de la méthode, nous relevons une analogie avec la publicité.
◊A. On doit définir qui est le bénéficiaire de l’opération : c’est celui pour qui l’opération est montée.
◊B. On doit disposer de celui qui va réaliser l’opération : l’agent (CIA ou KGB).
◊C. On doit procéder à une étude de marché : quel message va-t-on utiliser pour arriver au but et comment toucher la cible?
◊D. On doit déterminer les supports : la télévision, la presse, une pétition, internet, un intellectuel, etc.
◊E. On doit déterminer les relais : les “idiots utiles” et les agents payés dans les sphères de la télévision, de la presse écrite, des pages de la grande toile, les artistes, les acteurs, les écrivains, etc.
◊F. On doit déterminer les caisses de résonnance : tous les individus qui, touchés par l’information fausse, la répandent en toute bonne foi, la lancent et la propagent sur un mode idéologique ou autre.
◊G. On doit déterminer la cible : elle peut être la population du pays adverse dans son ensemble; elle peut aussi viser une partie de la population (par exemple, les enseignants) voire des pays tiers (p. ex. : l’opération “swastika” à la fin des années 50, pour faire croire à une résurgence du nazisme en Allemagne).
La diabolisation est une forme de désinformation, car elle vise à détruire l’image de l’adversaire (ou de ses chefs) par des méthodes pseudo-objectives. Quelles sont-elles? Quelques exemples : a) Diffuser de faux documents “officiels”; b) diffuser de fausses photos ou de vraies photos décontextualisées (exemples récents : un cliché de morts serbes avec une légende qui les désigne comme “kosovars”); c) fabriquer de fausses déclaration ou un montage; d) diviser les antagonistes en “bons” et en “mauvais”, en donnant à ce manichéisme des airs “objectifs”; dans la foulée, on passe sous silence les crimes des “bons”, et on s’abstient de toute critique à leur égard.
5. Comment la désinformation se pratique-t-elle ?
◊ a. On nie le(s) fait(s) ou on utilise le mode interrogatif ou dubitatif quand on les évoque. Les formules privilégiées sont : “On dit que... mais il s’agit d’une source serbe, ou néo-nazie, ou paléo-communiste, ou...”. On discrédite ainsi immédiatement l’information vraie que l’on fait passer pour peu “sûre”.
◊ b. On procède à l’inversion des faits.
◊ c. On procède à un savant mélange de vrai et de faux.
◊ d. On modifie le motif d’une action, par exemple, l’agression des Etats-Unis et de l’OTAN contre la Serbie a été présentée non pas comme une action militaire classique mais comme une “mission humanitaire”. Pour l’Irak, la volonté de faire main basse sur les réserves pétrolières du pays est camouflée derrière une argumentation reposant sur le “droit international”.
◊ e. On modifie les circonstances ou on ne les dit pas. Ce procédé est souvent utilisé dans les informations relatives au conflit israélo-palestinien ou à la guerre civile en Irlande du Nord.
◊ f. On noie l’information vraie dans un nuage d’informations sans intérêt.
◊ g. On utilise la méthode de la suggestion, conjuguée au conditionnel. Exemple : “Selon nos sources, il y aurait eu des massacres...”.
◊ h. On accorde une part inégale à l’adversaire dans les temps consacrés à l’information. Un exemple récent : on a accordé trois minutes d’antenne à Le Pen au second tour des Présidentielles françaises du printemps 2002, ainsi qu’à Chirac, mais, avant cette distribution “égale” du temps d’antenne, on a présenté pendant vingt minutes des manifestations anti-Le Pen.
◊ i. On accorde parfois la part égale en temps, en invitant les deux camps à s’exprimer : le premier camp, qui est dans les bonnes grâces des médias, est représenté par un universitaire habitué à parler sur antenne; l’autre camp, auquel les médias sont hostiles, est alors représenté par un chômeur alcoolique.
◊ j. On estime que chaque camp a une part égale en responsabilité. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, les Palestiniens lancent des pierres, les Israéliens ripostent avec des chars. Le conflit est jugé insoluble : les deux camps sont de “mauvaise volonté”. Ainsi le conflit perdure au bénéfice du plus fort.
◊ k. On présente l’information en ne disant que la moitié d’un fait. Exemple pris pendant la crise du Kosovo : “Les Serbes ont utilisé des gaz”. Sous-entendu : des “gaz de combat” ou des “chambres à gaz”. En réalité, la police serbe avait dispersé une manifestation avec des gaz lacrymogènes.
6. Comment réagir face à la désinformation ?
◊ 1. Il faut d’abord rester modeste et ne pas prétendre simplifier à outrance des réalités complexes. L’homme libre, l’esprit autonome, pose un jugement historique (généalogique, archéologique), profond, sur les réalités politiques du monde.
◊ 2. Il faut, dans tous les cas de figure, rester méfiant. Il faut systématiquement recouper les informations, s’interroger sur la plausibilité d’une information médiatique, se méfier des répétitions et des appels systématiques à l’émotion.
◊ 3. Il faut s’informer soi-même, lire des ouvrages élaborés sur les peuples, les régions, les régimes, les situations incriminées dans les grands médias. Une culture personnelle solide permet de repérer immédiatement les simplifications journalistiques et médiatiques.
◊ 4. Il faut lire des ouvrages et des journaux ouvertement idéologiques, non conformistes, qualifiés de “marginaux”, car ils expriment des vérités autres, mettent en exergue des faits occultés par les grands consortiums médiatiques. Lire ces ouvrages et cette presse doit évidemment se faire de manière intelligente et critique, pour ne pas tomber dans des simplifications différentes et tout aussi insuffisantes.
◊ 5. Il faut créer et animer des cercles alternatifs d’analyse, afin de ne pas laisser “sous le boisseau” les vérités que l’on a glânées individuellement par de bonnes lectures alternatives.
Philippe BANOY.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, désinformation, manipulations médiatiques, philosophie, synergies européennes, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 novembre 2009
L'"Arthasastra" de Kautilya: aux sources de la pensée politique indienne
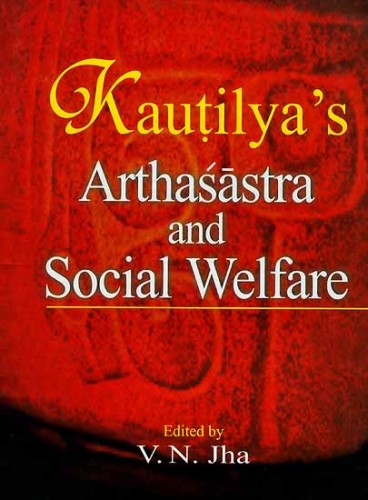 L'«Arthasastra» de Kautilya: aux sources de la pensée politique indienne
L'«Arthasastra» de Kautilya: aux sources de la pensée politique indienne
L'Arthasastra de Kautilya est un grand texte classique indien en sanskrit consacré à l'art de gouverner. Il fut traduit intégralement en anglais pour la première fois en 1915. Les éditions du Félin viennent d'en publier une partie en français. Gérard Chaliand écrit dans son avant-propos: «L'Arthasastra est un monument considérable qui témoigne de la puissance et de l'originalité de la pensée politique indienne. L'Arthasastra est un traité sur l'Etat, le pouvoir et l'usage de la force. Ecrit matérialiste, pourrait-on dire, aux antipodes d'une conception théocratique, le traité de Kautilya pourrait être qualifié de machiavélien si l'anachronisme n'était flagrant, le discours indien précédant la réflexion du Florentin d'environ quinze siècles (...). Selon la tradition, le traité serait l'œuvre du ministre et conseiller du premier empereur de la dynastie des Maurya, contemporain d'Alexandre le Grand, qui régna au dernier quart du VIième siècle avant notre ère. En fait, la datation de l'œuvre est incertaine (elle varie du Iier avant au IVième après notre ère). On tend aujourd'hui à la situer aux alentours du Iier siècle. Bref, l'ouvrage a environ deux mille ans et son titre, Artha, désigne la prospérité et sa recherche, quête éminemment matérielle, qui, pour l'Etat, consiste à acquérir et conserver richesse et puissance. L'Arthasastra, ou science du politique, est un traité comprenant quinze livres —soit cinq cents pages— dont on ne trouvera ici qu'une modeste partie, mais qui me semble essentielle si l'on veut saisir l'essence de ce chef-d'œuvre politique. Car l'Arthasastra est à la naissance du politique ce que Sun Zi est à la naissance de la stratégie: une élaboration d'une originalité absolue» (J. de BUSSAC).
Kautilya, Arthasastra. Traité politique et militaire de l'Inde ancienne, Editions du Félin, 1998, 122 pages. 100 F.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, inde, hindouisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 novembre 2009
Stosstrupp einer neuen Wirklichkeit - Die Gruppe Sozialrevolutionäre Nationalisten 1930-1935
 Stoßtrupp einer neuen Wirklichkeit – Die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten 1930 - 1935
Stoßtrupp einer neuen Wirklichkeit – Die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten 1930 - 1935
Richard Schapke, im Februar 2002
Gegenstand dieses Aufsatzes sind die Aktivitäten des Publizisten Karl O. Paetel und der sich um ihn scharenden Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten. Bei der GSRN handelte es sich um die sicherlich radikalste und konsequenteste Gruppierung der Weimarer Nationalrevolutionäre. Als einzige Organisation bezeichnete die GSRN sich offen als "nationalbolschewistisch" – und versuchte sich mit entsprechender Energie am Brückenschlag zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus.
1. Karl Otto Paetel
Der nach dem Zweiten Weltkrieg als Verfasser von Arbeiten über Ernst Jünger und die Jugendbewegung zu einiger Bekanntheit gelangte Karl O. Paetel wurde am 23. November 1906 in Berlin geboren. Schon als Gymnasiast betätigte Paetel sich aktiv in der sogenannten Bündischen Jugend, die jedoch letztendlich nur die Rolle eines Durchlauferhitzers spielen sollte. Als wichtige politische Einflüsse sind zunächst der völkische Indologe Professor Hauer und Ernst Jüngers Soldatischer Nationalismus zu nennen. Als Student der Germanistik, Geschichtswissenschaften und der Philosophie schloss Paetel sich 1926 der Deutschen Freischar an, einem Versuch, die zersplitterten Gruppen der gegen das westlich-materialistische System revoltierenden Bündischen Jugend zu sammeln. Ab 1927 arbeitete der verkrachte Student beim "Deutschen Tageblatt", einem Organ der Deutschvölkischen Freiheitspartei. Mit dieser bürgerlich-reaktionären Gruppe kam es sehr bald zum Bruch.
Paetel hatte nicht zuletzt durch das Gemeinschaftsgefühl der Jugendbewegung bereits zu einem diffusen "Sozialismus" gefunden. Eine Möglichkeit zur Verwirklichung desselben sah er in der Altsozialdemokratischen Partei ASP, die sich 1926 von der SPD getrennt hatte. Unter dem Einfluss von Männern wie August Winnig und Ernst Niekisch hatte die ASP sich zum Ziel gesetzt, die unzufriedene Arbeiterschaft durch soziale, wirtschaftliche und politische Reformen für den deutschen Staat zu gewinnen, auf dass Deutschland unter Führung des unverbrauchten "Arbeitertums" die Ketten des Liberalismus und des Versailler Diktats zerbreche. Den Ultrareaktionären im deutschvölkischen Lager (interessanterweise ist die DVFP die indirekte Vorläuferorganisation der NPD) waren Zugeständnisse an die Arbeiterklasse jedoch verdächtig, und so führte Paetels Engagement für die ASP zu seinem Hinauswurf aus der Redaktion des "Deutschen Tageblatttes". Dem altsozialdemokratischen Intermezzo fiel ebenfalls das ehrgeizige Projekt zum Opfer, gemeinsam mit Reinhold Quaatz, dem Propagandachef der Deutschnationalen Volkspartei, die "Preußischen Jahrbücher" herauszugeben. Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang die halbjüdische Herkunft von Quaatz – Paetel hatte wenig Berührungsängste, und nachmalige antisemitische Fehltritte sind wohl eher als Verbeugung vor dem Zeitgeist zu deuten.
Ernüchtert und von jeglichen Illusionen über die politischen Absichten der Deutschvölkischen und Deutschnationalen kuriert, übernahm Karl O. Paetel im Oktober 1928 aus der Hand eines Berliner ASP-Kameraden die Chefredaktion der Zeitschrift "Das Junge Volk" in Plauen. Zu dieser Zeit vollzog sich ein Gärungsprozess in den Reihen der Bündischen Jugend. Die Fragestellung innerhalb der zerstrittenen Bünde hieß nicht mehr "Nation oder Sozialismus", sondern "Nation und Sozialismus". Diese Synthese sollte durch die "Neue Front" der von gefühlsmäßigem Antikapitalismus und unklaren Sozialismusbegriffen erfassten Jugendverbände geschaffen werden. Paetel und andere wie Hans Ebeling oder Ernst Jüngers Juniorpartner Werner Lass schlugen einen bewusst "nationalbolschewistischen" Kurs ein.
Man ging deutlich über Moeller van den Brucks Definition Deutschlands als proletarischer Nation hinaus. Innerhalb Deutschlands wurden durch die inkompetente Wirtschafts- und Erfüllungspolitik der Weimarer Regierungen Millionen proletarisiert, so dass der Kampf gegen den Versailler Friedensvertrag und der Kampf gegen das liberalkapitalistische Weimarer System zusammenwuchsen. Zugleich bedeutete diese Radikalisierung aber auch eine Kampfansage an den "kleinbürgerlichen Naturidealismus" der herkömmlichen Jugendbewegung. Hierbei befand Paetel sich in engster Nachbarschaft zur im Aufbau befindlichen Hitler-Jugend, deren Reichsleitung nicht von ungefähr ebenfalls in Plauen angesiedelt war. In seiner Bedeutung für Paetels politische Entwicklung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann der politische Einfluss des späteren Marburger Professors Wolfgang Abendroth, damals Aktivist der jugendbewegten Freisozialisten. Abendroth machte den völkischen Renegaten nachhaltig mit dem Klassenkampfgedanken vertraut, und Paetel schlussfolgerte, es bedürfe des Klassenkampfes, um die nationale Befreiung Deutschlands zu erreichen – eine Radikalisierung auch über die Thesen der ASP hinaus.
Nachdem der zusehends extremere Kurs des "Jungen Volkes" von paramilitärischen Wehrverbänden wie Oberland beifällig aufgenommen wurde, erkannte in der Februar-Ausgabe 1929 Artur Grosse den proletarischen Klassenkampf erstmals öffentlich an. Zwei Monate später formulierte Gunter Orsoleck, vor einigen Jahren Anführer einer HJ-Revolte gegen Hitlers reaktionäre Reichsleitung in München: "Volksgemeinschaft oder Klassenkampf? Sollte das ernstlich auch heute noch für die Bündischen zweifelhaft sein? Der Kampf um die nationalen Ziele, um die Freiheit des politischen Lebens, ist heute ein Kampf gegen die herrschenden Wirtschaftsmächte. Dieser Kampf ist nur zu gewinnen, wenn eine gemeinsame Front aller aktiven Kräfte im Volke da ist."
2. Arbeitsring Junge Front
Da die Tätigkeit als Chefredakteur den irrlichternden Paetel nicht zufriedenstellte, legte er diese im Frühjahr 1929 nieder. Publizistisch blieb er mit Aufsätzen im "Jungen Kämpfer", der Herausgabe der "Jungpolitischen Rundbriefe" und natürlich durch weitere Mitarbeit im "Jungen Volk" aktiv. Die "Jungpolitischen Rundbriefe" stellten eine Presseschau dar, die ihre Ansichten aus dem linkssozialdemokratischen "Klassenkampf", den "Nationalsozialistischen Briefen", dem "Widerstand", dem "Vormarsch", dem "Dritten Reich" oder der "Standarte" bezog. Durch diese Tätigkeit gelang es Paetel naturgemäß, eine Reihe wichtiger Kontakte zu knüpfen.
Wie unter den Weimarer Nationalrevolutionären üblich, widmete sich auch Paetel dem Aufbau eines Zirkels, des Arbeitsringes Junge Front. Der in Berlin-Charlottenburg ansässige Arbeitsring ging davon aus, dass ohne die soziale Befreiung der werktätigen Massen die Freiheit der Nation undenkbar sei. Durch die soziale Befreiung sollten die Proletarier in die Volksgemeinschaft eingegliedert werden, also bejahte die Gruppe den Klassenkampf der Arbeit gegen das Kapital. Im Gegensatz zu den meisten anderen NR-Gruppen zeigten Paetels Kameraden ein reges Interesse an ideologischer Untermauerung ihrer Ansichten und formierten die Fachgruppen Nationale Fragen, Sozialismus, Kapitalismus, Imperialismus und Fürsorgeerziehung. An den teilweise gut besuchten Veranstaltungen des Arbeitsringes beteiligten sich auch Vertreter des kommunistischen Jugendverbandes KVJD und der HJ. Auf einer dieser Veranstaltungen, am 4. Juli 1929, propagierte Paetel die Bildung der antikapitalistischen Jugendfront und den Nichtangriffspakt aller antikapitalistisch orientierten Organisationen von KVJD bis HJ. Allerdings erschienen die eingeladenen Kommunisten nicht, und die Nationalsozialisten verließen den Saal. Anschließend beteiligten die Teilnehmer sich vor der französischen Botschaft an einer wüsten Straßenschlacht gegen die preußische Polizei.
Zu diesem Zeitpunkt rückte die Entwicklung innerhalb der NSDAP in Paetels Blickfeld. Am 1. August 1929 hatte Otto Strasser seine "14 Thesen der Deutschen Revolution" veröffentlicht, die sich mit den Kernpunkten Kampf gegen Versailles, zentralistisches Großdeutschland, Korporativstaat und völkische Erneuerung im Vergleich mit der ultradikalen Linie eines Joseph Goebbels ziemlich harmlos ausnahmen. Der Arbeitsring erkannte, dass es innerhalb der NSDAP einen starken linken Flügel gab, der ideologische Verwandtschaften mit den Nationalrevolutionären aufwies und gegen Hitlers bürgerlich-reaktionären Kurs opponierte. Durch die Entwicklung extremistischer Positionen sollte dieses Potential innerhalb der NSDAP genutzt und radikalisiert werden. Den Anfang machte Paetel, als er Mitte August 1929 in Strassers "Nationalsozialistischen Briefen" seine These vom nationalen Klassenkampf wiederholte und offen erklärte, sozialistische Politik könne sowohl durch Mitarbeit in der NSDAP als auch in den NR-Gruppen oder der KPD betrieben werden.
Am 1. Oktober 1929 legte "Das Junge Volk" eine aufsehenerregende Skandalnummer nach. Paetel verkündete: "Wir wollen die Zusammenarbeit der nationalistischen Aktivisten, die sozialistisch sind um der Nation willen, mit den Aktivisten, die sozialistisch sind um des Proletariats willen." Rolf Becker verlangte den bewaffneten Klassenkampf und forderte den Bürgerkrieg nach bolschewistischem Beispiel, um die Internationale des Nationalismus und des Sozialismus zu schaffen. In der gleichen Ausgabe erschien ein entweder von Paetel oder dem in Schleswig-Holstein agitierenden NS-Linksaußen Bodo Uhse verfasstes Alternativprogramm für die NSDAP. "Die NSDAP ist eine nationalistische Partei. Ihr Ziel ist die Freie Deutsche Nation. Die NSDAP ist eine sozialistische Partei. Sie weiß, dass die Freie Deutsche Nation erst durch die Befreiung der werktätigen Massen Deutschlands von jeder Form der Ausbeutung und Unterdrückung erstehen kann. Die NSDAP ist eine Arbeiterpartei. Sie bekennt sich zum Klassenkampf der Schaffenden gegen die Schmarotzer aller Rassen und Bekenntnisse." Konkrete Forderungen waren Bildung des Großdeutschen Reiches, Annullierung aller außenpolitischen Verpflichtungen und Verträge der Weimarer Republik, Rätesystem auf Betriebsebene, Zerschlagung von Parlamentarismus und Parteienstaat, Verstaatlichung aller Wirtschaftsmittel, Enteignung des Mittel- und Großgrundbesitzes sowie Bildungs- und Sozialreformen zugunsten der armen Bevölkerungsschichten. Als Verbeugung vor dem antisemitisch-rassistischen Zeitgeist müssen die Ausweisung aller zugewanderten Ostjuden und ein strikt biologisch determinierter Staatsbürgerschaftsbegriff gewertet werden. "Die NSDAP ist sich bewusst, dass die in diesen Leitsätzen niedergelegten Gedanken sich nicht verwirklichen lassen ohne eine grundsätzliche Umstellung der bestehenden Machtverhältnisse. Da die volle Kontrolle über die gesamten deutschen Wirtschaftsmittel heute in den Händen von Organen des internationalen Finanzkapitals liegt, richtet sich die nationale Revolution unmittelbar gegen das internationale Finanzkapital. Hieraus ergibt sich, dass jede in Deutschland vollzogene Umwälzung sofort alle Machtmittel des Völkerbundes und Amerikas gegen den Deutschen Arbeiter- und Bauernstaat auf den Plan ruft. Erste Aufgabe der nationalsozialistischen Außenpolitik ist deshalb die Organisation der revolutionären Verteidigung gegen die imperialistischen Mächte, Bündnis mit der Sowjetunion und Unterstützung der revolutionären Bewegungen in allen Ländern der Welt, die sich gegen das internationale Finanzkapital richten."
Das erregte Aufsehen war beachtlich, die bürgerliche und die sozialistische Presse erschauerten vor der herannahenden 3. Welle des Nationalbolschewismus. Strassers Presseorgane winkten übrigens ab und kritisierten den übersteigerten Rassismus sowie die außenpolitische Anlehnung an die Sowjetunion und koloniale Befreiungsbewegungen. Immerhin gelang es Paetel, die Aufmerksamkeit der sogenannten Hamburger Nationalkommunisten auf sich zu lenken. Diese spielten in der direkten Nachkriegszeit unter Heinrich Laufenberg und Fritz Wolffheim eine bedeutende Rolle beim Aufbau der KPD, spalteten sich dann mit der KAPD ab und wurden innerhalb dieser von ultralinken Gruppen marginalisiert und verdrängt. Fritz Wolffheim dachte im "Jungen Volk" vom November 1929 über "Anfang oder Ende der deutschen Revolution" nach.
Ende 1929 wurde auch die Kommunistische Internationale auf die Gruppe um Paetel aufmerksam. Die deutschsprachige "Moskauer Rundschau" konstatierte, die nationalrevolutionäre Rechte habe sich zusehends den sozialistischen Vorstellungen der KPD angenähert. Nicht zuletzt der von einem China-Einsatz zurückgekehrte Berufsrevolutionär und linke Ruhrkämpfer Heinz Neumann sprach sich für eine partielle Zusammenarbeit der KPD mit den Nationalrevolutionären aus, was noch bedeutsame Folgen haben sollte.
3. Im nationalsozialistischen Minenfeld
Am 3. Januar 1930 trat das publizistische Schaffen Karl O. Paetels in ein neues Stadium. An diesem Tag übernahmen mit Ernst Jünger und Werner Lass zwei der wohl profiliertesten Nationalrevolutionäre die Herausgeberschaft der Zeitschrift "Die Kommenden" und delegierten die Chefredaktion an Paetel. Das Mitte der 20er Jahre entstandene Blatt sah sich als überbündisches Sprachrohr der Jugendbewegung und geriet im Lauf der Jahre zusehends in ein nationalrevolutionär-nationalsozialistisches Fahrwasser. Mit einer Auflage von bis zu 15.000 Exemplaren hatten "Die Kommenden" eine erhebliche Breitenwirkung – nicht zuletzt bei den Jugendgruppen der deutschnationalen Angestelltengewerkschaft DHV und bei der Hitlerjugend, für deren Führerkorps die Zeitschrift seit Sommer 1929 Pflichtblatt war.
Paetel öffnete die Spalten der "Kommenden" seinem nationalbolschewistischen Umfeld und schlug einen deutlichen Annäherungskurs an die NS-Linke ein. Endziel war die Bildung einer Einheitsfront aus revolutionären Nationalsozialisten, Proletariat, Bündischer Jugend und Frontsoldaten. Schon nach wenigen Wochen zeigte sich jedoch, dass die "Kommenden" eine weitaus radikale Richtung einschlugen als die Strasseristen. Bereits Mitte Februar attackierte man Otto Strassers Weigerung, Verstaatlichungen und Planwirtschaft anzuerkennen. Einen Monat darauf pflichtete die Redaktion der These bei, für den Wiederaufstieg Deutschlands sei auch das barbarischste Mittel gerechtfertigt. In den NS-Briefen formulierte Paetel zu dieser Zeit: "Gewehr bei Fuß und tätige Bereitschaft für den Augenblick, wo wir dann die Aktion der Unterjochten zu der unseren machen, die Bonzokratie der Moskauer hinwegfegen und das Steuer zum deutschen Sozialismus herumreißen." Die nationalrevolutionäre Avantgarde sollte also nicht nur die Führung der vom Hitlerismus, sondern auch der vom Stalinismus verblendeten Massen übernehmen.
Die orthodoxe Rechte, verkörpert nicht zuletzt durch den Frontsoldatenbund Stahlhelm und die Deutschnationalen, also Hitlers politische Wunschpartner, reagierte mit einer heftigen Kampagne gegen die NS-Linke. Man stellte die Skandalnummer des "Jungen Volkes" als Produkt der Parteilinken dar und setzte den apathischen Hitler immer massiver unter Druck, seinen innerparteilichen Gegnern das Handwerk zu legen. Paetel zog am 28. März 1930 zufrieden seine Zwischenbilanz: Die Trennung zwischen nationaler Boureoisie und revolutionärem Nationalismus zeige sich immer deutlicher. Offen erklärte er die nationale Bourgeoisie zum Hauptfeind der Nationalrevolutionäre. Nur zwei Tage später wurde der Chefredakteur als Antwort auf einen scharfen Angriff gegen die nationale Ikone Hindenburg aus der Deutschen Freischar ausgeschlossen. Anfang Mai warnte Reichswehrminister Groener per Geheimbefehl die Reichswehr vor den sich radikalisierenden linksnationalistischen Tendenzen innerhalb der Bündischen Jugend und namentlich vor der Zeitschrift "Die Kommenden".
Am 10. Mai 1930 setzten im Berliner Büro des Strasserschen Kampfverlages hektische Besprechungen der NS-Linken ein, wie man dem zusehends reaktionäreren Kurs der Münchener Reichsleitung begegnen solle. Hierbei spielten auch Paetels Einheitsfrontpläne eine gewisse Rolle, auch wenn der sich letztlich als der bessere Hitler definierende Otto Strasser hierbei eigennützige Pläne verfolgte. Anlass zur Sprengung der NSDAP von innen heraus sollte der Zeitungskrieg zwischen dem Berliner Gauleiter Goebbels und dem Kampfverlag dienen. Im Gegensatz zu Strassers späterer Darstellung ging es hier weniger um ideologische Differenzen mit Goebbels, dessen "Angriff" durchaus weiter links stand als die Kampfverlagspresse, sondern um einen reinen Machtkampf um die Vorherrschaft im Gau Berlin. Die Lage war nicht aussichtslos, denn auf der Abschlussbesprechung hatten sich mindestens drei Gauleiter, zahlreiche NS-Publizisten und mehrere SA-Führer hinter Otto Strasser gestellt. Dieser wollte nach dem ersten Parteiausschlussverfahren gegen einen seiner Mitarbeiter handeln und die Abspaltung der norddeutschen NSDAP-Gaue provozieren. Kristallisationspunkt dieser Unabhängigen Nationalsozialistischen Partei sollten die Kampfverlags-Presse und "Die Kommenden" werden. Paetel stimmte einer Zusammenarbeit nur unter der Voraussetzung zu, dass die Abspaltung unter sozialistischen Vorzeichen zu erfolgen hatte.
n den "Kommenden" und den NS-Briefen attackierte Paetel unter seinem Pseudonym Wolf Lerson die Intellektuellenfeindlichkeit der Münchener Reichsleitung. "Die französische Revolution brach aus, als die Ideen der Enzyklopädisten die alte Gesellschaft sturmreif gemacht und die Bourgeoisie mit neuen Forderungen erfüllt hatten. Rousseau und Voltaire sind ebenso ihre Väter wie Robespierre und Danton. Und die Väter der russischen Revolution haben nicht nur Bomben geworfen, sondern fast ein Jahrzehnt in den Schweizer Emigrantencafés diskutiert und Flugschrift über Flugschrift geschrieben. Ist es ein Zufall, dass die russische Revolution schließlich von einem Schriftsteller wie Lenin, die faschistische von einem Journalisten wie Mussolini durchgeführt wurde?" Genauso wichtig die die Schaffung des Dritten Reiches seien die geistige Klärung und „der Marschtritt der Formationen“.
4. GSRN und KGRNS
Mittlerweile schienen sich bei Paetel die ersten Zweifel eingeschlichen haben, ob Strasser wirklich der richtige Partner war. Am Pfingstwochenende 1930 hob er zusammen mit den Weggefährten des Arbeitsringes und den Überresten des Hamburger Bundes der Kommunisten die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten (GSRN) aus der Taufe. Als maßgebliche Mitglieder der Frühzeit sind die Nationalsozialisten Artur Grosse und Max Wehling und die bündischen Aktivisten Heinz Gruber und Heinz Gollong zu nennen. Die GSRN-Begründer wurden aus eigenem Entschluss aktiv, da sie die NSDAP-Hauptlinie ablehnten und ihnen andererseits die Strasseristen in puncto Sozialismus und Klassenkampf als zu halbherzig erschienen. Sich als Arbeitsgruppe zur national-sozialistischen Durchdringung der Jugendbünde und Nationalrevolutionäre verstehend, unterhielt die höchstens 500 Mitglieder zählende Gruppe dennoch ein weitgespanntes Netz von Vertrauensleuten in den urbanen Ballungszentren.
Die "Thesen der GSRN" lauteten zunächst:
"Wir erkennen die Notwendigkeit der Deutschen Revolution. Sie ist die geistige Umgestaltung, die wirtschaftlich, politisch und kulturell das Gesicht unserer Zeit bestimmt.
Wir bekennen uns zur Nation, sie ist uns letzter politischer Wert als schicksalsmäßiger Ausdruck volkhafter Gemeinschaft.
Wir bekennen uns zum Volk, also der artgemäßen Kulturgemeinschaft im Gegensatz zur volkszersetzenden westlerischen Zivilisation.
Wir bekennen uns zum Sozialismus, der nach Brechung der kapitalistischen Ordnung Volk und Nation in organischer Wirtschaftsgliederung bindet.
Die Verwirklichung unserer Ziele ist der großdeutsche Volksrätestaat als Ausdruck der Selbstverwaltung des schaffenden Volkes. Die Wirtschaftsmittel werden in den Gemeinbesitz der Nation überführt und das grundsätzliche Eigentum der Nation an Grund und Boden erklärt.
Daraus folgt: Nationalisierung aller Groß- und Mittelbetriebe, sofortige großzügige Besiedlung des Ostens, Vergebung von Kleinbauernstellen als Reichserblehen, Ersatz des römischen Privat-Rechtes durch das deutsche Gemeinrecht.
Der heutige Zustand fordert: Rücksichtslosen Kampf gegen alle außenpolitischen Versklavungsverträge von Versailles bis Young. Kampf gegen das die äußere Unfreiheit sanktionierende System von Weimar. Bündnispolitik mit der Sowjetunion. Unterstützung der revolutionären Bewegungen zur Schaffung der Einheitsfront aller unterdrückten Klassen und Nationen.
Der heutige Zustand erfordert die schärfste Durchführung des Klassenkampfes der Unterdrückten gegen alle, die das privatkapitalistische Dogma von der Heiligkeit des Eigentums vertreten. Das ist der einzige Weg zur deutschen Volksrevolution.
Zur Sicherung der Revolution gegen den Zugriff des internationalen Kapitals und gegen konterrevolutionäre Bestrebungen tritt an die Stelle des Söldnerheeres das revolutionäre Volksheer.“
Unter der Hand erklärte man sich jedoch bereit, Strassers 14 Thesen zumindest vorübergehend als gemeinsame Programmplattform anzuerkennen. Der Lagebericht der Polizeidirektion Nürnberg-Fürth von Ende Mai konstatierte bereits, Hitler ringe derzeit um die Einheit der NSDAP. "Die Kommenden" gossen reichlich Öl ins Feuer. Die Gründungstagung von Rosenbergs "Kampfbund für deutsche Kultur" wurde scharf ablehnend kommentiert: "Machen wir uns nichts weis darüber - der 'Kampfbund für deutsche Kultur' ist ein nationalsozialistisches Gewächs, und so war denn diese Tagung ein mehr oder weniger geschickt verschleierter Versuch, die deutsche Kultur nebst bündischer Jugendbewegung für die NSDAP einzufangen...Es war bezeichnend, dass ausgerechnet auf einer Kulturtagung von Religion überhaupt nicht die Rede war. Ersatz: nordischer Rassenfanatismus, der in seinen Auswüchsen zu einer dünkelhaften Verstiegenheit führt, die einen um die deutsche Kultur besorgten Menschen peinlich stimmen kann."
Am 27. Juni 1930 verkündete an gleicher Stelle der südwestdeutsche HJ-Führer Karl Baumann: "Es gibt für uns kein Vaterland mehr, das Deutschland heißt, in dem das Besitzbürgertum herrscht. Deutschland, das ist heute nichts weiter als der Begriff des Besitzes und Wohlstandes für die kapitalistische Bourgeoisie...Wir sehen unsere Aufgabe: Die Überwindung der Bourgeoisie im revolutionären Klassenkampf. (...) Es gibt für das deutsche Proletariat nur eine Lösung: Für ein sozialistisches freies Vaterland! Für ein Deutschland der Arbeiter und Bauern! Alle Macht den Räten! (...) Zerschlagt die Götzen des 19. Jahrhunderts! Zertrümmert mit uns die Ordnung, die nicht gottgewollt sein kann! Für Volk und Gemeinschaft! Für Freiheit und Sozialismus! Für ein Leben in Würde und Freiheit!“ Die entsprechende Ausgabe der "Kommenden" enthielt die Referate der GSRN-Gründungstagung und wurde bald als Broschüre mit einer Auflage von 4000 Exemplaren verbreitet.
 Zur gleichen Zeit wurde Otto Strasser von Hitler und Goebbels ausmanövriert und aus der NSDAP herausgedrängt. Dem pompösen Aufruf "Die Sozialisten verlassen die Partei" zum Trotz trennte sich nur eine Minderheit der NS-Linken als Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten (KGRNS) von der Mutterpartei – die meisten Gesinnungsgenossen der Sezessionisten verblieben innerhalb der Partei, wo sie auch weiterhin wichtige Funktionen bekleideten. Die Machtfrage wurde im Sommer 1934 von Hitler gestellt und mit der "Nacht der langen Messer" beantwortet. Als Vertreter der GSRN waren Artur Grosse, bislang Gauschulungsleiter für Berlin und Brandenburg sowie Mitglied der HJ-Reichsführung in Plauen, und Karl Baumann in der KGRNS untergebracht. Am 8. Juli gab die GSRN eine Kameradschaftserklärung für die KGRNS an: „Als faschistische Partei hat die NSDAP für uns jeden Anspruch verspielt, Sachwalter der Deutschen Revolution zu sein...Wir stehen nun da, wo man mit der Tat, nicht mit der Phrase das sozialistische Vaterland der Bauern und Arbeiter, die freie Nation in der Durchführung des Klassenkampfes der Arbeit gegen das internationale und das deutsche Kapital als Ausdruck der Weltanschauung unseres Jahrhunderts erkämpft.“
Zur gleichen Zeit wurde Otto Strasser von Hitler und Goebbels ausmanövriert und aus der NSDAP herausgedrängt. Dem pompösen Aufruf "Die Sozialisten verlassen die Partei" zum Trotz trennte sich nur eine Minderheit der NS-Linken als Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten (KGRNS) von der Mutterpartei – die meisten Gesinnungsgenossen der Sezessionisten verblieben innerhalb der Partei, wo sie auch weiterhin wichtige Funktionen bekleideten. Die Machtfrage wurde im Sommer 1934 von Hitler gestellt und mit der "Nacht der langen Messer" beantwortet. Als Vertreter der GSRN waren Artur Grosse, bislang Gauschulungsleiter für Berlin und Brandenburg sowie Mitglied der HJ-Reichsführung in Plauen, und Karl Baumann in der KGRNS untergebracht. Am 8. Juli gab die GSRN eine Kameradschaftserklärung für die KGRNS an: „Als faschistische Partei hat die NSDAP für uns jeden Anspruch verspielt, Sachwalter der Deutschen Revolution zu sein...Wir stehen nun da, wo man mit der Tat, nicht mit der Phrase das sozialistische Vaterland der Bauern und Arbeiter, die freie Nation in der Durchführung des Klassenkampfes der Arbeit gegen das internationale und das deutsche Kapital als Ausdruck der Weltanschauung unseres Jahrhunderts erkämpft.“
Sowohl KGRNS als auch GSRN scheiterten in ihrem Bestreben, sich als Auffangorganisationen für frustrierte Nationalsozialisten vor allem aus HJ und Studentenbund anzubieten. Die Reichsleitung der HJ erklärte "Die Kommenden" zum Feindblatt und untersagte ihren Bezug. Abschluss des Fiaskos war der Hinauswurf Paetels aus der Redaktion der "Kommenden", deren Verleger unter erheblichen wirtschaftlichen Druck geriet. Am 1. August 1930 veröffentlichte Paetel den Versuch einer Standortbestimmung: „Wo wir stehen? Überall da, wo die roten Fahnen der sozialistischen Revolution und die schwarzen Fahnen der deutschen Befreiung aufgepflanzt werden! Wir sind nicht ‚rechts‘ und nicht ‚links‘. Jeder gehört zu uns, von beiden Flügeln her, dem es um Deutschland und den Sozialismus geht. (...) Wir wissen, dass in der NSDAP, bei den ‚Revolutionären Nationalsozialisten‘, und in kommunistischen Kreisen Menschen unserer Haltung stehen, wissen, dass eine ganze Reihe kleinerer nationalistischer Bünde und Gruppen gleichen Losungen folgt, wissen sogar, dass mancher, den sein Schicksal in die politische ‚Mitte‘ verschlug, zu uns gehört - jenseits aller Parlamentsgeographie: mit ihnen stehen wir zusammen.
Wir stehen in der neuen deutschen Front, die sich formiert zum Aufstand der verproletarisierten Nation.
Von ‚links‘ und ‚rechts‘ stoßen Kameraden zu uns - eines Tages wird sich das Kader schließen. (...)
Bereit sein ist alles!
Bereit zu werden, unsere Aufgabe.“
Am 25. August 1930 veröffentlichte die KPD ihr nicht zuletzt auf die Initiative des oben erwähnten Heinz Neumann zurückzuführendes "Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes". Die Kommunisten rückten nationale Belange in den Vordergrund, um der NSDAP den nationalistischen Schneid abzukaufen und sie zugleich als scheinsozialistisch zu entlarven. Als Ziele wurden die Zertrümmerung der Versailler Nachkriegsordnung, die Annullierung der Auslandsschulden und Reparationen, die Sozialisierung von Banken, Großbetrieben und Großgrundbesitz sowie die Schaffung Sowjetdeutschlands als Alternative zu Faschismus, Kapitalismus, Feudalismus und Sozialdemokratie genannt. Ein wichtiger Angriffspunkt war selbstredend die reaktionäre Tendenz der Münchener NS-Zentrale, deren Rattenfängerei in den proletarisierten Gesellschaftsschichten gegeißelt wurde. Um die Haltung gegenüber dem neuen Kurs der KPD kam es nun zum offenen Bruch zwischen Paetel und Strasser.
Nachdem zuvor 2000 Kommunisten eine Versammlung der KGRNS in Berlin-Neukölln sprengten, wandte Paetel sich Anfang Oktober 1930 in den NS-Briefen an die KPD ("Meine Herren, worum geht es Ihnen?"). Die KPD-Führung wurde aufgefordert, die Nationalrevolutionäre als Verbündete zu akzeptieren. Ihre kurzsichtige Parteitaktik spiele lediglich die revolutionären Kräfte gegeneinander aus, anstatt gemeinsam das kapitalistische System zu stürzen. Im gleichen Atemzug kritisierte der GSRN-Wortführer jedoch Internationalismus und Materialismus der Kommunisten. Strasser wiederum distanzierte sich in der gleichen Ausgabe der NS-Briefe von Paetels Ansichten. Er stellte die KPD-Programmerklärung als taktischen Schritt hin und stilisierte ausgerechnet sich selbst zum einzigen "bolschewistischen Deutschen" empor. Nur der Revolutionäre Nationalsozialismus verkörpere den Nationalbolschewismus.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Bruno von Salomon propagierte offen Sabotage, Terrorismus und passiven Widerstand als Kampfmittel gegen den Weimarer Staat (um sich kurz darauf zusammen mit Bodo Uhse an die Gründung kommunistischer Bauernkomitees zu machen), und mit Strassers Kaderchef Wilhelm Korn verabschiedete sich ein Schlüsselmann der KGRNS zu den Kommunisten. Die Dissidenten machten zudem publik, dass Strasser Gelder aus dem preußischen Innenministerium kassierte, welches so eine Radikalisierung der Revolutionären Nationalsozialisten zu verhindern suchte. In der "Roten Fahne" kritisierte Korn Strassers letztlich auf Gewinnbeteiligungen beschränkten Sozialismusbegriff und seine Leugnung des Klassenkampfes. Der ehemalige Nationalsozialist sollte es noch bis zum Reichsinspekteur des Kampfbundes gegen den Faschismus, also der Nachfolgeorganisation des Roten Frontkämpferbundes, bringen.
5. "Die sozialistische Nation"
Anfang Januar 1931 begann Paetel die Herausgabe der Zeitschrift "Die sozialistische Nation" als neues Sprachrohr der GSRN. In personeller Hinsicht hatte es abgesehen von den Wortführern der Gründungszeit erhebliche Veränderungen gegeben – Jugendbewegte und frustrierte Nationalsozialisten wurden zumindest in Berlin von ehemaligen KPD-Mitgliedern in die Minderheit gedrängt. Die Auflage der neuen Zeitschrift schwankte zwischen 300 und 600 Exemplaren. Der Preis für finanzielle und damit politische Unabhängigkeit bestand in einer mehr als schlechten Aufmachung und eben geringer Auflagenhöhe. Im Gegensatz zu den zwischen national-sozialistischem Verbalradikalismus und völkischen Thesen hin- und herschwankenden meisten NR-Gruppen zeichnete "Die sozialistische Nation" sich durch ein ausgeprägtes theoretisches Verständnis der Dinge aus. Man forderte nicht nur die äußerste Konsequenz, sondern wollte diese auch ideologisch untermauern.
Nachdem die KPD Paetel und Strasser am 6. Januar 1931 auf eine Versammlung eingeladen hatte und dem GSRN-Leiter im Gegensatz zu letzterem einen freundlichen Empfang bereitete, erschien im Februar eine deutliche Ausgabe der "Sozialistischen Nation". Paetel propagierte den "Volkskampf" gegen den prokapitalistischen und reaktionären Faschismus, beharrte aber auf der ideologischen Unabhängigkeit der Nationalbolschewisten. Artur Grosse, aufsässiger Leiter der Strasserschen Jugendorganisation, erklärte: "Nationalbolschewismus heißt zuerst revolutionäre Praxis". Schulter an Schulter mit dem durch die KPD organisierten revolutionären Proletariat sollten die Nationalbolschewisten "die erforderlichen Schritte" unternehmen. Der republikanisch-kapitalistische Klassenstaat zersetze die deutsche Nation, die als verproletarisiertes Volk der Arbeiter, Bauern und Kleinbürger aufgefasst wurde. Marxens These von der universalen Verproletarisierung wurde angesichts von Weltwirtschaftskrise und Massenelend als zutreffend erachtet. Nationalbolschewismus bedeutete für Grosse die Ausrottung der bürgerlichen Klassenordnung. Wenige Tage später erwarb er das Parteibuch der KPD. Zur gleichen Zeit machte das 1. Reichstreffen der GSRN den Mitgliedern eine enge Zusammenarbeit mit der KPD und den ihr angeschlossenen Organisationen zur Auflage, womit vor allem die Mitarbeit im Kampfbund gegen den Faschismus gemeint war.
 Unübersehbar gewann die KPD an Anziehungskraft auf die entschlossensten Elemente der Grauzone zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Zu nennen ist hier vor allem die Hinwendung des wegen illegaler NS-Zellenbildung in der Reichswehr inhaftierten Richard Scheringer zur KPD. Die GSRN gab eine Ehrenerklärung für Scheringer ab, obwohl Paetel ihn von einer völligen Hinwendung zum Kommunismus abzuhalten suchte. Im März 1931 hieß es in der "Sozialistischen Nation": "Will Deutschland sein eigenes Gesicht wahren, bzw. wiedergewinnen, kann es das nur unter konsequentester Ausscheidung aller westlerischen Einflüsse. Gerät es dabei vorübergehend unter den starken Einfluss des Ostens, so ist das in Kauf zu nehmen angesichts der Tatsache, dass dieser Osten der natürliche Gegner auch unserer Feinde, der Westmächte ist. Das Schlagwort des Bolschewismus schreckt uns nicht – denn wir wissen, dass man den Westen nur mit seiner krassesten Antithese überwinden kann." Deutschland werde einst den "Mut zum Chaos" aufbringen müssen – der erwartete westliche Interventionskrieg gegen den einzigen sozialistischen Staat der Welt sollte das Signal zur sozialen Revolution im Reich sein, für den proletarischen Aufstand gegen die Versailler Ordnung. KPD und GSRN führten hier erstmals eine parallele Propagandakampagne durch.
Unübersehbar gewann die KPD an Anziehungskraft auf die entschlossensten Elemente der Grauzone zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus. Zu nennen ist hier vor allem die Hinwendung des wegen illegaler NS-Zellenbildung in der Reichswehr inhaftierten Richard Scheringer zur KPD. Die GSRN gab eine Ehrenerklärung für Scheringer ab, obwohl Paetel ihn von einer völligen Hinwendung zum Kommunismus abzuhalten suchte. Im März 1931 hieß es in der "Sozialistischen Nation": "Will Deutschland sein eigenes Gesicht wahren, bzw. wiedergewinnen, kann es das nur unter konsequentester Ausscheidung aller westlerischen Einflüsse. Gerät es dabei vorübergehend unter den starken Einfluss des Ostens, so ist das in Kauf zu nehmen angesichts der Tatsache, dass dieser Osten der natürliche Gegner auch unserer Feinde, der Westmächte ist. Das Schlagwort des Bolschewismus schreckt uns nicht – denn wir wissen, dass man den Westen nur mit seiner krassesten Antithese überwinden kann." Deutschland werde einst den "Mut zum Chaos" aufbringen müssen – der erwartete westliche Interventionskrieg gegen den einzigen sozialistischen Staat der Welt sollte das Signal zur sozialen Revolution im Reich sein, für den proletarischen Aufstand gegen die Versailler Ordnung. KPD und GSRN führten hier erstmals eine parallele Propagandakampagne durch.
Im Frühjahr 1931 griff die GSRN auch erstmals wieder in die internen Machtkämpfe innerhalb der NSDAP ein. Offenbar hatte die Gruppe ihre Hände bei den bis heute nicht geklärten Vorgängen um die sogenannte 2. Stennes-Revolte der SA gegen die Münchener Reichsleitung im Spiel. In jedem Fall traten Paetel, Gollong und Grosse in Verhandlungen mit den SA-Rebellen ein, um sie zur Zusammenarbeit mit dem Kampfbund gegen den Faschismus zu überreden. Infolge des würdelosen Verhaltens der Kommunisten bei der Beisetzung Horst Wessels lehnte ein Führerrat der Rebellen ein Zusammengehen ab – man einigte sich stattdessen mit Otto Strasser.
Durch den im Juni 1931 in der "Sozialistischen Nation" veröffentlichten Aufsatz "Revolutionäre Wehrpolitik" handelte Scheringer sich eine weitere Haftstrafe wegen "literarischen Hochverrates" ein. Der NS-Renegat erteilte Weimars prowestlicher Verständigungspolitik auf Kosten der Sowjetunion eine klare Absage. Ihm erschien die Reichswehr nur noch als entpolitisierte Polizeitruppe zur Niederhaltung der unruhigen Massen im vom internationalen Kapital kolonisierten Deutschland. Die NSDAP habe den revolutionären Weg des bewaffneten Aufstandes gegen Versailles bereits verlassen. Sie werde die Massen niemals für sich gewinnen, weil sie auf ihre sozialistischen Programmpunkte verzichtete. Hitler wolle den deutschen Kapitalismus retten, und die deutschen Kapitalisten würden niemals einen revolutionären Befreiungskrieg zulassen. "Wir erkennen, dass jedes Wort von nationaler Befreiung unter Beibehaltung des kapitalistischen Systems eine Lüge ist...Jeder Soldat, der das kapitalistische System im eigenen Lande stützt, kämpft infolgedessen gegen die Befreiung des deutschen Volkes....Der entpolitisierte Soldat ist eine Kreatur, ein willenloses Werkzeug in der Hand der herrschenden Klasse."
Als KPD-nahes Schwesterblatt der "Sozialistischen Nation" konnte der ab dem 1. Juli 1931 erscheinende "Aufbruch" angesehen werden. Zur Beeinflussung unorthodoxer Nationalisten schlug diese Zeitschrift unter der Herausgeberschaft Wilhelm Korns einen nationalkommunistischen Kurs ein. Nicht zuletzt auf Anregung Scheringers bemühte sich nun Hans Kippenberger als Leiter des illegalen M-Apparates der KPD um eine engere Zusammenarbeit mit den Nationalrevolutionären. Von dieser Öffnung des Kommunismus nach "rechts" sollte auch Paetel profitieren. Obwohl er die Zusammenlegung des "Aufbruchs" und der "Sozialistischen Nation" und die Chefredaktion des nationalkommunistischen Gesamtorgans ablehnte, orderte der Kampfbund gegen den Faschismus dennoch einige Hundert Abonnements des GSRN-Organs. Nach heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der GSRN stellte man sich jedoch gegen die kommunistische Bevormundung, und eine nach einem qualitativ hochwertigeren Intermezzo verschlechterte Aufmachung wies auf Ende der Finanzhilfe hin.
Als weiterer Vorteil erwies sich ein Machtkampf unter den Revolutionären Nationalsozialisten, der zahlreiche Aktivisten in die Reihen der GSRN hineintrieb. Paetel witterte hier Morgenluft, und im Herbst richtete die "Sozialistische Nation" heftige Angriffe gegen den als "Adolf II." charakterisierten Otto Strasser. Dessen Schwarze Front befinde sich durch ihre Ablehnung des Klassenkampfes und ihr kleinbürgerliches Zaudern vor dem "bolschewistischen Schritt in das Chaos" in einer "halbfaschistischen Reservestellung" verharrend. Strasser zeige sich ein weiteres Mal als nationalsozialistisch kompromittiert und verhindere die nationalbolschewistische Einheitsfront.
Diese wurde von der GSRN auch weiterhin angestrebt. Ab Ende 1931 arbeitete die Gruppe eng mit dem um die Zeitschrift "Der Gegner" entstehenden Kreis Harro Schulze-Boysens zusammen. Im Januar organisierte Paetel eine nationalbolschewistische Konferenz, an der Persönlichkeiten wie Ernst Niekisch vom "Widerstand", Werner Lass vom "Umsturz", Alexander Graf Stenbock-Fermor vom "Aufbruch" oder Bodo Uhse von den kommunistischen Bauernkomitees teilnahmen. Die weitere Hinwendung zur KPD wurde auch durch die vor den Reichspräsidentschaftswahlen vom Frühjahr 1932 ausgesprochene Empfehlung für den Kandidaten Ernst Thälmann dokumentiert. In einer im bewussten Gegensatz zu den Strasseristen und der Konservativen Revolution radikalisierten Fassung der Thesen der GSRN hieß es nunmehr: "Um der Nation willen, Rätedeutschland!"
Im Sommer 1932 übte Paetel sich vergebens in der Organisierung eines Kampfkomitees gegen Versailles mit kommunistischer Beteiligung – Heinz Neumanns Stern war bereits im Sinken begriffen. Den Beitritt des legendären Oberland-Kommandeurs Beppo Römer und anderer zur KPD kommentierte die "Sozialistische Nation" mit dem Wunsch, sie möchten ihre Weltanschauung nicht völlig umkrempeln. "Im Lager des konsequenten Sozialismus haben die nationalistischen Aktivisten die Aufgabe, Meldegänger der Nation zu sein, die Gewissheit der Unzerstörbarkeit des ewigen Deutschland als heimliches Losungswort weiterzugeben, (...) dem Aufstand gegen Versailles...die historische Legitimation zu geben." Der Klassenkampf wurde als organischer Führungsumbruch verstanden (wir erinnern hier an die Theorie Paretos von der Elitenzirkulation), der eine überalterte Führungsschicht durch neue unverbrauchte Kräfte ersetzte. Die mittlerweile beinahe geheimbündlerisch operierende GSRN betrieb die Zellenbildung in den Großstädten, um die von Hitler verratenen Kader des Jungnationalismus und des Nationalsozialismus, also den "deutschen Nationalkommunismus", dem revolutionären Proletariat an die Seite zu stellen.
Ein Beispiel dieser Zellenbildung ist die Beteiligung an einer vom Wedding ausgehenden Parteirevolte innerhalb des NS-Gaues Berlin. Das NSDAP- und GSRN-Doppelmitglied Heinz Gruber spaltete Teile der Berliner HJ angesichts einer einsetzenden Säuberung als Schwarze Jungmannschaft ab. Zu diesem Zeitpunkt stellten die "Hammerschläge", die Schulungsblätter der Berliner HJ, bereits ein Tarnorgan der GSRN dar. Mit Doppelmitgliedschaften wie im Fall Gruber übte die Paetel-Gruppe starken Einfluss auf beinahe ein Drittel der Berliner HJ aus. Paetels Bekanntheitsgrad nahm seit April 1932 kontinuierlich zu: Wie vor einigen Jahren Ernst Jünger, so öffneten ihm bürgerliche Blätter wie die "Literarische Woche", die "Weltbühne" und "Das Tagebuch" ihre Spalten und suchten die offene Diskussion mit dem als NR-Chefideologen angesehenen Publizisten.
6. Widerstand gegen Hitler und Adenauer
Die Zeichen der Zeit wurden von der GSRN schon ab Spätherbst 1932 erkannt. Die Umstellung auf Doppelmitgliedschaften und Unterwanderung war ein erstes Signal der Vorbereitung auf eine Hitler-Diktatur. Neben der GSRN stellten sich nur die Kommunisten bereits auf eine Phase illegaler Tätigkeit um. Die Sozialrevolutionären Nationalisten setzten auf die Selbstentlarvung des in die Reichskanzlei einziehenden Hitler und agitierten vor allem unter dem unzufriedenen linken Parteiflügel. Diese Propaganda wurde durch seit Herbst 1932 einsetzende Zerfallstendenzen der NSDAP und der SA erleichtert – Hitler hatte im Dezember Gregor Strasser aus der Partei hinausgedrängt und mit der Reichsorganisationsleitung das zentrale Steuerungsorgan der NS-Organisationen zerschlagen.
Ungeachtet einer Warnung der mit den Nationalbolschewisten sympathisierenden SA-Legende Hans Maikowski eröffnete die GSRN ihre Kundgebungswelle am 5. Februar 1933 in Berlin-Charlottenburg. Mitte des Monats erklärten sich rund 20 Führungskader der Berliner HJ zum Bruch mit der NSDAP bereit, aber Paetel legte seinen Sympathisanten weiterhin die Unterwanderung der Parteigliederungen nahe. Nach kommunistischem Vorbild dezentralisierte sich die GSRN in Fünfergruppen, und alle nicht öffentlich bekannten Aktivisten traten als Doppelmitglieder NS-Organisationen bei. Trotz einer einsetzenden Verfolgung durch Hitleristen und staatlichen Repressionsapparat ging die Kopfstärke der GSRN nicht zurück, sondern steigerte sich (wie auch diejenige der Revolutionären Nationalsozialisten) sogar. Paetel war auch an verzweifelten Versuchen beteiligt, für die Reichstagswahlen des 5. März 1933 eine nationalrevolutionäre Liste unter Ernst Niekisch und dem Bauernführer Claus Heim zustandezubringen. Grubers Schwarze Jungmannschaft als de facto-Jugendorganisation der GSRN vereinbarte mit Sozialistischer Arbeiterjugend, dem kommunistischen KJVD und linksbündischen Gruppen wie der legendären d.j. 1.11. gegenseitige Achtung und Zusammenarbeit gegen Hitler.
Am 25. Februar 1933 beschlagnahmte die Polizei Paetels "Nationalbolschewistisches Manifest" größtenteils in der Druckerei: "In den Umrissen proklamiert der deutsche Nationalkommunismus: Wir erkennen die Notwendigkeit der deutschen sozialistischen Revolution. Sie ist die geistige Umgestaltung, die wirtschaftlich, politisch und kulturell das Gesicht unserer Zeit bestimmt, sie ist praktisch die Revolution der Arbeiter, Bauern und verproletarisierten Mittelschichten." Die GSRN bekannte sich zur Nation als Kulturgemeinschaft im Gegensatz zur westlichen Zivilisation. "Wir bekennen uns zum planwirtschaftlichen Sozialismus, der nach Brechung der kapitalistischen Ordnung Volk und Nation und organischer Wirtschaftsgliederung bindet und als Gemeinwirtschaft die Grundlage der staatlichen Souveränität bildet. Die Verwirklichung unserer Ziele ist der freie großdeutsche Volksrätestaat als Ausdruck der Selbstverwaltung des schaffenden Volkes." Gefordert wurden im krassen Gegensatz zur prokapitalistischen Wirtschaftspolitik Hitlers die Sozialisierung aller industriellen Groß- und Mittelbetriebe, die Enteignung des Großgrundbesitzes, eine Agrarreform durch Ansiedlung von Kleinbauern und Errichtung sozialisierter Staatsgüter, das staatliche Außenhandelsmonopol, die Verstaatlichung des Bankensektors, engste wirtschaftliche, politische und militärische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, die Unterstützung auch ausländischer revolutionärer Bewegungen und die Schaffung der Einheitsfront aller unterdrückten Klassen und Nationen. "Kampf gegen das die äußere Unfreiheit sanktionierende System von Weimar, reichend von Hilferding zu Hitler, bis zu seiner Vernichtung...Der heutige Zustand erfordert: Die schärfste Durchführung des Klassenkampfes der Unterdrückten gegen alle, die das privatkapitalistische Dogma von der Heiligkeit des Eigentums vertreten. Das ist der einzige Weg zur deutschen souveränen sozialistischen Nation...Zur Erreichung dieser Ziele ist heute notwendig: Kampfgemeinschaft mit der Partei des revolutionären Proletariats, der KPD."
Die Verfolgungsmaßnahmen des sich konsolidierenden NS-Regimes gegen den sozialistischen Widerstand inner- und außerhalb der Parteigliederungen griffen ab dem Spätsommer 1933 zusehends. Karl O. Paetel wurde noch vor Jahresende aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und verlor somit das Recht, in Deutschland zu publizieren. Der mit seiner Schwarzen Jungmannschaft mittlerweile innerhalb der Deutschen Arbeitsfront untergetauchte Gruber wurde im Januar 1934 zusammen mit einer Reihe von Aktivisten der d.j. 1.11. verhaftet. Im Zusammenhang mit der brutalen Vernichtung unruhiger Elemente innerhalb der SA, die sich auch auf andere Organisationen und Widerstandsgruppen ausweitete, tauchte Paetel im Sommer 1934 vorübergehend in Mecklenburg unter. Als offizielle Fortsetzung der "Kommenden" und getarntes Organ der GSRN und den "Gegner"-Kreises erschien ab dem 15. Juli 1934 die Zeitschrift "Wille zum Reich". Hier konnte Paetel unter seinem Pseudonym Wolf Lerson bis zum Verbot des Blattes 1935 eine Reihe von den real existierenden Nationalsozialismus kritisierenden Aufsätzen zur Typologie des internationalen Faschismus veröffentlichen und an das von Gestalten wie Schirach vergewaltigte politische Erbe der nationalrevolutionären Jugend erinnern.
Nach einer vorübergehenden Verhaftung im Januar 1935 setzte Karl O. Paetel sich auf der Stelle in die Tschechoslowakei ab, wo sich Prag zu einem Zentrum nationalrevolutionärer Exilanten entwickelt hatte. Die Reste der GSRN führten die Zusammenarbeit mit Harro Schulze-Boysens "Gegner"-Kreis weiter, mit dessen Hilfe Paetel sich im Sommer 1935 nach einem illegalen Aufenthalt in Deutschland nach Skandinavien absetzen konnte. Auf deutschen Druck (nach Veröffentlichung eines Aufrufes zur Unterstützung der spanischen Volksfront) aus Schweden ausgewiesen, reiste der nationalrevolutionäre Emigrant im Oktober 1936 via Polen erneut nach Prag, um Anfang 1937 eine Aufenthaltsgenehmigung für Frankreich zu erhalten. Hier arbeitete er an Willi Münzenbergs "Deutschem Freiheitssender" mit. Von Stockholm, Paris und Brüssel aus gaben Paetel und einige Mitarbeiter als Auslandsbüro der GSRN nun die "Blätter der sozialistischen Nation. Rundbriefe für sozialistische und nationalsozialistische deutsche Politik" heraus.
Durch Kontakte zu Vertretern der linksbündischen Untergrundorganisation d.j. 1.11. konnte wieder eine engere Verbindung zum innerdeutschen Widerstand hergestellt werden. Gemeinsam mit dem d.j.-Vordenker Eberhard Koebel (tusk) wies Paetel die Forderung der Kommunistischen Jugendinternationale nach politischer Unterordnung des gesamten Jugendwiderstandes unter die Parteidoktrin zurück. Ein nicht zuletzt von Paetel organisiertes größeres Treffen bündischer Widerstandskämpfer am Rande der Pariser Weltausstellung im August 1937 brachte die Gestapo auf die Fährte des bündischen Untergrundnetzes und hatte zahlreiche Verhaftungen und Terrorurteile zur Folge.
Im April 1939 entzog das Reichsinnenministerium Karl O. Paetel die deutsche Staatsangehörigkeit, und kurz darauf wurde er als Hochverräter in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Nachdem die Wehrmacht im Sommer 1940 Westeuropa überrannt hatte, übergab die Reichsregierung den französischen Behörden eine Auslieferungsliste mit gefährlichen Regimegegnern. Unter den 101 Namen stand Otto Strasser an 1. Stelle, Paetel bekleidete immerhin den 5. Rang. Über Spanien und Portugal gelang dem Gesuchten wie seinem Rivalen Strasser die Flucht nach Nordamerika.
Bevor Paetel sich endgültig von der politischen Bühne verabschiedete, erfolgte nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ein neuer Versuch, den Traum von einer "Dritten Front" der Jugend zu verwirklichen. Im November 1947 trafen im Haus Altenberg bei Köln die Vertreter von Jugendverbänden aus allen Teilen des besetzten und zerstückelten Deutschland zusammen, um die Möglichkeit einer interzonalen Zusammenarbeit zu besprechen. Heinz Gruber als Paetels Vertreter versuchte vergebens, die sich öffnenden Gräben zwischen den kirchlichen und sozialdemokratischen Jugendverbänden einerseits und der durch Erich Honecker vertretenen FDJ andererseits zu überbrücken.
Auch nach dem Scheitern der Konferenz setzten sich Paetel, Gruber und Grosse weiterhin für die Schaffung eines deutschen Europäertums zwischen dem kapitalistischen Westen und dem stalinistischen Osten ein. Ein letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Verzicht auf die Ziele eines 30jährigen Kampfes war die Konferenz auf Burg Ludwigstein vom Januar 1954. Hier trafen Veteranen aus Bündischer Jugend, Nationalsozialismus und Widerstand zusammen und beschlossen ein gemeinsames Engagement im neutralistischen Widerstand gegen die Wiederaufrüstung und Westintegration der separatistischen BRD. Mit dem Parteiverbot gegen die KPD und der systematischen Kriminalisierung außerparlamentarischer Bewegungen durch das reaktionäre Adenauer-Regime scheiterte auch dieser letzte Versuch, ein unabhängiges und sozialistisches Deutschland zu schaffen.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, années 30, socialisme, nationalisme, nationalisme révolutionnaire, histoire, politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 novembre 2009
Lucio Caraciolo: De l'autonomie du point de vue géopolitique
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Entretien avec Lucio Caracciolo, directeur de la revue Limes (Rome)
De l'autonomie du point de vue géopolitique
Pendant très longtemps il était politiquement incorrect de parler de géopolitique. Les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'urgence de dénazifier l'Europe avaient associé de façon exclusive cette importante discipline scientifique aux théories du Lebensraum (de l'espace vital) propagées par les théoriciens du Reich hitlérien. Finalement en Italie aussi, depuis quelque années, on peut à nouveau approcher cette discipline avec sérénité notamment grâce à une excellente revue trimestrielle de géopolitique, Limes, dirigée par Lucio Caracciolo. Dans le sillage du succès qu'elle a obtenu, de plus en plus souvent des publications à caractère géopolitique paraissent dans les librairies. La dernière en ordre chronologique est le Glossaire de géographie et de géopolitique (Société Editrice Barbarossa), éditée par Enrico Squarcina. Sur les thématiques géopolitiques, nous avons interviewé le directeur de Limes.
Docteur Caracciolo, pouvez-vous nous résumer les contenus et les finalités de cette discipline?
Quand Michel Korinman, qui dirige avec moi Limes, m'a soumis le projet de lancer une revue italienne de géopolitique (depuis novembre 1996 nous avons une édition jumelle en France), nous avons expliqué immédiatement, à nous-mêmes et aux amis qui ont voulu participer à cette aventure, les termes originaux de notre approche. Nous n'avons pas la prétention d'élaborer les lois de l'histoire et encore moins de faire de la “science”. Beaucoup plus modestement, nous essayons d'analyser des cas particuliers dans des conflits de pouvoir sur base spatiale, donc pouvant être reproduits cartographiquement. Nous ne pensons pas pouvoir généraliser les cas singuliers en constantes universelles. Nous préférons examiner la façon dont les différentes parties en conflit —pacifique ou militaire— mandatent et utilisent des représentations politiques respectives pour réaliser leurs projets. Par exemple: Grande Serbie contre Grande Croatie, ou même Padanie contre Italie, et cela en nous efforçant de mettre les parties dans le même plan moral, même s'il est clair que chacun de nous a ses préférences et ses idées. C'est pourquoi dans Limes vous trouverez des points de vue de droite et de gauche, des positions laiques ou religieuses émanant de personnalités différentes quand elles ne sont pas carrément opposées, depuis Romano Prodi à Gianfranco Miglio, de Luciano Canfora à Virgilio Ilari, de Geminello Alvi à Sergio Romano. Ce n'est qu'en les confrontant dans leur dynamicité qu'on peut comprendre les raisons des uns et des autres.
En cette époque de globalisation, la conception de «nation» a-t-elle encore une signification quelconque? L'Italie peut-elle être considérée une nation à part entière?
Il est certain que la nation est toujours très importante. Et il est tout aussi vrai que l'Etat national, en tant qu'objet de relations internationales, compte toujours beaucoup. Mais je reste très prudent quand il s'agit de définir notre époque actuelle comme l'“époque de la globalisation”. Laissons aux historiens du futur le soin des interprétations. Il est clair que la croissance de l'interdépendance économique et culturelle multiplie les sujets géopolitiques. Aujourd'hui nous avons des régions, des provinces et même des villes possédant une vision géopolitique propre, et pour légitimer ces visions, elles aiment se donner le nom de “nations”. C'est le cas, entre autres, de la Padanie, dont je n'ai pas encore bien cerné le territoire (mais dans ce cas c'est moi qui devrait vous interviewer...).
Pour ce qui est de l'Italie, c'est une nation qui existe, en tant qu'Etat, depuis seulement 136 ans, même si l'idée d'Italie a 2000 ans d'histoire: elle descend de la réforme géopolitique de l'empereur Auguste dans le cadre de l'empire romain. Je ne connais pas beaucoup de nations aussi profondément enracinées dans le passé, sauf la Chine. Je suis convaincu que l'Italie durera encore longtemps, même si je n'ai pas de mal à imaginer une nation italienne intégrée dans un Etat européen.
Dans le dernier numéro de Limes, vous vous occupez de la politique étrangère de la Ligue du Nord en affirmant qu'elle se base sur les principes de l'ethno-fédéralisme. Vous citez aussi une pensée de Bossi: «C'est dans la nation, c'est-à-dire au sein d'un peuple ethniquement homogène, qu'on peut agir pour le mieux, mus par un meilleur élan affectif». Quelle est votre opinion?
 La philosophie néo-existentialiste du sénateur Bossi dépasse largement mes facultés d'intelligibilité. Personnellement, j'éprouve un élan affectif majeur dans une relation amoureuse plutôt que dans le rapport avec ma nation. De plus, j'ai le vilain défaut de ne pas adhérer aux principes de l'ethno-fédéralisme, peut-être parce qu'en dépit de tous mes efforts, je ne les comprends toujours pas. Par ma nationalité, je suis italien, mais cela ne me suffit pas pour reconnaître les Italiens comme un peuple ethniquement homogène. Je ne sais pas trop ce qu'est une nation ethnique mais je suis certain que si elle devenait cette nation, je partirais ailleurs. Je suis encore partisan de l'idée qu'un état ethnique ne peut pas être un état libre et démocratique. Mais je n'ai pas la prétention de convaincre les liguistes et je suis très curieux d'entendre leurs argumentations.
La philosophie néo-existentialiste du sénateur Bossi dépasse largement mes facultés d'intelligibilité. Personnellement, j'éprouve un élan affectif majeur dans une relation amoureuse plutôt que dans le rapport avec ma nation. De plus, j'ai le vilain défaut de ne pas adhérer aux principes de l'ethno-fédéralisme, peut-être parce qu'en dépit de tous mes efforts, je ne les comprends toujours pas. Par ma nationalité, je suis italien, mais cela ne me suffit pas pour reconnaître les Italiens comme un peuple ethniquement homogène. Je ne sais pas trop ce qu'est une nation ethnique mais je suis certain que si elle devenait cette nation, je partirais ailleurs. Je suis encore partisan de l'idée qu'un état ethnique ne peut pas être un état libre et démocratique. Mais je n'ai pas la prétention de convaincre les liguistes et je suis très curieux d'entendre leurs argumentations.
Pouvez-vous vous exprimer sur le projet de créer des “eurorégions”, dans le style de celle souhaitée depuis longtemps par les Tyroliens?
Je ne suis ni favorable ni totalement défavorable aux eurorégions en tant qu'idée abstraite. Ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les eurorégions singulières et, surtout, l'usage géopolitique qu'on en fait. Comment être contre ce projet, lorsqu'il s'agit de renforcer les liens économiques entre pays voisins ou d'améliorer les infrastructures de connexion entre frontières? Par contre, je suis préoccupé par le projet d'eurorégions qui, de façon claire ou occulte, remet en question les frontières européennes actuelles, en favorisant le surgissement de nouveaux murs sur le Continent. Si, par exemple, la création de l'eurorégion Tyrol signifie en clair rouvrir le contentieux entre l'Italie et l'Autriche, alors je suis totalement contre.
Est-ce que la présence de l'OTAN sur le territoire européen est encore justifiée? Que pensez-vous de l'élargissement de l'Alliance Atlantique?
L'OTAN représente une Amérique européenne et une Europe américaine. Je suis persuadé qu'après la fin de l'URSS nous avons encore besoin d'une présence américaine en Europe, pas tellement pour faire face à une invasion en provenance de l'Est mais plutôt pour stabiliser le Continent et éteindre les foyers de guerre, surtout dans l'aire adriatico-balkanique. Evidemment, nos intérêts ne correspondent pas toujours à ceux des Américains, c'est pourquoi nous devons faire entendre notre voix au sein de l'Alliance, tout en sachant que le poids qui donne la mesure est toujours l'Amérique. Quelle alternative? Une superpuissance Européenne? Une Allemagne comme superviseur du Continent? Mieux vaut rester sérieux et chercher à cultiver un rapport atlantique tant que ça dure. Je suis contre l'élargissement de l'OTAN pour plusieurs raisons (nouvelles divisions au cœur de l'Europe, humiliation gratuite de la Russie, marginalisation de l'Italie), mais surtout parce que je crains que cela n'entraîne un relâchement dans l'Alliance, donc une dégradation évidente de son bon fonctionnement. Cela finirait par donner de bons arguments à ceux qui, en Amérique, veulent liquider l'OTAN.
Des courants de pensée plutôt critiques vis-à-vis d'une future unification monétaire commencent à se propager. Pensez-vous qu'une Europe principalement économique et monétaire sera profitable aux peuples?
Le dernier volume de Limes est consacré à cette problématique. Personnellement, plus j'y pense et plus je doute que l'Euro puisse servir à unir l'Europe. Au contraire, après Maastricht (mais pas uniquement à cause de Maastricht), je vois croître les tendances désagrégatrices, les particularismes, les nationalismes, l'inaptitude à trouver un point de médiation entre les intérêts nationaux. De ce fait, dans la meilleure des hypothèses, la préférence ira au projet anglais (aujourd'hui soutenu aussi par les Allemands) qui préconise une grande aire de libre-échange qui s'étend de l'Atlantique aux Balkans. Projet aussi légitime (et peut-être même réaliste...) qu'éloigné de l'idée classique d'Europe.
Limes s'est souvent préoccupé des rapports entre les Européens et le monde islamique. D'après vous, à quels scénarios pouvons-nous nous attendre dans un futur rapproché?
 Je ne connais pas le futur, mais je crains que la schématisation du conflit de civilisation, inventé par le politologue américain Samuel Huntington, puisse un jour prévaloir. Si on suivait ce type de raisonnement, tout le monde serait perdant, aussi bien les Européens que les Islamiques. En outre, il n'existe pas d'ensemble géopolitique spécifique pour la détermination du monde islamique et nous n'avons aucun intérêt à promouvoir sa création. Si je peux avancer une suggestion, je dirais qu'il faut éviter à tout prix que le rapport avec le monde arabe et le monde islamique soit géré par des soi-disant experts (largement rémunérés), qui nous empêchent d'entendre la véritable voix des Arabes et des Islamiques.
Je ne connais pas le futur, mais je crains que la schématisation du conflit de civilisation, inventé par le politologue américain Samuel Huntington, puisse un jour prévaloir. Si on suivait ce type de raisonnement, tout le monde serait perdant, aussi bien les Européens que les Islamiques. En outre, il n'existe pas d'ensemble géopolitique spécifique pour la détermination du monde islamique et nous n'avons aucun intérêt à promouvoir sa création. Si je peux avancer une suggestion, je dirais qu'il faut éviter à tout prix que le rapport avec le monde arabe et le monde islamique soit géré par des soi-disant experts (largement rémunérés), qui nous empêchent d'entendre la véritable voix des Arabes et des Islamiques.
Croyez-vous qu'il existe une possibilité quelconque pour que les nations voisines, telles l'Allemagne et l'Autriche, reconnaissent un jour la Padanie indépendante?
Dans Limes vous trouverez des idées très divergentes sur la Padanie, y comprises naturellement celles de ses supporters. Nous avons même demandé au sénateur Bossi le privilège d'un entretien géopolitique sur la Padanie, dans le but d'expliquer clairement cet chose mystérieuse. Par exemple: quelles sont ses frontières? Comment pense-t-il légitimer son indépendance et se détacher du reste de l'Italie? Comment est-il possible de désagréger l'Italie tout en intégrant l'Europe? Je souhaite que bientôt le sénateur Bossi veuille apporter réponse à ces questions en nous honorant d'un interview. Quant à la reconnaissance de la Padanie de la part de l'Autriche et de l'Allemagne, j'ai bien peur que cela ne relève la possibilité zéro, à moins d'être d'accord pour briser l'Union Européenne ou d'imaginer un consensus italien à l'indépendance padane.
(propos recueillis par Gianluca Savoini pour le journal Padania, Milan).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, revue, italie, stratégie, politique internationale, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 novembre 2009
Mei '68: de mythe, de realiteit, en de hormonen

Mei ’68: de mythe, de realiteit, en de hormonen
Lezing gegeven in het Vlaams Parlement, 17 mei 2008
Johan Sanctorum / http://www.visionair-belgie.be/
Van kostschoolopstand tot teletubbie-dictatuur
Ik dank de organisatoren van dit colloquium voor de uitnodiging. Een ook ter linkerzijde goed aangeschreven filosoof erbij halen, het blijft een risico, je weet nooit wat de man gaat vertellen, en het pleit alleszins voor de breeddenkendheid van de initiatiefnemers. En dat cordon sanitaire doorkruisen,- het blijft zoals U weet een geliefde hobby van me.
Ik zal het vandaag kort hebben over drie zaken die me nauw aan hart liggen,- en ik denk dat ik ook voor het grootste deel van deze achtbare vergadering mag spreken,- namelijk politiek, cultuur en sex.
Mei ’68, het betekent voor ieder van ons iets anders, in zoverre zelfs, dat ik me afvraag of het wel als algemeen begrip de geschiedenis zal halen. Ik was toen veertien en herinner me vaag zwart-wit TV beelden van Franse studenten die met straatkasseien gooiden, Sovjettanks in Praag, gitaarspelende hippies in Berkeley, anti-Viëtnambetogingen zowat overal, kabouters in Amsterdam, en niet te vergeten: de tirades tegen het establishment vanwege studentenleider Paul Goossens in Leuven, naderhand topfiguur van datzelfde politiek-cultureel establishment, en onlangs door heel de pers uitgewuifd als gepensioneerd Belga-journalist.
Die metamorfose van rebel tot boegbeeld van een ‘links-progressieve’ elite, daar heb ik het straks nog over. Maar wat hebben al deze evenementen, van Praag tot Berkeley, eigenlijk gemeen? Vrijwel niets. Behalve dat ze zich allemaal in het jaar 1968 afspeelden en schone plaatjes opleverden. Het zijn eigenlijk vooral de media, met het nieuwe medium televisie op kop, die er een verzamelnaam aan gegeven hebben, als hing er toen wereldwijd iets in de lucht. En het zijn ook de media die vandaag hun archieven oprakelen om dit non-event met een nostalgisch parfum te besproeien. De ’68-gebeurtenissen leverden immers de beste TV-beelden van die decade op, naast de Vietnam-oorlog natuurlijk. De mediatieke hype die zo gecreëerd werd, vanuit een aantal onsamenhangende gebeurtenissen, leidde tot een historische mythe waar de protagonisten zelf in gingen geloven. Tot op vandaag.
Er stelt zich dan ook een dringende behoefte aan een kritische lezing van de feiten en een demystificatie van het begrippenkader. Een poging dus tot echte historische kritiek die ballonnen doorprikt, mechanismen ontrafelt en processen reconstrueert. Uit die reconstructie blijkt namelijk vooral de inhoudelijke leegte, de gewichtloosheid en het Narcistisch-puberaal karakter van heel dat Franse mei-68 gebeuren. Het heeft een hypotheek heeft gelegd op het politiek bewustzijn van vandaag, ons taalgebruik, de beeldcultuur, de zogenaamde vrije sexuele moraal. Het dient overigens gezegd dat tenoren uit de Franse denkwereld, zoals de psychoanalyticus Jacques Lacan, ook al die ballon doorprikt hebben. In 1969 al sneerde hij zijn Maoistische studentenpubliek toe dat ze het woord 'revolutie' hebben uitgehold en dat ze binnenkort dat establishment, waartegen ze zo tekeer gingen, zouden overnemen. Profetische woorden...
Neem nu inderdaad het woord ‘revolutie’ zelf. Het is niet toevallig dat sinds die periode alles en iedereen zich ‘revolutionair’ is beginnen noemen,- de weergaloze inflatie van deze term weerspiegelt al het licht soortelijk gewicht van de politieke statements uit die tijd. Sinds het ultrafijn borsteltje dat Chanel bij de mascara ‘Chanel Inimitable’ meelevert, door de producent zelf als ‘revolutionair’ wordt bestempeld, is het misschien nuttig om dat woord eens tot zijn essentie te herleiden.

Historisch gezien zijn er namelijk maar twee vormen van authentieke revoltes, namelijk de hongeropstand en de vrijheidsbeweging. Op straat komen omdat Uw kinderen van de honger creperen, dàt is een goede reden om met kasseien te gooien. Ik ben in dat opzicht een Marxist. De tirannenmoord anderzijds, een instinctief-liberaal vrijheidsgebaar tegen de verknechting, is een tweede archetype van de revolte. De Franse revolutie van 1789 verenigde die twee, dat gaf haar het historisch momentum. Wat men achteraf ook moge beweren: de intellectuelen liepen er maar achter, en zaten op café toen de hongerige meute de Bastille bestormde.
Honger en/of verknechting. De maag en het hart. De probleempjes van de Grote Revolutie ontstaan echter daar, waar er eigenlijk geen objectieve voorwaarden voor de revolte aanwezig zijn, maar waar de jeugdige hormonen toch beginnen op te spelen. Op dat moment ontstaat er een soort verkleutering, tot op een niveau van kinderachtige charades, collectieve verbrandingssessies van testosteron, Narcistische opflakkeringen van gelegenheidsredenaars, allerlei ludieke acties rond ‘emancipatie’-issues, kat-en-muisspelletjes met de politie om toch maar de schijn van een repressief klimaat te creëren in de hoop dat er eentje zijn matrak bovenhaalt en er een TV-camera in de buurt is, kortom: er wordt een virtuele realiteit gecreëerd die, in het geval van mei-68, zichzelf opblies tot ‘een historisch moment’. En omdat er geen honger in het spel was, en eigenlijk ook geen echte repressie, althans niet in het 'revolutionaire' epicentrum Parijs, bedacht men ter plekke dan maar een derde soort revolte die hier van toepassing leek, nl. de 'culturele revolutie'. Een lege doos, zo blijkt nu.
Want uit heel de reconstructie van het discours uit die dagen blijkt, hoe de jongens en meisjes wanhopig zochten naar een politiek-culturele legitimatie voor hun hormonenopstoot. We weten ondertussen allemaal hoe het is begonnen: in Nanterre wilden de mannelijke kotstudenten op de meisjesslaapkamers geraken. Een kostschoolopstand, als het ware. Pas toen dat niet lukte, werden de grote retoriek en het revolutionaire programma bovengehaald. Het staat inderdaad nogal idioot om het aftreden van een regering te eisen omwille van vlinders in de buik. Men afficheerde het dus als een ‘culturele revolutie’, een algemene Umwertung aller Werte, een zaak van vrouwenemancipatie, sexuele vrijheid, artistieke vrijheid, om tenslotte zelfs de arbeiders in de Renault-fabrieken wijs te maken dat dit hun strijd was
De ironie van de geschiedenis is dus, dat er rond 1968 een aantal min of meer authentieke verzetsbewegingen het nieuws haalden (de Praagse Lente, de anti-Vietnamdemonstraties, Leuven-Vlaams…), maar dat het meest gemediatiseerde feit, datgene waarvan de beelden heel de wereld rondgingen, nl. de Parijse studentenopstand, weinig meer was dan een hormonaal aangestuurd straattheater.
Los van bv. de gebeurtenissen in Praag en het protest tegen de Vietnamoorlog, vormden de Parijse studentenrellen van mei ’68 in essentie weinig meer dan een ludieke vadermoord, een uit de hand gelopen testosteron-opstoot vanwege een zorgeloze jeugd met tijd teveel. De zoektocht naar een politieke legitimatie voor deze quasi-revolutie eindigde in een volstrekt leeghoofdig ‘progressisime’, dat op zijn beurt de politiek-correcte ideeëndictatuur van de jaren ’90 zou voortbrengen. Het handhaven van deze bewustzijnsvernauwing was dé voorwaarde voor de ’68-generatie om haar politieke en culturele machtsgreep te bestendigen.
Ik denk dat de leugen, die toen al in het verhaal zat, zijn eigen leven is gaan leiden en zichzelf heeft versterkt, doorheen de tijd, tot diep in de jaren ’90-, met als apotheose bij ons het aantreden van 'paars'.
Want het tweede groot probleem dat zich stelde voor de protagonisten van die onnavolgbare Chanel-generatie, na de politieke legitimatie van de testosteronrevolte, is het moment waarop ze als veertigers en vijftigers zelf aan de macht kwamen. Toen moesten de Vandenbrouckes, de Van de Lanottes en de Van den Bossches, die in hun jonge tijd nog met het rode boekje van Mao hadden gezwaaid en nu hun ‘lange mars door de instellingen’ beloond zagen met een buikje, een ministerpost, en tenslotte een functie van gedelegeerd bestuurder bij BIAC, beletten dat hun lege doos werd opengedaan,- de doos van een tot jeugdsentiment verworden kostschoolopstand. Hoe konden de contestanten van weleer beletten dat ze zelf gecontesteerd werden?
Daartoe moest het huidige regime van de oud-'68-ers bijna voorgesteld worden als een verwezenlijkte utopie, de beste der mogelijke werelden waar zij zogezegd voor op de barrikaden hadden gestaan, en die zij nu ook rechtmatig mochten besturen. Deze buikjesdans van oudstrijders heeft een specifiek en subtiel soort onverdraagzaamheid opgeleverd. Het is namelijk in deze teletubbie-sfeer van verplichte blijdschap en het eeuwigdurende carnaval dat het ‘politiek-correcte’ discours is ontstaan: een complex van retorische en semantische kunstgrepen, censuur en zelfcensuur, waardoor vrijheid en bevoogding elkaar perfect overlappen. Het resultaat was een soort mainstream-progressiviteit die vooral gericht was op het onderdrukken van tegenstromen, het afstoppen van externe vraagstelling (‘waar zij we eigenlijk mee bezig?’) en het ontmoedigen van historische kritiek.
De eerste leugen (de mythe van de 'culturele revolutie') werd dus toegedekt met een tweede leugen (de demonisering van elke fundamentele dissidentie). Om te beletten dat er fundamentele vragen zouden gesteld worden rond die speeltuinrevolutie en haar politieke travestie, moest de euforische logica van de bezette meisjesslaapzaal ook in alle geledingen van de maatschappij doorgetrokken worden. Alles wat daarbuiten viel, was fout, politiek-incorrect, ondemocratisch, rechts, extreemrechts, racistisch, sexistisch, fascistisch enz.
Mei '68 heeft ons niet bevrijd, het heeft alleen de vrijheid tot sloganeske sluier verheven, die breed gedrapeerd is over de repressiemechanismen van de postmoderne netwerkstaat, de fluwelen logedictatuur, de democratie van de kiesdrempels, de cordons sanitaires en de politieke processen.
Mei '68 riep zichzelf eerst uit tot het jaar nul, het begin van een nieuwe tijdrekening, maar stremde gaandeweg tot het einde van de geschiedenis, het jaar 1984 van Big Brother. Binnen dit postmodern paradigma wordt elke kritiek zinloos en zijn de machthebbers tegelijk de behoeders van de vrijemeningsuiting via hun ingenieuze newspeak. Paars heeft dat procédé van de taalmanipulatie en de bewustzijnsvernauwing tot een kunst verheven. Zo ontstond er rond deze machtsgeneratie van de 68-ers een aureool van immuniteit. In het zelfverklaarde paradijs is er geen ruimte voor dissidentie, vermits het per definitie perfect is. Chanel inimitable, weigert alle namaak. De enige gepaste regeringsvorm van Utopia is die van de fluwelen dictatuur. En daar zitten we middenin. Nog altijd. Al zijn er tekenen dat er sleet op begint te komen.
'De verbeelding aan de macht': apotheose van het cultureel establishment
Men zou nu verwachten dat de culturele elite,- kunstenaars, academici, media- die manipulatie doorziet en er zich tegen afzet. Niets is minder waar. Ze is zelf meegestapt in de euforische parade van de verwezenlijkte utopie, en heeft het motto 'de verbeelding aan de macht' op een bizarre wijze gerealiseerd, nl. als een feest van de perceptie, een stroom van simulacres,- zoals de Franse filosoof Baudrillard ze karakteriseert. Schaduwvoorstellingen die ons het zicht op de realiteit ontnemen en dus ook de externe kritiek onmogelijk maken, hetgeen hun systeembevestigend karakter verraadt.
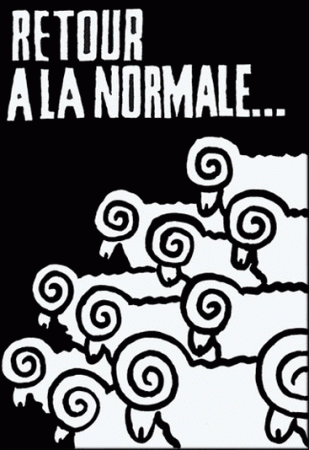 Cultuur, althans de officiële, geaccrediteerde versie, verwerd tot het hilarische trompetgeschal rond de tribune van de poco-dictatuur. De opdracht was en is om te verwarren, mist te spuiten. De ontzettende logorrhee en beeldenstroom die elke dag op ons afkomt, oversatureert ons bevattingsvermogen compleet, maakt ons murw en mentaal weerloos. Ook dat is een erfenis van het ’68-theater en de machtsgreep van deze ludieke generatie. Alles is scherts, ironie, spel, franje. Het politiek bedrijf, de cultuurindustrie en de media convergeren rond deze mateloze cultus van de schijn, het beeld en de perceptie, in een spektakelmaatschappij waarin je alleen bestaat als je op TV komt. En ook dat heeft hoger vernoemde Jacques Lacan achteraf scherp ontmaskerd,- ik citeer: "Cultuur is verworden tot een machinerie van hysterische waarheden die elkaar opvolgen als modieuze gadgets zonder samenhang en zonder schaamte."
Cultuur, althans de officiële, geaccrediteerde versie, verwerd tot het hilarische trompetgeschal rond de tribune van de poco-dictatuur. De opdracht was en is om te verwarren, mist te spuiten. De ontzettende logorrhee en beeldenstroom die elke dag op ons afkomt, oversatureert ons bevattingsvermogen compleet, maakt ons murw en mentaal weerloos. Ook dat is een erfenis van het ’68-theater en de machtsgreep van deze ludieke generatie. Alles is scherts, ironie, spel, franje. Het politiek bedrijf, de cultuurindustrie en de media convergeren rond deze mateloze cultus van de schijn, het beeld en de perceptie, in een spektakelmaatschappij waarin je alleen bestaat als je op TV komt. En ook dat heeft hoger vernoemde Jacques Lacan achteraf scherp ontmaskerd,- ik citeer: "Cultuur is verworden tot een machinerie van hysterische waarheden die elkaar opvolgen als modieuze gadgets zonder samenhang en zonder schaamte."
De aan hysterie grenzende libertaire roes van na ‘68, die ons figuren als Jan Hoet en Hugo Claus opleverde, heeft de modale burger niet kritischer of mondiger gemaakt. Integendeel, de veelbezongen artistieke vrijheid beperkte zich vooral tot de zelfverheerlijking van een nieuwe, mediagestuurde elite van trendintellectuelen die zich klakkeloos associeerden met de paarse euforie en haar perceptielogica.
Daarbij hanteerden ze het ‘surrealistische’ Belgische model als een spiegelbeeld van hun eigen flou artistique. Omgekeerd blijft het neo-unitaire regime deze elegante cultuurclowns koesteren, als apologeten van een complexe, ondoorzichtige staatsbureaucratie.
In het zog van Coco Chanel definieert elke kunstenaar zich als een 'rebel', terwijl hij eigenlijk de intransparantie van de postmoderne macht reflecteert. Zo’n half jaar geleden sloeg de Amerikaanse installatiekunstenaar Paul McCarthy (geboren in 1945, afgestudeerd in 1969, de data spreken voor zich) letterlijk en figuurlijk een gat in het SMAK-museum. Met een ketchupfles van 18 meter hoog, reusachtige hopen stront, een vastgebonden varken, en nog wat toestanden waarvoor muren moesten gesloopt worden, kwam de SMAK-directie uit op een deficit van een half miljoen Euro gemeenschapsgeld. Het lijkt populistisch en laag-bij-de-gronds om dat deficit te koppelen aan een waardeoordeel over die mijnheer McCarthy, maar er schuilt wel degelijk een logica in: achter de ludieke absurditeit van dit soort happenings zit een enorme kunstmarkt die in een inhoudloze vernieuwingsspiraal zit en dus constant moet choqueren om de aandacht te trekken. Alles moet duur zijn, groot, opgeblazen, excentriek, en al het nieuwe wordt even snel weer vervangen door het nieuwste. Als toeschouwers en participanten worden wij constant meegelokt in dit opbod. Iedereen moet blij zijn, enthoesiast, vooruitkijkend, positief, en vooral niet ‘verzuurd’. Zo convergeerde het exces van de kunstmarkt en de beeldcultuur met de ambities van de oud-'68-generatie om elke politieke en sociale dissidentie preventief af te blokken.
Er is binnen deze hype-industrie immers geen enkele ruimte voor bezinning, zelfbevraging of zelfs maar kritisch voorbehoud. De post-68-kunst, die ons zogezegd bevrijd heeft, produceert de ene fata morgana na de andere. Ze wordt gecreëerd door vedette-clowns die via een absurdistisch-ludieke beeldtaal ons oordeelsvermogen buitenspel zetten en ethische reflexen bij voorbaat ontzenuwen. Kunst zou volgens hen continu langs de kassa kunnen passeren zonder zich ergens voor te moeten verantwoorden. Ik ben niet de enige die wijst op die quasi-subversiviteit van de hedendaagse post-68-kunst en zijn ‘revolutionair’ marktlabel. Ook critici als Marc Holthof komen tot die analyse. Ik citeer even een essay van hem: “Sinds marketing de kunst in haar macht heeft moet ze constant revolteren. Maar niet tegen de maatschappelijke orde, wel tegen zichzelf, tegen de concurrerende kunststromingen. De kunst speelt een permanente thuiswedstrijd. Daar gaat alle energie naar, met als resultaat dat de maatschappelijke relevantie vaak nihil is.”
Nihil, dat is dus de balans van het Jan Hoet-tijdperk. Groteske grappen die ons moeten verzoenen met het ethisch deficit, de intellectuele verwarring en de politieke intransparantie. Macht is vandaag gebaseerd op vaagheid en gecodeerde informatie. De cultus van de artistieke vrijheid loopt zo op een bizarre wijze parallel met een publiek afstompingsproces, een gewenning aan het onredelijke en absurde. De gewone man haalt finaal zijn schouders op en leest Dag Allemaal. Hij heeft afgehaakt, zowel wat de politiek betreft als wat het kunstgebeuren aangaat. Opdracht vervuld, de narren mogen andermaal langs de kassa passeren.
Zo komt het dat vrijwel alle kunstenaars hier te lande uitbundig het paarse regime bejubeld hebben,- de meest ‘progressieve’ voorop: de symbiose tussen een politieke cultuur van de perceptie en de gebakken lucht, en een op deze thermieken zwevende, vrolijke cultuurindustrie, was hier volmaakt. Politiek en cultuur, als twee podia van een surrealistische totaalhappening. En zo komt het ook dat haast heel dat cultureel establishment het 'Belgische model' vreugdevol omarmde: Ik hou van U, je ‘taime tu sais. De post-68-culturo’s houden van België, zoals het gefederaliseerde Belgische kluwen van 1970 zelf baadt in een halfslachtig flou artistique.

Het is tenslotte evenmin een toeval dat de diepbetreurde Vlaamse schrijver Hugo Claus en aanvoerder van de artistieke ’68-generatie, een intimus was van Guy Verhofstadt, de man die de geschiedenis zal ingaan als diegene die realiteit met perceptie compleet kon verwisselen.
Vraag is hier: Wie houdt van wie? Wie houdt wie recht?
Van ‘sexuele revolutie’ tot pornificatie: sex als drug en marketing-tool
In het waanidee van de ‘culturele revolutie’ speelt de zgn. ‘sexuele revolutie’ een centrale rol. En inderdaad, de borsten en billen zijn alomtegenwoordig, je kan geen TV meer aanzetten of een tijdschrift ter hand nemen, of het gaat over sex. Meisjes van elf lopen met een T-shirt rond, waarop te lezen staat ‘fuck me’. Jongens van twaalf die ‘het’ nog niet gedaan hebben, zijn achterlijke nerds. Maar achter deze zogenaamde emancipatie blijkt weer een verhaal te schuilen van maatschappelijk-politieke recuperatie en ook weer brutale marketingstrategie.
Want hoe kan men het plebs beter aan de leiband houden, dan zijn energie helemaal te laten omzetten in sex, voor, tijdens en na het eten? Naarmate het sperma van de muren druipt en de publieke sfeer doordrenkt wordt van erotische metaforen en verborgen of open verleiders, verengt zich weerom dat bewustzijn tot een zelfverslavend spel van prikkels en reflexen. Er ontstaat een sfeer van constante hitserigheid die perfect het hysterisch consumentisme imiteert, en die door Herbert Marcuse –nochtans weer een ‘68er…- werd omschreven als ‘repressieve desublimatie’. Simpel gezegd: ‘Laat ze neuken, dan denken ze niet na.’ In deze overprikkelde samenleving is het weerom heel moeilijk om afstand te bewaren,- het is een cultuur van de onvervulbare begeerte die alle menselijke energie afleidt naar een fixatie op lustbeleving. Niet dat U alles zomaar krijgt wat wordt geafficheerd, het gaat evenzeer om illusie en ersatz-bevrediging. De knappe, halfnaakte blondine op de motorkap zal de Uwe niet zijn, alleen haar simulacre, haar afdruk wordt meegeleverd als U de auto koopt. De mysterieuze Mister Dash die de vrouwen komt verrassen temidden van hun wasgoed is even reëel als Sinterklaas, maar als erotische passé-partout en universele verleider werkt hij perfect: droom zacht, dames, zet U op de wasmachine en laat U eens goed gaan.
Onvermijdelijk lopen ook hier de massamedia mee als animatoren van het pretpark. Tegenwoordig maakt het dagblad De Standaard reklame met soft-pornoboekjes die U voor vijf Euro plus een uitgeknipte bon kan gaan afhalen bij de krantenboer. Het is echt zielig om zien,- op de redactie van die kwaliteitskrant heerst de opgewonden sfeer van collegejongens die een bordeelvitrine passeren. De lezer wordt, in zijn zoektocht naar informatie, afgeleid naar een rossig amalgaam van erotiek, fictie, voyeuristische pretlectuur. Heel subtiel draait de journalistieke missie, via een verkeerd begrepen ‘progressiviteit’, om tot een verpulping in dienst van de verkoopcijfers, maar tegelijk ook met het oogmerk om het publiek te gewennen aan een gemakkelijke, lichtvoetige en in se onbenullige vorm van infotainment.
De puberale erotomanie van mei ’68 is mettertijd weggegleden in een universele pornificatie, die de eros banaliseert, die intellectueel afstompt, en die door de moderne marketing helemaal is geïnstrumenteerd. De alomtegenwoordigheid van sex, als drug en marketing-tool, is misschien wel het meest hallucinante teken van een emancipatie-idee die in haar tegendeel is omgeslagen. Ze belemmert een echte sexuele bevrijding, in het kader van een menselijke ontplooiing op fysisch, psychisch en sociaal vlak.
Zo zijn we weer bij de kern van de zaak: de zgn. ‘sexuele vrijheid’ is vandaag vooral een marketeerskwestie. De strategie om kinderen zo snel mogelijk tot pubers op te fokken, heeft uiteraard niets met emancipatie te maken, maar alles met de mogelijkheid om hen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de commerciële tienercultuur, de markt van GSM’s, I-pods, tot en met, jawel, de revolutionaire mascara van Chanel. Komt daarbij dat pubers veel gemakkelijker om de tuin te leiden zijn dan kinderen, net vanwege hun labiele hormonale huishouding. Borstjes en puistjes doen de kassa's rinkelen! De alomtegenwoordige opdringerigheid van sexuele signalen, wat men vandaag aanduidt als de ‘pornificatie van de publieke ruimte’, is misschien wel het meest hallucinante teken van een emancipatie-idee die in haar tegendeel is omgeslagen. Wat Marx ooit over godsdienst zei, als ‘opium van het volk’, geldt vandaag voor het universele erotisme. Het heeft de verveling, de afstomping en de totale deconcentratie van het onderbroekenuniversum voortgebracht. Ik citeer nog maar eens Baudrillard: "Alles kan en alles mag, alles is bevrijd en er zijn geen taboes meer, maar in de plaats van een opwindend feest levert dit een geweldig gevoel van leegte op. We leven in de hel van hetzelfde".
Terug dan maar naar het preutse Victorianisme? Neen, allerminst. Sexuele ontplooiing blijft voor mij als een rode draad lopen doorheen het menselijke rijpingsproces. Dat zit echter niet in het puberaal-erotomane register van mei ’68 en zijn depolitiserende, hektische, escapistische onderstroom. Wel in een zoektocht naar zelfverwezenlijking op fysisch, psychisch en sociaal vlak. Dat is een verhaal van emotionele intelligentie, empathie, gevoel voor intimiteit, keuzebekwaamheid, maturiteit.
Om maar te zeggen, beste vrienden: de politicus die tepels laat overplakken, heeft een probleem. We hebben als zuigeling haast allemaal aan die tepels gehangen, en ik kan me echt geen kind of tiener voorstellen die een trauma overhoudt aan een afbeelding ervan. De krampachtige censuur van wat menselijk en normaal is, is zo aberant als de pornificatie zelf. Het zijn twee kanten van één medaille. Onlangs werd in de VS een kleuter van vier veroordeeld omdat het kind zijn juf knuffelde. Men vraagt zich af wat voor soort rechters tot dit soort uitspraken komt. En in wat voor een klimaat van sexuele overspannenheid de politici leven die deze perverte magistraten benoemen. Het was evenzeer onzin om de expositie van L.P. Boon's fameuze Feminatheek als een uiting van zedenverwildering af te schilderen en te verbieden. Het eigenlijke schandaal bestond erin dat heel het gedoe inhoudelijk naast de kwestie was, ons niets wijzer maakte over het werk van Boon, en vooral diende als publiekstrekker in een door de Vlaamse boekenindustrie gesponsorde reklamestunt. Kunst, sex en marketing dus, andermaal.
Ach, dat verhaal van normen en waarden. We mogen onze kritiek op de fluwelen dictatuur van de vrijheid-blijheid-generatie niet zelf laten scleroseren tot een verhaal van ouderwets conformisme en nieuwe preutsheid,- een gemopper van opa’s die beweren dat alles vroeger veel beter was. Ook het christendom, inclusief zijn lichaamsvijandig puritanisme, is ons als staatsgodsdienst opgedrongen, omstreeks het jaar 800 van onze tijdrekening. De ‘normen en waarden’ die daarbij tot een traditie gingen behoren, zijn bij ons vastgelopen in het Vlaamse parochialisme, de verstikkende pastoorsdictatuur en de betuttelende tsjevenmoraal. Inclusief zwarte plakband op tepels. Maar Mei '68 heeft ons van die benauwdheid niet verlost. Ze heeft nieuwe cirkulaire processen gecreëerd van de obsessie en de verslaving.
Ons radicaal perspectief is niet het tijdperk van vóór het IIde Vaticaans Concilie, maar een tijdperk achter de horizon, waarin zingeving en spiritualiteit –om eens die belegen term te gebruiken- een nieuwe invulling krijgen. Vrijheid en autonomie, gekoppeld aan bewustzijn en zin voor het Grote Geheel. Onvermijdelijk zal daarin bv. ook het ecologisch thema sterk op de voorgrond komen. Voor mij moet de normen-en-waarden-discussie gepaard gaan met een nieuwe vraagstelling rond de emotionele en instinctieve uitbouw van het individu en de groep. We zijn natuurwezens met een libido en een doodsangst, en tegelijk zijn we cultuurwezens, met een tijdsbesef, een geschiedenis, en een besef dat ons verstand eindig is, dat er wellicht altijd iets achter de horizon zal blijven. Dat spanningsveld tussen natuur en cultuur moet helemaal van vooraf aan geëxploreerd worden,- en, sorry vrienden, van de begrippen ‘staat’, ‘elite’, ‘politieke macht’, ‘geïnstitutionaliseerde godsdienst’, en dies meer zal, vrees ik, eens we daaraan toe gekomen zijn, niet veel meer overschieten.
Besluit: uitzicht op een contre-démocratie?
Welke conclusie moeten we nu trekken uit dit verhaal vol charades, gezichtsbedrog en bewustzijnsvernauwing,- het verhaal van een revolutie die er geen is, en een vrijheidsbeweging die meer onvrijheid heeft voortgebracht dan welke kerk of secte ook?
Ik denk dat de revolte, of als U wil de contra-revolte, meer dan ooit aan de orde is. Maar hoe contesteren in een universum waar alles mag en alles kan? De voetafdruk van de mei-68-generatie is, via haar lange mars door de instellingen, zo groot en desastreus geworden op die instellingen,- ze heeft m.a.w. het politiek-cultureel systeem zodanig naar haar hand gezet, dat men voorlopig binnen dat systeem nog maar bitter weinig aan politiek activisme kan doen. De uitgang en de diaspora wenken, naar het internet, de zgn. burgerjournalistiek, de civil society, de buitenparlementaire oppositie, de tegencultuur. Het is een moeilijk maar louterend proces.
Het zgn. apolitisme van de burger en heel de anti-establishment-onderstroom wijzen hier de weg. Het is de weg van de contre-démocratie, (Pierre Rosanvallon), de informele en onrecupereerbare waakzaamheidsattitude die men vooral buiten het parlementair halfrond bespeurt, buiten de praatbarak, buiten de instellingen, buiten de klassieke media.
De verzieking van het Belgische regime, waar de oudgedienden van Mei ’68 zich haast paniekerig aan vastklampen, versterkt nog deze maatschappelijke onderstroom van het grote ongenoegen. En het zal sommigen in deze zaal bizar in de oren klinken, maar misschien zijn de gedoodverfde protestpartijen zoals het Vlaams Belang, Lijst Dedecker, Pim Fortuyn, maar ook de nieuw-linkse S.P. van Marijnissen in Nederland, zelfs Obama in de VS, de laatste partijpolitieke verschijningsvormen van het anti-establishment-gevoel, alvorens dat gevoel opgaat in een globale toestand van burgerlijke ongehoorzaamheid, die kan leiden tot meer politiek bewustzijn, meer mondigheid, meer echte ‘vrijheid’. Verrassend genoeg ligt de échte, late erfenis van mei ’68 dan misschien wel eerder bij vernoemde protestpartijen, in de rand van de parlementair-democratische arena opererend, dan bij de huidige 'progressieve' elites die tot nader order het establishment uitmaken...
Ik dank U allen voor Uw aandacht.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mai 68, histoire, moeurs contemporaines, sociologie, médias, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, flandre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Vitales Denken ist inkorrekt"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Politische Theorie: Interview mit Robert Steuckers
"Vitales Denken ist inkorrekt"
von Jürgen Hatzenbichler
In diesem Jahr haben wir das 30jährige Jubiläum der 68er Revolte. Welchen Stellenwert hat die Neue Linke heute für einen rechten Diskurs?
STEUCKERS: Zunächst muß gesagt werden, daß die Neue Linke in Paris im Mai 1968 zwar demonstrierte, Krawall machte und die Fabriken mobilisierte, daß aber am 30. Mai eine Million Gegendemonstranten auf den Straßen waren, um dem ein Ende zu machen. Also im Mai hat die Rechte gewonnen; im Juni ist de Gaulle zurückgekommen. Man muß festhalten, daß die sogenannte antiautoritäre Bewegung erst 1988 nach der Machtübernahme durch Mitterand mit der Besetzung der Institutionen beginnen konnte. Zwischen 1968 und 1981 hatte in Frankreich die Neue Linke zwar sehr viel Gewicht, aber trotzdem ist die liberal-konservative Rechte an der Macht geblieben und hat ihre Weltanschauung entwickeln können. Man muß außerdem, um ’68 zu verstehen, wissen, daß de Gaulle nach dem Algerienkrieg seinen Kurs vollständig geändert hatte, daß er antiimperialistisch und antiamerikanisch war, daß er 1965 Rußland besucht hat und die Nato verlassen hatte. Er stellte in einer Rede in Kambodscha Frankreich als die führende antiimperialistische Macht dar, als Partner für die Länder, die weder amerikanisch noch kommunistisch waren. Er pflegte auch Kontakte nach Südamerika, so daß die französische Flugzeugindustrie die amerikanische dort verdrängen konnte. 1967 rief er in Québec das "freie Québec" aus, was eine direkte Provokation für die USA war. Die Amerikaner haben das nicht toleriert. Der Mai ’68 ist dann teilweise auch von den amerikanischen Geheimdiensten gemacht worden, damit Frankreich auf seine antiimperialistische Funktion verzichtet.
Im deutschen Sprachraum verbindet man 1968 in der Folge mit politischer Korrektheit. Wie hat sich die Revolte im frankophonen Bereich ausgewirkt?
STEUCKERS: Der Moralismus ist in Deutschland und bei der deutschen Linken viel stärker ausgeprägt als in Frankreich. In Frankreich gibt es zwei Begriffe. Es gibt den Mai ’68: die Studentenbewegung als eine auflehnende Bewegung. Aber es gibt auch noch das "Denken von 68", la pensée ’68. Wenn man davon spricht, meint man eine Reihe von dekonstruktivistischen Philosophen wie Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari oder andere, die sich besonders von Nietzsche haben inspirieren lassen. Heutzutage aber kritisiert die political correctness diese Philosophen, weil sie lebensphilosophisch denken, weil sie "Vitalisten" sind.
Diese Methode der Dekonstruktion richtet sich vor allem gegen die Moderne...
STEUCKERS: …ja, gegen die Aufklärung. Ich würde hier etwa einen Akzent von Michel Foucault nennen. Foucault gilt selbstverständlich als linker Philosoph, aber er hat am Anfang seiner Karriere, die er mit einem 1961 erschienenen Artikel begonnen hat, eine These entwickelt, die besagt, daß die Aufklärung überhaupt nicht die Befreiung des Menschen ist, sondern der Anfang seiner totalen Überwachung und Bestrafung. Als dieser Artikel erschienen ist, wurde Foucault von gewissen Tugendwächtern als Reaktionär abgestempelt. Foucault war homosexuell; das ist bekannt. Er hat gesagt: "Ich muß mich für die Außenseiter engagieren, ich muß den Linken spielen, anders ist meine philosophische Karriere verloren." Nichtsdestoweniger gilt seine These, daß Aufklärung überwachen und bestrafen heißt. Foucault kritisierte weiter, daß die Aufklärung bis heute die Grundlage des französischen Jakobiner-Staates ist. Für Foucault verkörpert sich die aufklärerische Gesellschaft im neuen panoptischen Gefängnis, wo mitten im Gefängnis ein Turm steht, von dem aus der Wächter beobachten kann, was alle Gefangenen tun. Das Modell der Aufklärung verkörpert also eine gläserne Gesellschaft ohne Mysterien, ohne Privatsphäre oder persönliche Gefühle. Die political correctness hat sehr klar gesehen, daß dieses Denken äußerst gefährlich für die aufklärerischen Staaten ist. Foucault wird als "Vitalist" abgestempelt.
Welche Ideen der Neuen Linken sind noch aktuell?
STEUCKERS: Diese Frage muß ich über eine Umweg beantworten: Was will die heutige Neue Linke? Will die Neue Linke die Ideen von Foucault weiterverbreiten, also gegen Gesellschaften sein, die die totale Überwachung und Bestrafung wollen? Ich kann nicht für die Linke anworten. Aber was ich sehe, ist, daß die Neue Linke heutzutage gar nicht mehr denkt, sondern eben politische Korrektheit durchsetzen will.
Von manchen Rechten wird das Schema Rechts-Links mittlerweile in Frage gestellt. Ist die Aufhebung des Gegensatzes aktuell?
STEUCKERS: Ich meine, die Rechte wiederholt seit mehreren Jahrzehnten zu oft die gleichen Schlagwörter. Ich beobachte zwar, daß heutzutage in Deutschland gewisse philosophische Strömungen Foucault zusammen mit Carl Schmitt und Max Weber lesen. Das ist sehr wichtig. Das ist der Kern einer neuen Konservativen Revolution, weil es antiaufklärerisch ist. Wobei ich selber nicht die ganze Aufklärung ablehne – zum Beispiel nicht den aufklärerischen König Friedrich II. von Preußen. Ich leugne nicht alles von Voltaire, der ein aufklärerischer Philosoph war und eine sehr gute Definition von Identität gegeben hat, als er sagte: "Es gibt keine Identität ohne Gedächtnis." Ich lehne also nicht alles ab, ich lehne aber sehr wohl die political correctness ab, die von sich behauptet, daß sie die Erbin der Aufklärung sei und uns eine verballhornte Aufklärung verkauft. Man muß sagen, daß antiaufklärerische Ideen sowohl rechts wie auch links vorhanden sind. Andererseits hat eine gewisse Rechte, vor allem die technologie-konservativen Kräfte, die Frage der Werte nicht mehr gestellt. Diese Konservativen wollen sich aufklärerisch profiliert sehen wie die political-correctness-Linken.
Kann man sagen, daß in so einer Gesellschaft, die alles nur noch in ökonomischen und Konsumbegriffen sieht, die linken und rechten Intellektuellen die letzten Verteidiger von Sinn und Wert sind?
STEUCKERS: Das hat die amerikanische Debatte sehr gut beantwortet, wo der Philosoph John Rawls die Frage der Gerechtigkeit gestellt hat. Wenn die Aufklärung im Konsumismus endet, ist weder Gemeinschaft noch Gerechtigkeit möglich. Es gibt wahrscheinlich Wertkonservative und Wertprogressisten. Und hier ist eine Debatte möglich über die entscheidenden Fragen von Morgen. Aber die organisierten Kreise der political correctness werden alles tun, um das zu verhindern.
Wo sehen Sie auf der Rechten die mögliche Trennlinie zwischen wertkonservativer Haltung und reaktionärer Position?
STEUCKERS: Eine wertkonservative Haltung kann heutzutage überhaupt nicht strukturkonservativ bleiben. Eine wertkonservative Haltung verteidigt die Werte, die die Gemeinschaft zusammenhalten. Wenn Strukturkonservative, das heißt Wirtschaftsliberale, es unbedingt vermeiden, die Frage nach den Werten stellen, dann wird das die Auflösung der Gemeinschaften vorantreiben. Dann haben wir die Gefahr, daß die Staaten, aber auch eine eventuelle Weltgemeinschaft, absolut unregierbar werden.
Welchen Stellenwert hat die Nouvelle Droite, die Neue Rechte im heutigen intellektuellen Diskurs?
STEUCKERS: Sie hat heutzutage nicht mehr die Stellung von Einzelgängern. Sie sollte mehr auf die amerikanischen Kommunitaristen setzen und die Debatte gegen die Globalisierung und für identitätsstiftende Werte führen. Außerhalb Europas und Amerikas ist zu beobachten, daß nichtwestliche Zivilisationen wie China und die asiatischen Staaten die aufklärerische Idee der Menschenrechte zweimal abgelehnt haben, zuerst in Bangkok, dann in Wien. Sie haben sich dafür eingesetzt, daß die Menschenrechte den Traditionen der jeweiligen Zivilisationen angepaßt werden, weil, so sagten es etwa die Chinesen, die Menschen nie nur Individuen sind, sondern immer in eine Gemeinschaft und eine Kultur eingebettet sind.
00:05 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, théorie politique, vitalisme, entretiens, mai 68 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 novembre 2009
Le "socialisme allemand" de Werner Sombart
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES – 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES – 1990
Thierry MUDRY:
Le “socialisme allemand” de Werner Sombart
Né en 1863 à Ermsleben, Werner Sombart est le fils d'Anton Ludwig Sombart, hobereau et industriel prussien, membre libéral de la Chambre prussienne des Députés et du Reichstag.
Werner Sombart étudie l'économie politique et le droit dans les Universités allemandes. Après avoir obtenu son doctorat, il est d'abord secrétaire de la chambre de commerce de Brême puis professeur extraordinaire (chargé de cours) à l'Université de Breslau. Mais le "radicalisme" de Sombart (influencé par Lassalle et Marx) lui vaut la défaveur du ministère prussien de l'instruction publique: son avancement est stoppé. En 1906, il donne des cours à l'Ecole des hautes études commerciales de Berlin et plusieurs années plus tard, en 1918, il devient enfin professeur ordinaire à l'Université de Berlin où il prend la succession d'Adolf Wagner, l'un des maîtres de la Jeune Ecole historique et du "socialisme de la chaire" (Kathedersozialismus).
Economiste et sociologue, Sombart apparaît comme l'historien du capitalisme mais aussi comme un critique impertinent du capitalisme. Sombart s'éloigne cependant peu à peu d'une critique d'inspiration marxiste pour adopter une critique d'inspiration nationaliste et luthérienne. On distingue aisément le Sombart qui se consacre à l'étude scientifique du capitalisme et particulièrement à l'étude de la genèse de l'esprit capitaliste et le Sombart militant qui prend fait et cause pour le mouvement ouvrier à la fin du XIXème siècle et au début de ce siècle, pour l'Allemagne pendant la Grande Guerre et pour le "socalisme allemand" dans les années 30. Le premier Sombart est l'auteur en 1902 des tomes I et II du "Capitalisme moderne" qui connaîtront des rééditions successives en 1916 et 1924/27 (Sombart publiera en 1928 le tome III traduit en français sous le titre L'apogée du capitalisme); en 1903 de L'économie allemande du XIXème siècle; en 1911 d'un ouvrage sur Les Juifs et la vie économique (traduit en français); en 1913, il publie Le bourgeois (également traduit en français) et ses études sur le développement du capitalisme moderne: Luxe et capitalisme, Guerre et capitalisme, etc. En revanche, Le socialisme et le mouvement social au XIXème siècle publié en 1896 (traduit en français), Commerçants et héros qui parut pendant la Grande Guerre, Le socialisme prolétarien publié en 1924 et Le socialisme allemand publié en 1934 (traduit en français) sont indiscutablement l'œuvre du Sombart militant.
Sombart = Marx + l’école historique?
D'après Schumpeter (à qui Sombart céda sa chaire à l'Université de Berlin), Sombart aurait subi tout autant l'influence de Karl Marx que celle de l'Ecole historique.
Sombart étudia l'économie politique à Berlin, or "l'enseignement économique était alors dans les universités allemandes sous l'influence de l'Ecole historique réagissant contre l'étroitesse d'esprit et l'optimisme exagéré du libéralisme (le Manchestertum "fossile") et plus ou moins imbu de socialisme d'Etat" (André Sayous, préface à L'apogée du capitalisme de Werner Sombart, Payot, Paris, 1932, pp XII et XIII). Sombart eut pour maîtres à l'Université de Berlin Gustav Schmoller et Adolf Wagner. Ce dernier, qu'une commune admiration pour les travaux de Ferdinand Lassalle (l'un des pères du socialisme d'Etat) rapprochait de Sombart, le désigna d'ailleurs comme son successeur à l'Université. Pour certains, il conviendrait de ranger Sombart parmi les auteurs de l'Ecole historique mais ce n'est pas l'avis d'André Sayous: "économiste et sociologue, il (Werner Sombart) traite en réalité l'histoire comme une "science auxiliaire" qu'il utilise, répétons-le, avec une grande liberté d'esprit et même, parfois, selon son bon plaisir" (ibid., p. XVII) mais, reconnaît Sayous, "Sombart a conservé des liens avec l'Ecole historique. Généralement, son argumentation repose sur l'histoire et il se sert de celle-ci dans l'esprit démonstratif des maîtres de l'école allemande" (ibid., p. XVIII).
Sombart a subi aussi l'influence de Karl Marx. En 1894, Sombart accueille avec enthousiasme la publication du troisième volume du Capital et publie une étude sur le marxisme qui lui vaut les éloges de Friedrich Engels. Deux ans plus tard, il écrit Le socialisme et le mouvement social du XIXème siècle. Mais Sombart s'éloigne peu à peu du marxisme, la 10ème édition de son Socialisme et mouvement social parue en 1924 sous le titre Le socialisme prolérarien apparaît aux yeux de certains comme une diatribe anti-marxiste. Mais devenu pourtant "anti-marxiste", Sombart reconnaît volontiers sa dette envers Marx. Dans l'introduction à L'apogée du capitalisme, il se défend d'avoir voulu attaquer Marx: au contraire, affirme-t-il, "je m'étais proposé de continuer et, dans un certain sens, de compléter et d'achever l'œuvre de Marx. Tout en repoussant la conception du monde de Marx et, avec elle, tout ce qu'on désigne aujourd'hui, en synthétisant et précisant son sens, sous le nom de "marxisme"; j'admire en lui sans réserves le théoricien et l'historien du capitalisme. Tout ce qu'il y a de bon dans mes propres ouvrages, c'est à l'esprit de Marx que je le dois, ce qui ne m'empêche naturellement pas de m'écarter de lui non seulement sur des points de détail, voire dans la plupart de mes façons de voir particulières, mais sur des points essentiels de ma conception d'ensemble" (ibid., p.15). En 1934, dans Le socialisme allemand (paru dans sa traduction française chez Payot, Paris, 1938), Sombart opère une distinction entre le "marxisme pratique" et le marxisme "qui, à titre de théorie historique, est d'une incomparable valeur pour les sciences sociales" (p. 100).
Sombart et l'étude du capitalisme
Pour Sombart, le capitalisme -qu'il définit par ailleurs comme une "catégorie historique"- est un "système économique" qui "repose d'une façon subjective sur le primaire de l'acquisition, trouvant son expression dans le gain; il est essentiellement "individualiste", car il a comme base la concurrence; enfin, il représente les idées de rationalisation dans l'ordre économique" (André Sayous, op. cit., p. XX).
Sombart distingue trois périodes dans l'histoire du capitalisme:
- le "capitalisme primitif" qui prend fin avec la révolution industrielle;
- le "haut capitalisme" ou "apogée du capitalisme" qui correspond à la période s'étendant de l'emploi métallurgique du coke (dont Sombart situe les débuts dans les années 1760/1770) à la Ière guerre mondiale. "C'est au cours de cette époque que le capitalisme a réalisé son épanouissement le plus complet et est devenu le système économique dominant" (L'apogée du capitalisme, p.12);
- le "capitalisme tardif", période qui s'ouvre avec la Ière guerre mondiale.
Pour Sombart, il ne fait pas de doute que "les forces motrices de la vie économique" ne sont pas plus la piété puritaine que la plus-value du capital (Sombart renvoie ici dos à dos Weber et Marx); ni même la division du travail et la concurrence chères aux économistes classiques, ni non plus le système juridique, la technique ou la démographie. Les seules forces motrices de l'histoire en général et de la vie économique en particulier, ce sont les hommes vivants avec leurs pensées et leurs passions et surtout certains d'entre eux. C'est l'homme, en tant que sujet de l'histoire, qui construit les systèmes économiques. Ainsi, le capitalisme naissant "fut l'œuvre de quelques hommes d'affaires entreprenants, appartenant à toutes les couches de la population. Il y avait parmi eux des nobles, des aventuriers, des marchands, des artisans, mais ils ont été pendant longtemps trop faibles pour imprimer à la vie économique une direction décisive. A côté d'eux, des princes énergiques (...) et plus particulièrement de hauts fonctionnaires, comme Colbert, ont joué dans l'évolution économique de l'époque un rôle de premier ordre (en poussant les particuliers dans des entreprises capitalistes)" (ibid., p. 29). A l'époque du capitalisme avancé "toute la direction de la vie économique a passé entre les mains des entrepreneurs capitalistes qui, désormais soustraits à la tutelle de l'Etat, sont devenus (...) les seuls organisateurs du processus économique, pour autant que celui-ci se déroule dans le cadre de l'économie capitaliste" (ibid., p.30). L'entrepreneur capitaliste est donc la seule force motrice de l'économie capitaliste moderne. Il est la seule force productive: "tous les autres facteurs de la production, le capital et le travail, se trouvent sous sa dépendance, ne sont animés que par son activité créatrice. De même, toutes les inventions techniques ne reçoivent que de lui leur vitalité" (ibid., p.31).
Le capitalisme va-t-il mourir d’un excès de rationalisation?
Sombart a consacré les deux premiers tomes de son Capitalisme moderne à l'étude du pré-capitalisme et du capitalisme primitif et le troisième tome à l'étude du haut capitalisme. Quant au capitalisme tardif, Sombart y a consacré la conclusion de son Apogée du capitalisme. La principale caractéristique de cette période serait "la substitution du principe de l'entente à celui de la libre-concurrence". Le déclin du capitalisme s'amorce et celui-ci, pense Sombart, va probablement mourir d'un excès de rationalisation. "La crise allait évidemment donner une puissante accélération à la thèse du déclin, largement vulgarisée par Fried, disciple de Sombart et collaborateur de la revue Die Tat, dont le livre intitulé La fin du capitalisme (1931) fut une manière de best-seller dans les milieux nationalistes" (Louis Dupeux, Stratégie communiste et dynamique conservatrice ..., Librairie Honoré Champion, Paris, 1976, p. 12).

Sombart "a distingué des périodes de civilisation et conçu chacune d'elles comme un "système" d'un "esprit" ou "style déterminé" ... "où ainsi que chez Karl Marx, les fonctions économiques constituent les bases et les caractères propres de la période, mais où, différence fondamentale, chaque sentiment de l'économique est précisé d'une façon spéciale" (André Sayous, op. cit., pp. x et xi). "Ce qui imprime à une époque, et aussi à une période économique, son cachet particulier, c'est son esprit" écrit Sombart (ibid., p.8). Le capitalisme s'accompagne d'un "esprit capitaliste" et c'est cet esprit qui, en se transformant, a fait évoluer le capitalisme.
Mais, quel est cet "esprit capitaliste" et quel rôle joue-t-il dans l'apparition et l'évolution du capitalisme? Sombart apporte des éléments de réponse dans son livre Le bourgeois.
L'esprit capitaliste (c'est-à-dire l'esprit qui anime l'entrepreneur capitaliste et qui caractérise le système que celui-ci crée) est né, pense Sombart, de la réunion de l'esprit d'entreprise et de l'esprit bourgeois: "(...) L'esprit d'entreprise est une synthèse constituée par la passion de l'argent, par l'amour des aventures, par l'esprit d'invention, etc. tandis que l'esprit bourgeois se compose, à son tour, de qualités telles que la prudence réfléchie, la circonspection qui calcule, la pondération raisonnable, l'esprit d'ordre et d'économie. (Dans le tissu multicolore de l'esprit capitaliste, l'esprit bourgeois forme le fil de laine mobile, tandis que l'esprit d'entreprise en est la chaîne de soie)" (Le bourgeois, Payot, Paris 1966, p. 25).
Sombart distingue parmi les sources de l'esprit capitaliste:
- des bases biologiques: les "natures bourgeoises" et les "prédispositions ethniques" (chez les Etrusques, les Frisons et les Juifs);
- les forces morales: la philosophie (interprétation rationaliste et utilitariste des écrits stoïciens, auteurs rustiques romains), les influences religieuses (catholicisme, protestantisme, judaïsme), les forces morales proprement dites (morale sociale conduisant à l'adoption et au culte des "vertus bourgeoises");
- les "conditions sociales": l'Etat, les migrations, la découvertes de mines d'or et d'argent, la technique, l'activité professionnelle pré-capitaliste, le capitalisme comme tel.
La controverse entre Weber et Sombart
Max Weber s'est élevé "contre les prétentions dogmatiques d'une explication totale de l'histoire par l'économie" mais "il ne voulait nullement -constate Raymond Aron (La sociologie allemande contemporaine, PUF, Paris 1981, pp.112/113)- réfuter le marxisme en lui opposant une théorie idéaliste de l'histoire, qui lui aurait paru aussi schématique et indéfendable que le matérialisme historique". Sombart approuve Weber sur ce point: dans Le bourgeois, Sombart constate la multiplicité des causes qui permettent d'expliquer la genèse de l'esprit capitaliste. Il s'en prend aux "partisans intransigeants de la conception matérialiste de l'histoire", mais écrit-il, "opposer à l'explication causale économique une autre explication universelle est une chose dont je me sens incapable (...)" (p.338). Tous deux voient dans la religion une des causes du capitalisme. Dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber attribue au calvinisme un rôle important dans la genèse de l'esprit capitaliste: "jamais assuré de son élection, le calviniste en cherche les signes ici-bas. Il les trouve dans la prospérité de son entreprise. Mais il ne peut s'autoriser du succès pour se reposer ou utiliser son argent en vue du luxe ou du plaisir. Il doit donc réemployer cet argent dans l'entreprise: formation de capital par obligation ascétique. Bien plus, seul le travail régulier, rationnel, le calcul qui permet à chaque instant de se rendre compte de la situation de l'entreprise, seul le commerce pacifique sont en accord avec l'esprit de cette morale" (Raymond Aron, op. cit., p.112). Sombart, pour sa part, attribue au thomisme et au judaïsme un rôle bien plus important que le calvinisme dans l'apparition de l'esprit capitaliste.
En imposant un droit naturel rationnel fondé sur le Décalogue mais qui intégrait aussi "la philosophie grecque de la dernière période de l'hellénisme", le thomisme a opéré une rationalisation déjà de nature à favoriser la mentalité capitaliste. "Pour que le capitalisme put s'épanouir, l'homme naturel, l'homme impulsif devait disparaître et la vie, dans ce qu'elle a de spontané et d'original, céder la place à un mécanisme psychique spécifiquement rationnel: bref, l'épanouissement du capitalisme avait pour condition un renversement, une transmutation de toutes les valeurs" (Le bourgeois, pp. 227/228). A cela, il faut ajouter la condamnation par le thomisme et les scolastiques, de la prodigalité (mais aussi de l'avarice) et de l'oisiveté, l'idéal bourgeois "d'une vie chaste et modérée", le culte de la décence et de l'honorabilité, les préceptes d'une administration juste et rationnelle: ainsi s'opéra une sorte de "dressage psychique" qui réussit à transformer en entrepreneurs capitalistes "le seigneur impulsif et jouisseur d'une part, l'artisan obtus et nonchalant d'autre part" (ibid., p.231). Sombart note enfin chez certains scolastiques (notamment italiens), qui ici dépassent la pensée de Thomas d'Aquin, une profonde sympathie pour le capitalisme.
En jugeant très favorablement la richesse, en élaborant un rationalisme très rigoureux, le judaïsme contenait et développait "jusqu'à leurs dernières conséquences logiques, toutes les doctrines favorables au capitalisme" (ibid., p.250)". Mais ce qui a permis à la religion juive d'exercer une action vraiment décisive, c'est le traitement particulier qu'elle appliquait aux étrangers. La morale juive était une morale à double face, et ses lois différaient selon qu'il s'agissait de Juifs ou de non-Juifs" (ibid., p.251). "Le traitement différentiel que le droit juif appliquait aux étrangers" a eu pour conséquences: le relâchement de la morale commerciale et la transformation précoce des "conceptions relatives à la nature du commerce et de l'industrie, et cela dans le sens d'une liberté de plus en plus grande" (ibid., pp 254 et 255). Sombart étudia d'une manière plus précise dans son livre sur "Les Juifs et la vie économique" les rapports entre judaïsme et capitalisme.
Luthérianisme, calvinisme, thomisme et scolastique
Le protestantisme apparaît dès lors singulièrement en retrait: "comme le mouvement inauguré par la Réforme a eu incontestablement pour effets une intériorisation de l'homme et un raffermissement du besoin métaphysique, les intérêts capitalistes devaient nécessairement souffrir dans la mesure où l'esprit de la Réforme se répandait et se généralisait" (ibid., p.239). Le luthérianisme se montra particulièrement anti-capitaliste (et Sombart devait recueillir l'héritage de cet anti-capitalisme luthérien). Le puritanisme lui-même (variante anglo-saxonne du calvinisme) fut une entrave au développement du capitalisme avec son idéal de pauvreté hérité du christianisme primitif, sa "condamnation sévère de tout effort ayant pour objectif l'acquisition de la richesse, c'est-à-dire, et avant tout, une condamnation des moyens de s'enrichir qu'offre le capitalisme" (ibid., p.241). Mais, après la morale scolastique (ou thomiste), "à son tour, la morale puritaine proclame la nécessité de la rationalisation et de la méthodisation de la vie, des instincts et des impulsions, de la transformation de l'homme naturel en un homme rationnel". "Lorque la morale puritaine exhorte les fidèles à mener une vie bien ordonnée, elle ne fait que reproduire mot pour mot les préceptes de la morale thomiste, et les vertus bourgeoises qu'elle prêche sont exactement les mêmes que celles dont nous trouvons l'éloge chez les scolastiques" (ibid., pp 243/244). Ce qui apparaît favorable au capitalisme chez les puritains semble donc emprunté au thomisme et aux scolastiques.
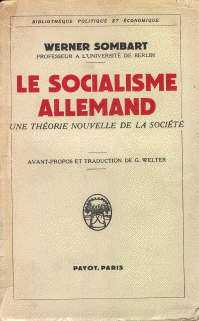
La raison première de cette divergence entre Weber et Sombart, Raymond Aron croit la trouver "dans le fait qu'ils n'utilisent pas la même définition du capitalisme". Pour Weber, le "capitalisme", c'est essentiellement le capitalisme occidental, le capitalisme "s'oppose à une économie qui tend, avant tout, à la satisfaction des besoins. Le capitalisme serait le système qu'anime un désir de gains sans limite, qui se développe et progresse sans terme, économie d'échanges et d'argent, de mobilisation et de circulation des richesses, de calcul rationnel. Les caractères sont moins dégagés par une comparaison avec les autres civilisations que saisis intuitivement dans leur ensemble" (Raymond Aron, op. cit., p.114). Autre raison probable de cette divergence: les convictions des deux auteurs. Max Weber est un protestant libéral qui croit réconcilier protestantisme et capitalisme dans l'esprit de l'homme allemand en distinguant une morale de la conviction obéissant aux impératifs de la foi et une morale de la responsabilité soumise aux impératifs de l'action. La morale de la conviction délimite un domaine religieux de plus en plus intériorisé (ce qui est bien conforme à l'essence du protestantisme), la morale de la responsabilité un domaine économique abandonné au capitalisme (et un domaine politique soumis à la raison d'Etat). A l'inverse, Sombart est un anti-capitaliste d'obédience marxiste et, plus tard, d'obédience luthérienne.
Vertus bourgeoises et éléments héroïques de la psyché européenne
Après avoir passé en revue les diverses manifestations nationales de l'esprit capitaliste (Italie, Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, USA), Sombart s'intéresse à l'évolution de celui-ci. (Pour Sombart, nous le savons, l'évolution du capitalisme est intimement liée à celle de l'esprit capitaliste).
- Dans un premier temps, les "vertus bourgeoises" se joignent à l'esprit d'entreprise et à l'amour de l'or (caractéristiques mentales des peuples européens) pour donner naissance à l'entrepreneur capitaliste d'abord tout à la fois héros, marchand et bourgeois. Puis, les "vertus bourgeoises" l'emportent peu à peu sur l'élément héroïque. A cela plusieurs raisons: le développement des armées professionnelles, l'auto-rité des forces morales, le mélange des sangs (cf. "Le bourgeois", pp 339/340).
Deux époques se succèdent alors:
- celle du "bourgeois vieux-style" tenu en laisse, selon l'expression même de Sombart, par les mœurs et une morale d'inspiration chrétienne;
- celle de l'"homme économique moderne" (à partir de la fin du XIXème siècle) qui ne connaît plus ni entraves, ni restriction.
Sombart aborde enfin un délicat problème de causalité: le capitalisme est-il l'émanation ou la source de l'esprit capitaliste? Selon Sombart, on ne peut opposer l'esprit capitaliste au capitalisme dont il est partie intégrante mais on peut en revanche l'opposer à l'"organisation capitaliste" (qui comprend tous les éléments constitutifs du système capitaliste qui ne peuvent être rangés dans la catégorie "esprit"). "Sans l'existence préalable d'un esprit capitaliste (ne fût-ce qu'à l'état embryonnaire), l'organisation capitaliste n'aurait jamais pu naître" (ibid., p.328): une création ne peut préexister à son créateur mais elle peut acquérir une certaine autonomie et agir en retour sur son créateur. Ainsi le capitalisme, création de l'esprit capitaliste, est devenu une des sources (et "non la moins importante" ajoute Sombart) de cet esprit.
Deux dangers menacent désormais l'esprit capitaliste: la "féodalisation" ("l'enlisement dans la vie de rentier ou l'adoption d'allures seigneurales") et la bureaucratisation croissante des entreprises. "Peut-être, conclut Sombart, assisterons-nous aussi au crépuscule des dieux et l'or sera-t-il rejeté dans les eaux du Rhin" (ibid., p.342). Voici un rêve auquel le "socialiste" Sombart s'efforce de donner quelque consistance ...
Sombart et le socialisme allemand
Après s'être consacré à l'étude du capitalisme, Sombart devient en 1934 le porte-parole d'un "socialisme allemand". Mais, quel est le contenu de ce socialisme allemand à la Sombart?
Sombart s'efforce de donner une définition du socialisme. Après avoir passé en revue les diverses acceptions courantes du terme et porté sur chacune d'elles un jugement, Sombart définit le socialisme comme un "normativisme social". "J'entends par là un état de vie sociale où la conduite de l'individu est déterminée en principe par des normes obligatoires, qui doivent leur origine à une raison générale, intimement liée à la communauté politique, et qui trouvent leur expression dans le "nomos" (Werner Sombart "Le socialisme allemand", Payot, paris 1938, p.77). "On n'est vraiment socialiste que lorsqu'on considère comme nécessaire que la conduite de l'individu soit soumise, dans ses manifestations extérieures, à des règles générales" (ibid.).
Sombart distingue ensuite les variétés de socialisme:
- d'après la nature de l'ordre socialiste imaginé: "du point de vue de l'espace ou de la quantité", ce peut-être un "socialisme total ou partiel"; "du point de vue du temps" "un socialisme absolu ou relatif"; "du point de vue de la forme", "un socialisme de l'égalité ou de l'inégalité", ou bien "un socialisme de l'individu ou de l'ensemble", ou encore "un socialisme méca-nistique, amorphe, espacé, abstrait, pensé, international, social" ou "un socialisme organique, morphique, technique, concret, imaginé, par classes sociales, national, étatique";
-
- d'après les fondements de l'ordre socialiste: socialisme évolutionniste ou révolutionnaire, socialisme sacré ou profane;
- d'après la mentalité en vertu de laquelle l'ordre socialiste est construit (mentalité mercantile ou héroïque).
Un socialisme anti-économiste
Sombart, lorsqu'il définit le socialisme et les variétés de socialisme, veut faire œuvre scientifique mais on sent qu'il prend déjà parti et qu'il dessine à gras traits les contours de "son" socialisme. Peu après avoir défini le socialisme, Sombart écrit: "Etant donné que la libération des forces sociales avait eu pour principal effet de mettre au premier plan l'économie et de subordonner toute l'existence de la société à ses lois, le mouvement socialiste moderne est naturellement dirigé surtout contre la primauté de l'économie. Le cri de guerre du socialisme fut: débarassons-nous de l'économie!" (ibid., p.81). On comprend déjà que le socialisme de Sombart sera essentiellement un anti-économisme. Lorsque Sombart énumère les diverses variétés de socialisme, à l'évidence il porte son choix sur certaines d'entre elles. Le socialisme qu'il prône ne peut être que "partiel", "relatif", inégalitaire, "organique, concret, national, étatique ...": il ne peut être que révolutionnaire (ou volontariste, c'est-à-dire "engendré par la liberté, par un acte créateur") et profane -ici, Sombart dévoile dans sa critique du socialisme chrétien une de ses principales sources d'inspiration: Martin Luther lui-même, pour qui l'Evangile n'enseigne en rien la façon dont on doit gouverner les hommes et administrer les biens matériels (cf "Contre les paysans pillards et meurtriers")-; Sombart se prononce enfin pour un socialisme "héroïque" -Sombart reprend ici les thèmes développés dans son livre de guerre ("Marchands et héros", 1915). Deux conceptions de la vie s'opposent: d'un côté, la conception mercantile (qualifiée pendant la guerre d'"anglo-saxonne") qui vise au "plus grand bonheur pour le plus grand nombre" (le bonheur étant "le bien-être dans l'honnêteté") et qui cultive le "pacifique côte-à-côte des commerçants" (Sombart vitupère ici les "vertus bourgeoises" qu'il avait froidement examinées dans "Le Bourgeois"); de l'autre côté, la mentalité héroïque considère la vie comme une tâche et cultive les "vertus guerrières" (cette mentalité se serait incarnée dans l'Allemagne luthérienne et prussienne). Le "socialisme allemand" de Sombart apparaît comme la traduction à tous les niveaux, notamment au niveau économique, d'une mentalité héroïque dominante: le service de la communauté, de l'Etat et du peuple prime le sevice de soi-même.
Sombart précise le sens qu'il donne au terme "socialisme allemand": " (...) l'on pourrait entendre par socialisme allemand des tendances socialistes répondant à l'esprit allemand, qu'elles soient d'ailleurs représentées par des Allemands ou des non-Allemands. Dans ce sens, on pourrait considérer comme socialisme pensé à l'allemande un socialisme qui serait relativiste, adapté à toute la nation, volontariste, profane, païen, et qu'on pourrait -à fortiori- qualifier de socialisme national. Sous le terme général de socialisme national, on peut entendre un socialisme qui tend à se réaliser dans une association nationale, qui part de l'idée que socialisme et nationalisme sont parfaitemebt adaptables" (ibid., pp. 139/140). Sombart précise encore: "Pour moi, socialisme allemand veut dire socialisme pour l'Allemagne, c'est-à-dire un socialisme qui vaut seulement et exclusivement pour l'Allemagne" (ibid.), parfaitement adapté au corps, à l'âme et à l'esprit de la Nation allemande.
Un socialisme réactionnaire?
On peut dire du socialisme de Sombart qu'il est "réactionnaire":
- en raison de ses objectifs: le socialisme allemand aspire à la "culture" qui est appelée à abolir "l'état actuel de la civilisation". Il faut pour cela briser la primauté de l'économique et des biens matériels qu'a instauré l'âge économique et se libérer de la foi dans le progrès qui obnubile l'âme allemande. Le socialisme de Sombart se veut donc une rupture avec la modernité occidentale (l'"âge économique") et l'idée même de progrès.
"Ce que j'appelle "socialisme allemand" écrit Sombart, signifie -exprimé d'une façon négative- l'abandon de tous les éléments de l'âge économique" (ibid. p.60) "sortir l'Allemagne du désert de l'âge économique, telle est la tâche que le socialisme allemand estime avoir à remplir" (ibid., p.180). Ce qui caractérise l'âge économique c'est que les mobiles économiques, les mobiles matériels "ont prédominé toutes les autres aspirations" (la théorie matérialiste de l'histoire apparaît aiinsi valable pour cette périàde, "mais pour cette période seule"); "(...) c'est la prédominance des intérêts économiques, en tant que tels, qui marque l'époque de son empreinte -étant bien entendu, naturellement, que le caractère de cette empreinte est déterminé par le caractère même de l'économie, en l'espèce l'économie capitaliste" (ibid., p;.18). L'âge économique a conduit à l'explosion démographique de l'Europe, à l'augmentation de la durée de vie moyenne, à l'accroissement considérable de la consommation et de la production des biens matériels. L'Europe industrielle est devenue une ville immense de plusieurs centaines de millions d'habitants, les autres pays du globe formant une banlieue autour de cette ville. Les rapports des pays entre eux furent bouleversés. En Europe, les sociétés et les formes de vie ont été bouleversées: Sombart constate la dissolution des communautés traditionnelles et la fin de l'enracinement, les Européens ne formant plus que des masses d'individus "errant ça et là"; notre existence a été soumise à un processus d'intellectualisation (fin de l'initiative, du travail intelligent, du métier), de matérialisation (c'est-à-dire de mécanisation) et d'égalisation (tendance à l'uniformité). La vie publique elle aussi a été bouleversée (un seul fondement et une seule mesure de la valeur: la richesse; une seule hiérarchie: celle qui se fonde sur le capital et le revenu; des partis de classe sont apparus et l'Etat s'est mis au service des intérêts économiques). Enfin, toute vie spirituelle a disparu ("la vie humaine est devenue vide de sens").
 Le socialisme allemand de Sombart, qui est une réaction contre cet état de fait, veut opérer un retour vers un ordre humain (c'est-à-dire un ordre dans lequel l'état de péché qui définit l'homme depuis la chute n'est pas nié, un ordre dans lequel l'homme peut de nouveau servir Dieu). En condamnant l'âge économique et ses manifestations diverses, Sombart apparaît proche d'autres "socialistes allemands" les plus radicaux (les nationaux-bolchéviques) condam-naient la "fuite dans le Moyen-Age", la "tendance anti-industrielle et anti-technique" (et le christia-nisme) qui caractérisaient l'idéologie des frères Strasser et de Sombart; ils repoussaient un "socialisme allemand" si ouvertement réactionnaire et se voulaient résolument modernes: ils acceptaient la société industrielle et le pouvoir de la technique les fascinait.
Le socialisme allemand de Sombart, qui est une réaction contre cet état de fait, veut opérer un retour vers un ordre humain (c'est-à-dire un ordre dans lequel l'état de péché qui définit l'homme depuis la chute n'est pas nié, un ordre dans lequel l'homme peut de nouveau servir Dieu). En condamnant l'âge économique et ses manifestations diverses, Sombart apparaît proche d'autres "socialistes allemands" les plus radicaux (les nationaux-bolchéviques) condam-naient la "fuite dans le Moyen-Age", la "tendance anti-industrielle et anti-technique" (et le christia-nisme) qui caractérisaient l'idéologie des frères Strasser et de Sombart; ils repoussaient un "socialisme allemand" si ouvertement réactionnaire et se voulaient résolument modernes: ils acceptaient la société industrielle et le pouvoir de la technique les fascinait.
- Le socialisme de Sombart apparaît réactionnaire en raison de ses références luthériennes.
Ce qui s'est passé en Europe occidentale et en Amérique depuis la fin du XVIIIème siècle est pour Sombart l'œuvre de Satan. Luther jetait son encrier sur Satan venu le tenter, Sombart, émule de Luther, utilise sa plume pour dénoncer l'œuvre de Satan: l'âge économique ...
De Luther et des luthériens, Sombart a retenu l'idée que l'autorité politique est directement instituée par Dieu. Luther a justifié l'autorité politique par le péché originel, par la corruption dont il est cause sur terre; pour Sombart, le "socialisme allemand" exige un état fort car "il met le bien de tous au-dessus du bien de l'individu" et "parce qu'il estime qu'il a à faire à l'homme pécheur". Au sein de la société, affirme Luther, "chaque homme trouve sa vocation dans les obligations ponctuelles de son état (Beruf), dans la réalisation de la charge que Dieu lui a confiée, domaine dans lequel il reste soumis à l'autorité séculière" (Jacques Droz, "Histoire des doctrines politiques en Allemagne", PUF, que sais-je?, Paris 1978, p.22). Sombart rejoint ici aussi l'opinion de Luther. Enfin, pour Luther comme pour le luthérien Sombart, la division de l'humanité en peuples et en Nations correspond à un plan divin: le peuple (Volk) est un organisme d'origine divine appelé à remplir une mission au sein de l'humanité (idée reprise et développée par le luthérien Herder).
Etre un peuple de l’esprit, de l’action et de la variété
Pour remplir la mission que Dieu lui a confiée au milieu des autres peuples, le peuple allemand doit, selon Sombart, être toujours plus un peuple de l'esprit, de l'action et de la variété.
Le luthérianisme conduit donc Sombart à l'étatisme (dans sa version prussienne), au rationalisme -les germanistes français ont révélé le lien très étroit qui unissait le luthérianisme au nationalisme allemand (Jacques Droz, "Histoire des doctrines politiques en Allemagne", Edmond Vermeil "l'Allemagne Essai d'explication", etc.) mais ils l'ont évidemment, caricaturé-, au "corporatisme" (le terme de "corporatisme" n'est peut-être pas très approprié: il ne s'agit pas ici en effet de la Corporation mais du "stand", l'état, voir plus loin).
Sombart est un nationaliste mais il apparaît en retrait par rapport à d'autres auteurs nationalistes, notamment par rapport aux "völkische" stricto sensu (ceux qui mettent l'accent sur la dimension raciale-biologique du peuple): le peuple n'est pas conçu à la manière völkisch comme race, le peuple pas plus que la Nation ou l'Etat ne sont assimilés à des organismes naturels (mais plutôt, à des entités spirituelles -l'organicisme au sens strict est rejeté comme biologisme.
Il faut remarquer que le luthérianisme professé par Sombart l'est aussi par des "socialistes allemands" proches de lui: Otto Strasser, les membres du groupe constitué autour de la revue "die Tat" notamment Hans Zehrer et Léopold Dingräve (surnom de Wilhelm Eschmann).
Le socialisme de Sombart est un anti-judaïsme: "(...) ce que nous avons défini comme étant l'esprit de l'ère économique est justement, à beaucoup d'égards, l'esprit juif. Et, dans ce sens, Karl Marx a certainement raison quand il dit que "l'esprit pratique des Juifs est devenu l'esprit pratique des peuples chrétiens" et que "les Juifs se sont émancipés dans la mesure où les chrétiens sont devenus juifs" et encore que "la nature réelle des Juifs s'est concrétisée dans la société bourgeoise"." ("le socialisme allemand" pp. 215/216). Le capitalisme incarne l'esprit juif, il appartient au "socialisme allemand" d'incarner l'esprit allemand.
Le socialisme prolétarien est un capitalisme à rebours
Par sa nature même, le socialisme allemand" s'oppose au socialisme prolétarien. Le socialisme prolétarien est "un capitalisme à rebours, le socialisme allemand est un anti-capitalisme. L'œuvre libératrice du socialisme allemand ne se limite pas à une classe ou à un autre groupe de la populaton mais s'étend à celle-ci toute entière, dans toutes ses parties (...). Le socialisme allemand n'est pas un socialisme prolétarien, petit-bourgeois ou "partiel", c'est un "socialisme populiste" (ibid.p.180). Il embrasse le peuple entier dans tous les domaines de sa vie.
Pour Sombart, le socialisme prolétarien est "le fils authentique" de l'ère économique. Il en a toutes les tares. Dans son livre sur "Le socialisme allemand", Sombart définit rapidement le contenu idéologique du socialisme prolétarien et critique ses fondements pseuod-scientifiques: il lui reproche notamment d'avoir, avec sa théorie de l'histoire, transformé "les traits particuliers de l'ère économique en traits généraux ce l'histoire de l'humanité" (ibid. p.130). Sombart ne fait que reprendre, pour l'essentiel, les thèses qu'il développa dans "Le socialisme prolétarien" en 1924.
A l'époque où Marx fit ses débuts das la vie active (entre 1840 et 1850), écrit Sombart, "le capitalisme représentait un chaos, quelque chose d'informe, dont il était impossible de prévoir avec certitude les effets et les conséquences. Celui qui en abordait l'étude, guidé par l'idée de l'évolution (et telle fut précisément l'idée directrice de Marx), pouvait assigner à son devenir tous les buts qu'il voulait. Il pouvait y voir en germe les choses les plus magnifiques, prétendre que ce chaos était fait pour enfanter un monde de merveilles, un monde idéal, dont le capitalisme serait la phase préalable, la condition nécessaire" ("L'apogée du capitalisme", pp. 15/16). On comprend ainsi les "bizarres prédictions" de Marx "relatives à l'augmentation illimitée de la productivité, à la "concentration" générale des industries, à l'écroulement final et inévitable de l'édifice économique, etc.". Ainsi se justifiait l'optimisme de Marx. Mais, constate Sombart, le capitalisme nous est désormais connu: "Nous ne sommes plus assez naïfs et ignorants pour adorer le capitalisme comme une Sainte Vierge qui porte dans ses flancs le Rédempteur" (ibid, p.17).
Se mettre à l’écoute dela “Volkheit”
Le "socialisme allemand" exige un Etat fort. Cet Etat fort s'identifie à l'Obrigkeitstaat de tradition luthérienne, dont le chef, le Prince, n'est responsable que devant Dieu, et que Sombart veut, comme Goethe, à l'écoute non du peuple mais de la "populité" (Volkheit) -sur ce dernier point, Sombart démarque Wilhelm Stapel, auteur protestant d'une "théologie du nationalisme" (dont le titre exact est: "L'homme d'Etat chrétien. Théologie du nationalisme", paru en 1932). Stapel écrivait: "Les lois justes ne doivent pas correspondre à la "volonté du peuple", mais à la "volonté de la Volkheit". Car le peuple ne sait jamais d'une volonté claire ce qu'il veut, mais la Volkheit est raisonnable, constante, pure et vraie."- Sombart n'est pas le seul à préconiser un renouveau de l'Obrigkeitstaat, d'autres en Allemagne préconisent aussi (des représentants de la jeune génération parmi lesquels ses disciples de "die Tat").
L'étatisme de Sombart n'est pas fondé sur la seule doctrine de Luther. Sombart cite Hegel et prétend se rattacher à "la conception allemande de l'Etat" (l'Etat y est envisagé comme une "union idéale" par oppo-sition à la conception rationnelle et individualiste) à laquelle sont restés fidèles les conservateurs prussiens et les socialistes allemands (Lorenz von Stein, Rodbertus, Lassalle).
L'Etat allemand qu'il imagine devrait s'inspirer de l'exemple de l'Eglise catholique ou de l'armée prussienne et, tout en étant fort, il devrait être fédératif et décentralisé.
"Le socialisme allemand désapprouve (…) la forme qu'a revêtue la société à l'époque économique". Il aspire à un ordre social "corporatif" ou "organique" ou "populaire", notions qui paraissent s'unir toutes en celle de répartition par états"("le socialisme alle-mand", p.240). Sombart établit "une distinction catégorique entre deux notions d'état: la notion sociale et la notion politique". Dans le premier sens, l'état est un "tout partiel" qui, avec d'autres "touts partiels", constitue "l'organisme social". "La notion politique de l'état-classe est par contre celle qui entend par état un groupe qui est reconnu comme tel par l'Etat-pouvoir politique, qui y est incorporé et qui en a reçu des missions déterminées. Ces missions sont principalement les suivantes: (1) entretien d'une mentalité particulière, d'un esprit particulier (…); (2) renforcement du principe de l'inégalité dans l'Eta-pouvoir politique par l'octroi à l'état-classe de privilèges déterminés ou le retrait de droits déterminés; (3) exercice de fonctions dans la vie po-litique et sociale." (ibid, p.242). Pour Sombart, c'est dans un sens politique qu'il convient d'entendre la notion d'état.
Cette conception de l'état procède à la fois du "Beruf" luthérien et du "Stand" romantique remis à l'honneur par l'école viennoise d'Othmar Spann. L'idée d'état connaît alors un vif succès dans les milieux nationalistes allemands, particulièrement chez ceux qui s'y veulent "socialistes allemands".
La technique doit se plier au nomos
Nous vivons dans l'âge technique, constate Sombart. "Si notre époque est celle de la technique, c'est qu'elle a oublié les buts pour les moyens, autrement dit, qu'elle a vu le but final dans la création artificielle des moyens". Tout le monde admire les produits d'une technique perfectionnée "sans se demander quels buts seront ainsi atteints, sans apprécier les valeurs qui seront ainsi produites" (ibid. p.276). "A quel point la technicisation de notre époque est avancée, on le voit par la façon dont le culte de la technique s'étend à tous les domaines de notre culture et les marques tous de son empreinte" (ibid, p.277). Face à cet état de fait, comment réagir? Sombart rejette les "théories fatalistes" ("la technique moderne permet aux hommes de rationaliser la terre"): le "socia-lisme allemand" domestiquera la technique et la pliera au nomos! Sombart préconise, outre un certain nombre de mesures policières, un contrôle de l'office des Brevets sur la valeur de l'invention puis un contrôle sur l'application de l'invention; la recher-che scientifique sera enlevée à l'initiative privée et confiée à un institut d'Etat; les inventeurs seront rémunérés sans tenir compte de la valeur com-merciale ou industrielle de l'invention, "ainsi la fièvre des inventeurs tombera".
Le "socialisme allemand" doit encourager une "bonne consommation" qui entretienne "des formes de vie simples et naturelles". Sombart rejette la culture prolétarienne et lui préfère une culture "bourgeoise" (c'est-à-dire une certaine aisance) et paysanne (bien enracinée et variée). Il rejette aussi le "luxe capitaliste du bourgeois" et réserve l'éclat et la splendeur à l'Etat.
La consommation en Allemagne est pour Sombart mal organisée d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Beaucoup de défauts de la consommation actuelle dépendent de certaines conditions de la vie moderne (urbanisation, notamment). L'Etat doit donc intervenir pour amener les masses à modifier leur consommation.
Le "socialisme allemand" vise aussi à l'orga-nisation de la production. Sombart veut subs-tituer une économie planifiée à l'économie "libre" (c'est-à-dire abandonnée à l'arbitraire des individus). Remarque préalable: "économie plani-fiée" ne signifie pas pour Sombart "collectivisme". Dans l'économie qu'il envisage "la propriété privée et la propriété collective subsisteront côte à côte" (éco-nomie mixte) mais la propriété privée sera "une propriété donnée en fief" (ibid., p.346). Opposé au collectivisme doctrinaire, Sombart ne manifeste cependant pas un respect exagéré pour la propriété privée: pendant la Grande Crise, il réclame la création d'une "propriété sociale" (Louis Dupeux, op. cit., p.15).
L’économie planifiée selon Sombart
Une véritable économie planifiée, d'après Sombart, se caractérise par:
- la totalité "c'est-à-dire qu'il n'y a économie planifiée que lorsque le plan embrasse l'ensemble des exploitations et des phénomènes économiques à l'intérieur d'un territoire important" ("le socialisme allemand", p.302). Mais le plan peut comptendre des zones libres "où l'individu pourra faire et laisser faire ce qui lui plaira".
- "l'unité, c'est-à-dire un centre unique d'où émane le plan" (ibid., p.303). L'économie doit être soumise au "Führerprinzip" et au-dessus des chefs d'entreprise, il doit exister une direction suprême: le "conseil suprême économique" (le centre unique de décision ne peut être que l'Etat, ou une émanation de celui-ci, c'est dire qu'une économie planifiée ne peut être qu'une économie nationale. Mais l'économie nationale doit être nécessairement planifiée si on veut qu'elle assure l'unité de la Nation).
- la variété: le plan doit tenir compte de la dimension des domaines économiques; de la structure sociale d'un pays donné; du caractère national, du niveau culturel et de toute l'histoire du pays. Les diverses branches de l'économie doivent être organisées différemment et cette organisation varie à l'intérieur même de chaque branche. L'économie planifiée doit aussi avoir des moyens d'action variés.
C'est ainsi que l'économie planifiée nationale cor-respond à cette "économique qu'Aristote opposait à la chrématistique"." (ibid., p.306).
Autarcie et autarchie
A l'économie mondiale en crise, Sombart oppose l'autarcie. "Autarcie ne signifie pas, bien entendu, qu'une économie nationale doive devenir indé-pendante d'une façon intégrale (…), qu'elle doive renoncer à toute relation internationale quelle qu'elle soit (…). En considérant les faits, je qualifierais déjà d'autarcique une économie nationale qui ne dépend en aucune façon de ses relations avec les peuples étrangers, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de recourir au commerce extérieur pour assurer sa propre existence (…)" (ibid., p.310). Mais "l'autarchie est plus importante que l'autarcie. Or l'autarchie nationale réside dans le fait que les catégories où nous pensons les relations internationales de l'avenir ne sont plus celles du commerce libre -où l'on trouvait, à la première place, la funeste clause de la nation la plus favorisée- mais celle d'une politique nationale planifiée: traités de commerce, unions douanières, droits préfé-rentiels, contingentements, interdictions d'impor-tation et d'exportation, commerce de troc, principe de la réciprocité, monopole du commerce de certains articles, etc." (ibid., p.348).
Sombart s'en prend à la grande industrie: son socialisme doit favoriser l'économie paysanne et artisanale et donc les classes moyennes. A l'opposé du socialisme prolétarien, le "socialisme allemand" met au centre de sa sollicitude non pas le prolétariat, mais les classes moyennes qui sont le plus aptes à défendre les intérêts de l'individu comme de l'Etat: c'est uniquement dans les exploitations paysannes et artisanales que l'hommes ayant une activité économique trouve la possibilité de se développer pleinement, de donner son véritable sens au travail, forme la plus importante de la vie humaine" (ibid., pp.318/319). Le "socialisme allemand" veillera au développement de l'activité artisanale, à la réorganisation du pays et s'opposera à l'indus-trialisation croissante de l'agriculture.
Domaine de l’industrie et Plan
Dans le domaine de l'industrie, Sombart préconise, outre la soumission des entreprises aux objectifs du plan:
- la socialisation de certains secteurs stratégiques de l'économie et un contrôle de l'Etat sur les entreprises abandonnées au capitalisme (notamment un contrôle du crédit);
- l'amélioration des conditions de travail et la fixation des salaires ouvriers par l'Etat;
- la fin de la concurrence sauvage et de la "con-currence suggestive" (la publicité); en revanche "la concurrence matérielle ne doit pas être exclue des cadres de l'économie dirigée";
- l'abandon du principe de rentabilité remplacé par l'"esprit ménager"
- une "production permanente et continue": "nous sommes maintenant mûrs pour une économie stationnaire et nous renvoyons l'économie "dynamique" du capitalisme là où elle avait son origine: au diable". "En stabilisant nos méthodes de production, de transport et de vente, nous supprimons une des causes des arrêts et troubles périodiques du processus économique et, par conséquent, le danger toujours menaçant du chômage, la pire des plaies de l'ère économique" (ibid., pp.340/341).
Lutte contre le chômage et travaux publics
L'Etat doit lutter contre le chômage et en même temps entreprendre la transformation de l'économie nationale. Pour lutter contre le chômage, écrit Sombart, l'Etat doit se créer une capacité d'achat supplémentaire qu'il utilisera afin d'entreprendre ou d'encourager des travaux convenables (c'est-à-dire des travaux "dont la réalisation peut entraîner une augmentaton, notamment une augmentation durable de la productivité nationale, plus exactement encore une augmentation du volume des marchandises"; ces travaux doivent être des travaux durables ou entraîner des travaux durables qui contribuent à un développement permanent de l'organisme produc-teur"; ces "travaux doivent ouvrir ces sources intaris-sables au sein de l'économie nationale allemande, afin de la rendre plus productive et susceptible de devenir indépendante"(ibid., pp 356/357).
Pour Sombart, la colonisation agricole semble le meilleur moyen de ranimer l'économie allemande et d'entraîner une transformation de celle-ci et de la société elle-même dans le sens voulu par le "socialisme allemand".
Sombart reprend ici à son compte le programme d'Heinrich Dräger et de Gregor Strasser qu'il avait approuvé et soutenu en 1932. Heinrich Dräger, fabricant de Lübeck et fondateur de la "Société d'Etudes pour une économie monétaire et une économie de crédit" (à laquelle collaborait Ernst Wagemann), défendait l'idée de "la création de travail par la création de crédit productive" (cf. Jean-Pierre Faye, "Langages totalitaires", Hermann, Paris, 1973, pp.647/648). Dräger rédigea pour Gregor Strasser (alors n°2 du Parti nazi et dirigeant de son aile gauche), la seconde partie du "programme économique de la NSDAP" publié en août 1932 sous le titre de "Sofortprogramm". Ce texte proposait un programme de création de travail de grande envergure mené sous l'égide de l'Etat et accompagné de réformes de structure. Il prévoyait, à côté de la modernisation des villes et de la construction d'habitats sains, le partage des grandes propriétés foncières non rentables en vue de l'établissement de paysans sans terre et l'exécution de travaux nécessaires au développement de l'économie rurale (ibid., pp 656 et 672).
En guise de conclusion …
Il est impossible de dissocier le scientifique Sombart, sociologue, économiste et historien de l'économie, du Sombart militant, marxiste puis "socialiste allemand" et nationaliste luthérien. Le premier étudie froide-ment le capitalisme et l'esprit capitaliste, le second les condamne en bloc et bâtit une alternative. Les deux se complètent. Pendant la Grande Guerre, "Marchands et héros" fait écho au "Bourgeois", Sombart y oppose au type humain bourgeois, porteur du capitalisme, le héros porteur de ce qu'il définira plus tard comme "socialisme allemand". Le "socialisme allemand" fait écho pendant la Grande Crise au maître-ouvrage de Sombart, "le capitalisme moderne" achevé peu avant.
Sombart a probablement influencé (et subi l'influence) de nombreux autres "socialistes allemands". Sombart avoue d'ailleurs cette parenté: le socialisme dont il se réclame, il le voit représenté en Allemagne par de nombreux nationaux-socialistes (sans doute pense-t-il plus particulièrement à Gregor Strasser), "par plusieurs adhérents à l'ancien Front Noir parmi lesquels se distingue Otto Strasser, auteur d'un livre plein de pensée, "Der Aufbau des deutschen Sozialismus" (1932), ainsi que par plusieurs isolés, comme les partisans de l'ancien milieu du "Tat" (de l'"Action"): Eschmann, Fried, Wirsing, Zehrer, etc., par des hommes comme August Winnig, August Pieper, et beaucoup d'autres encore" ("Le socialisme allemand", p.140).
Mais, les convictions personnelles de Sombart, et plus encore: son ton, le rapprocherait plutôt d'un autre courant situé nettement plus "à droite" et dans lequel on peut ranger Oswald Spengler; Wilhelm Stapel, directeur de la revue "Deutsches Volkstum" (Hambourg); Karl-Anton Prinz Rohan, directeur de l'"Europaïsche Revue"; Othmar Spann, idéologue de l'"austro-fascisme"; Edgar Jung, animateur du "Münchener Kreis", conseiller de von Papen; Heinrich von Gleichen, animateur et président du "Herrenklub"; voire Julius Evola. etc. Avec eux Sombart partage l'inspiration chrétienne, une idée de la race (et du Volk) dégagée de la biologie, une conception de l'Etat autoritaire éventuellement ditrigé par une aristocratie de naissance, une conception "universaliste" du corps social et la vision d'un ordre social fondé sur la hiérarchie des "Stände" qiu n'est pas sans évoquer, tout nuance péjorative mise à part, l'ordre des castes, etc. Un crédo qui s'oppose point par point au crédo du nationalisme populaire (Völkisch) qui s'est pourtant inspiré de Sombart pour construire sa doctrine économique.
Thierry MUDRY.
(article paru dans la revue “Orientations”, Wezembeek-Oppem, n°12, été 1990/hiver 1990-91).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, socialisme, sciences politiques, allemagne, révolution conservatrice, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 novembre 2009
Bourdieu analyse le néo-libéralisme
|
|
|
Bourdieu analyse le néo-libéralisme | |
| « L'euphémisme est indispensable pour susciter durablement la confiance des investisseurs – dont on aura compris qu'elle est l'alpha et l'omega de tout le système économique, le fondement et le but ultime, le telos, de l'Europe de l'avenir – tout en évitant de susciter la défiance ou le désespoir des travailleurs, avec qui, malgré tout, il faut aussi compter, si l'on veut avoir cette nouvelle phase de croissance qu'on leur fait miroiter, pour obtenir d'eux l'effort indispensable. […] Si les mots du discours néolibéral passent si facilement, c'est qu'ils ont cours partout. Ils sont partout, dans toutes les bouches. Ils courent comme monnaie courante, on les accepte sans hésiter, comme on fait d'une monnaie, d'une monnaie stable et forte, évidemment, aussi stable et aussi digne de confiance, de croyance, que le deutschemark : « Croissance durable », « confiance des investisseurs », « budgets publics », « système de protection sociale », « rigidité », « marché du travail », « flexibilité », à quoi il faudrait ajouter, « globalisation », « flexibilisation », « baisse des taux » – sans préciser lesquels – « compétitivité », « productivité », etc. Cette croyance universelle, qui ne va pas du tout de soi, comment s'est-elle répandue ? Un certain nombre de sociologues, britanniques et français notamment, dans une série de livres et d'articles, ont reconstruit la filière selon laquelle ont été produits et transmis ces discours néolibéraux qui sont devenus une doxa, une évidence indiscutable et indiscutée. Par toute une série d'analyses des textes, des lieux de publication, des caractéristiques des auteurs de ces discours, des colloques dans lesquels ils se réunissaient pour les produire, etc., ils ont montré comment, en Grande-Bretagne et en France, un travail constant a été fait, associant des intellectuels, des journalistes, des hommes d'affaires, dans des revues qui se sont peu à peu imposées comme légitimes […] Ce discours d'allure économique ne peut circuler au-delà du cercle de ses promoteurs qu'avec la collaboration d'une foule de gens, hommes politiques, journalistes, simples citoyens qui ont une teinture d'économie suffisante pour pouvoir participer à la circulation généralisée des mots mal étalonnés d'une vulgate économique. Un exemple de cette collaboration, ce sont les questions du journaliste qui va en quelque sorte au devant des attentes de l’économiste : il est tellement imprégné par avance des réponses qu'il pourrait les produire. C'est à travers de telles complicités passives qu'est venue peu à peu à s`imposer une vision dite néolibérale reposant sur une foi d'un autre âge dans l'inévitabilité historique fondée sur le primat des forces productives. Et ce n'est peut-être pas par hasard si tant de gens de ma génération sont passés sans peine d'un fatalisme marxiste à un fatalisme néolibéral : dans les deux cas, l'économisme déresponsabilise et démobilise en annulant le politique et en imposant toute une série de fins indiscutées, la croissance maximum, l'impératif de compétitivité, l'impératif de productivité, et du même coup un idéal humain, que l'on pourrait appeler l'idéal FMI (Fonds monétaire international). On ne peut pas adopter la vision néolibérale sans accepter tout ce qui va de pair, l'art de vivre yuppie, le règne du calcul rationnel ou du cynisme, la course à l'argent instituée en modèle universel. Prendre pour maître à penser le président de la Banque fédérale d'Allemagne, c'est accepter une telle philosophie. Ce qui peut surprendre, c'est que ce message fataliste se donne les allures d'un message de libération, par toute une série de jeux lexicaux autour de l'idée de liberté, de libéralisation, de dérégulation, etc., par toute une série d'euphémismes, ou de double jeux avec les mots. […] Si cette action symbolique a réussi au point de devenir une croyance universelle, c'est en partie à travers une manipulation systématique et organisée des moyens de communication. Ce travail collectif tend à produire toute une série de mythologies, des idées-forces qui marchent et font marcher, parce qu'elles manipulent des croyances : c'est par exemple le mythe de la globalisation et de ses effets inévitables sur les économies nationales ou le mythe des "miracles" néolibéraux, américain ou anglais. »
Pierre Bourdieu, "Dans la tête d’un banquier", Le Monde Diplomatique, septembre 1997 |
00:16 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, économie, sociologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 novembre 2009
Falange Espanola - Nationalsyndikalismus in Spanien
Falange Espanola – Nationalsyndikalismus in Spanien
Teil 1: Faschismus der Intellektuellen (1922-1932)
Verfasser: Richard Schapke, im Februar 2004 / http://www.fahnentraeger.com/
Ernesto Giménez Caballero
Im Dezember 1922 erschien in Barcelona die erste und einzige Ausgabe der Zeitung „La Camisa Negra“. Wie schon der Titel verrät, orientierte man sich am italienischen Vorbild. In der unruhigen und kosmopolitischen Mittelmeermetropole trafen katalanischer und spanischer Nationalismus und linke wie rechte Ideen aufeinander und erzeugten ein aufgeheiztes Klima, und hier entstanden auch die ersten faschistischen und semifaschistischen Splittergruppen. Wie in anderen Ländern auch, so wurden die ersten genuin faschistischen Ideen von kleinen Intellektuellenzirkeln und einigen Aktivisten verbreitet.
 Bedeutend für die Entstehung des spanischen Faschismus ist vor allem Ernesto Giménez Caballero. 1899 als Sohn einer wohlhabenden und liberalen Madrider Familie geboren, erlebte er als Wehrpflichtiger den Kolonialkrieg in Spanisch-Marokko. Sein 1923 veröffentlichter Erlebnisbericht „Notas marueccas de un soldado“ löste mit scharfer Kritik an der militärischen Führung einen kleinen Skandal aus, der Giménez Caballero vorübergehend ins Gefängnis brachte. Mit seinem Elitismus der Frontsoldaten erinnert das Buch an den Frontroman der Weimarer Republik, und wie in diesen vergleichbaren Werken wurde auch hier die Frage nach der Rolle der Nation und nach ihrem Platz in der Welt gestellt. In der Folgezeit lehrte der Spanier als Englischdozent an der französischen Universität Straßburg und entwickelte alsbald einen ausgesprochenen Hispanismus als Gegengewicht zu den Einflüssen des westlichen Materialismus. Die Regionen und Völker der Iberischen Halbinsel sollten sich unter einem gemeinsamen Zeichen, einer gemeinsamen Aufgabe („Haz“) vereinigen. Giménez Caballero heiratete die Schwester des italienischen Konsuls in Straßburg und wurde von dieser in die Welt des Faschismus eingeführt. Bald kehrte er nach Madrid zurück und reihte sich hier als Chefredakteur der „Gaceta Literaria“ in die literarische Avantgarde ein.
Bedeutend für die Entstehung des spanischen Faschismus ist vor allem Ernesto Giménez Caballero. 1899 als Sohn einer wohlhabenden und liberalen Madrider Familie geboren, erlebte er als Wehrpflichtiger den Kolonialkrieg in Spanisch-Marokko. Sein 1923 veröffentlichter Erlebnisbericht „Notas marueccas de un soldado“ löste mit scharfer Kritik an der militärischen Führung einen kleinen Skandal aus, der Giménez Caballero vorübergehend ins Gefängnis brachte. Mit seinem Elitismus der Frontsoldaten erinnert das Buch an den Frontroman der Weimarer Republik, und wie in diesen vergleichbaren Werken wurde auch hier die Frage nach der Rolle der Nation und nach ihrem Platz in der Welt gestellt. In der Folgezeit lehrte der Spanier als Englischdozent an der französischen Universität Straßburg und entwickelte alsbald einen ausgesprochenen Hispanismus als Gegengewicht zu den Einflüssen des westlichen Materialismus. Die Regionen und Völker der Iberischen Halbinsel sollten sich unter einem gemeinsamen Zeichen, einer gemeinsamen Aufgabe („Haz“) vereinigen. Giménez Caballero heiratete die Schwester des italienischen Konsuls in Straßburg und wurde von dieser in die Welt des Faschismus eingeführt. Bald kehrte er nach Madrid zurück und reihte sich hier als Chefredakteur der „Gaceta Literaria“ in die literarische Avantgarde ein.
In dieser Funktion wurde Giménez Caballero zum führenden Autor der „Generation von 1927“. Diese literarisch-intellektuelle Vorhutgruppe strebte nach einer Politisierung der Literatenszene. Eine Kombination der extremistischen Manifestationen des Avantgardismus mit dem kulturellen Nationalismus – nach Vorbild des italienische Frühfaschismus - sollte die Rückwärtsgewandtheit Spaniens überwinden und den Schlüssel zur Lösung seiner Probleme sein. Eine neue Kunst und eine neue Kultur hatten ganz Sinne Nietzsches oder d´Annunzios nichts weniger als die Schaffung eines neuen Menschen zum Ziele. Zunächst war die Gruppe kulturpluralistisch orientiert, sie gewann wichtige Impulse aus der Modernität und Vitalität der Katalanen und Portugiesen. Giménez Caballero machte sich nicht zuletzt um die Ausstellung moderner Literatur aus Katalonien, Portugal, Argentinien und Deutschland in Madrid verdient. Eine Rundreise durch den Mittelmeerraum endete 1928 in Italien, wo er sein Damaskus erlebte – der spanische Avantgardist war überwältigt vom italienischen Faschismus. Es schien ihm, als hätte der Faschismus Rom als Zentrum der modernen Zivilisation und des Christentums wieder belebt: Der PNF entwickelte neue kulturelle und politische Formen, um unter Vereinigung der Intellektuellen und der Masse die Modernisierung und die kohärente innere Entwicklung Italiens durchzuführen. Hierbei stand der Faschismus in den Augen des spanischen Besuchers sowohl für die echte Revolution der Moderne, als auch für die katholisch-lateinische Volkskultur. Er überformte Materialismus und Künstlichkeit, um sie mit der Volkskultur und einer nationalistisch aufgeladenen Atmosphäre zu einer gewalttätigen und weitreichenden nationalen Mission zu verschmelzen. Giménez Caballero schwebte fortan das italienische Modell als Lösung für Spaniens Schwierigkeiten vor, die seiner Ansicht nach vor allem auf die unausgegorene Übernahme nordeuropäischer Ideen zurückzuführen waren.
 Das Bekenntnis des Chefredakteurs der „Gazeta“ vom 15. Februar 1929 zum Faschismus löste eine offene Redaktionskrise aus. Zugleich kündigte Giménez Caballero die spanische Übersetzung des Malaparte-Klassikers „Italia contro Europa“ an. Er adaptierte Curzio Malapartes militanten und populistischen Nationalsyndikalismus und erklärte, zur Schaffung eines spanischen Faschismus müsse man viel weiter gehen als der noch an der Macht befindliche Diktator Primo de Rivera. Der eher konservative Teil der Redaktionsmannschaft verabschiedete sich, um protofaschistischen Intellektuellen wie einem gewissen Ramiro Ledesma Ramos zu weichen. Noch vermied Giménez Caballero den Begriff „Faschismus“, thematisierte aber immer mehr die Gewalt als Weg zur kulturellen und nationalen Erneuerung Spaniens. Ein panromanischer Faschismus ging einher mit scharfer Kritik am Rassismus und Antisemitismus der deutschen Rechten, generell waren der Gruppe protestantisch geprägte Nationen suspekt. Allerdings war die „Gazeta“ bei Beginn der Zweiten Republik weitgehend isoliert. Als Giménez Caballero sich der sozialistischen Linken annäherte und dort nach seinen Vorstellungen nahe kommenden Persönlichkeiten suchte, galt er vielen ehemaligen Freunden und Anhängern als Opportunist.
Das Bekenntnis des Chefredakteurs der „Gazeta“ vom 15. Februar 1929 zum Faschismus löste eine offene Redaktionskrise aus. Zugleich kündigte Giménez Caballero die spanische Übersetzung des Malaparte-Klassikers „Italia contro Europa“ an. Er adaptierte Curzio Malapartes militanten und populistischen Nationalsyndikalismus und erklärte, zur Schaffung eines spanischen Faschismus müsse man viel weiter gehen als der noch an der Macht befindliche Diktator Primo de Rivera. Der eher konservative Teil der Redaktionsmannschaft verabschiedete sich, um protofaschistischen Intellektuellen wie einem gewissen Ramiro Ledesma Ramos zu weichen. Noch vermied Giménez Caballero den Begriff „Faschismus“, thematisierte aber immer mehr die Gewalt als Weg zur kulturellen und nationalen Erneuerung Spaniens. Ein panromanischer Faschismus ging einher mit scharfer Kritik am Rassismus und Antisemitismus der deutschen Rechten, generell waren der Gruppe protestantisch geprägte Nationen suspekt. Allerdings war die „Gazeta“ bei Beginn der Zweiten Republik weitgehend isoliert. Als Giménez Caballero sich der sozialistischen Linken annäherte und dort nach seinen Vorstellungen nahe kommenden Persönlichkeiten suchte, galt er vielen ehemaligen Freunden und Anhängern als Opportunist.
Ramiro Ledesma Ramos und die Geburt des Nationalsyndikalismus
Der philosophische Essayist und Schriftsteller Ramiro Ledesma Ramos sollte dem vagen Projekt Giménez Caballeros eine viel deutlichere, radikalere Form verleihen. War letzterer der erste faschistische Intellektuelle Spaniens, so sollte ersterer den ersten spanischen Faschismus entwerfen. Ledesma Ramos wurde 1905 in eine Lehrerfamilie der Provinz Zamora hineingeboren. Zunächst lebte er als Postbeamter in Madrid und entwickelte sich als Autodidakt zum pessimistischen Intellektuellen. Sein Erstlingswerk „El sello de la muerte“ verrät deutliche Nietzsche-Einflüsse. Nach einer Vorlaufzeit konnte der verhinderte Philosoph sich an einem angesehenen Institut der Madrider Universität immatrikulieren und dort 1930 seinen Abschluss in Philosophie machen. Schon vor Beendigung des Studiums galt er als der belesenste Jungintellektuelle der Hauptstadt und erwarb sich einen Namen als Übersetzer deutscher Philosophen und als Essayist.
Der in den Salons von Ortega y Gasset und Giménez Caballero verkehrende Ledesma Ramos kam bald nach Studium Husserls und Heideggers zu dem Schluss, die Angst und die Bedeutungslosigkeit des menschlichen Lebens könnten nur durch den Willen und das Erreichen von Zielen bezwungen werden, wobei die von den Anarchisten entlehnte Direkte Aktion als probates Mittel erschien. Die spanische Kultur galt ihm als mangelhaft, da Spanien als einzige große Nation keine bedeutende Philosophie und keine intellektuelle Diktatur entwickelt habe. Unter Rekurs auf die Hispanisten formulierte Ledesma Ramos, der Niedergang des Landes sei durch eine Kombination von militärischen und kulturellen westlichen Einflüssen hervorgerufen worden. Eine Rückkehr zur Vergangenheit wurde verworfen – Spanien brauchte eine moderne Revolution mit Massenbasis, Autorität, Willenskaft, nationaler Einheit, zentraler Führung und einem revolutionären Wirtschaftsprogramm. Spanien brauchte also so etwas wie den Faschismus. Die Madrider Kulturbourgeoisie reagierte irritiert, als ihr bisheriger Liebling sich im Rahmen eines literarischen Banketts zu Ehren von Giménez Caballero zu seiner Radikalisierung bekannte. Nach Studienende begab Ledesma Ramos sich auf Reisen und verbrachte unter anderem 4 Monate in Heidelberg, wo er in engen Kontakt mit der als besonders extrem geltenden Ortsgruppe des NS-Studentenbundes geriet.
 Zum Entsetzen seines bisherigen sozialen Umfeldes gründete Ramiro Ledesma Ramos zusammen mit einer Handvoll Sympathisanten die Zeitschrift „La Conquista del Estado“, die sich nicht nur äußerlich an Curzio Malapartes gleichnamiges Pamphlet (faktisch eine Theorie des Staatsstreiches) anlehnte und am 14. März 1931 erstmals erschien. Emblem der Zeitschrift waren Joch und Pfeile, „yugo y flechas“, das Symbol von Ferdinand und Isabella, den Katholischen Königen. Ein politisches Manifest bombardierte den Leser mit Parolen gegen Liberalismus, gegen den internationalen Marxismus und die Dekadenz der spanischen Gegenwart.
Zum Entsetzen seines bisherigen sozialen Umfeldes gründete Ramiro Ledesma Ramos zusammen mit einer Handvoll Sympathisanten die Zeitschrift „La Conquista del Estado“, die sich nicht nur äußerlich an Curzio Malapartes gleichnamiges Pamphlet (faktisch eine Theorie des Staatsstreiches) anlehnte und am 14. März 1931 erstmals erschien. Emblem der Zeitschrift waren Joch und Pfeile, „yugo y flechas“, das Symbol von Ferdinand und Isabella, den Katholischen Königen. Ein politisches Manifest bombardierte den Leser mit Parolen gegen Liberalismus, gegen den internationalen Marxismus und die Dekadenz der spanischen Gegenwart.
Spaniens Jugend wurde aufgerufen, durch gewaltsames Vorgehen gegen die bestehende Ordnung und die Parteien einen Neuen Staat zu schaffen. Dieser neue Staat sollte totalitäre Züge tragen, Freiheit gewährte er nur innerhalb der von ihm gesetzten Ordnung. Zwar wurden die Verschiedenheit und die Autonomie der spanischen Regionen und Nationalitäten anerkannt, aber der Separatismus sollte ausgerottet werden. Aufgabe des Neuen Staates war die Erfüllung der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Ziele des spanischen Volkes. Die gesamte spanische Wirtschaft war in Zwangssyndikaten zusammenzufassen, die wiederum zwecks höherer Effektivität und vermehrter sozialer Gerechtigkeit der staatlichen Kontrolle unterstanden. Hier zweckentfremdete Ledesma Ramos den anarchistischen Syndikatsbegriff: Verstanden die Anarchisten der CNT hierunter die Zusammenfassung aller Arbeitnehmer, so ging er von einem vertikalen Syndikat unter Einschluss der Arbeitgeber aus. Das Programm sah eine radikale Landreform mit Enteignung der parasitären Großgrundbesitzer, Landverteilung an das Agrarproletariat und Genossenschaftsbildung vor. Darüber hinaus forderten Spaniens erste Nationalsyndikalisten die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien, der Banken, der Versicherungen und des Transportwesens, strikte Außenhandelskontrolle und staatliche Wirtschaftsplanung – ein ausgesprochen „linker“ Faschismus.
Der Gruppe schwebte nicht die Gewinnung von Wählerstimmen vor, sondern der Aufbau von militanten und bewaffneten Kampfverbänden. Diese Milizen sollten den als anachronistisch und bourgeois empfundenen pazifistischen Antimilitarismus zertrümmern und die Politik durch einen militärischen Sinn für Kampf und Verantwortung anreichern. Als organisatorische Grundlagen der Bewegung waren syndikalistische (gewerkschaftliche) und politische Zellen vorgesehen. Ledesma Ramos war sich bewusst, dass er eine spanische Form des revolutionären Nationalismus schaffen musste. Nicht umsonst war und bleibt er der aggressivste und rücksichtsloseste nationalistische Intellektuelle, den Spanien jemals hervorgebracht hat.
Die Klärung des Verhältnisses zur noch immer mächtigen katholischen Kirche erfolgte in der „Conquista“-Ausgabe vom 20. Juni 1931. Ledesma Ramos verkündete, die Kirche könne niemals irgendeine Souveränität gegenüber dem Staat beanspruchen. Zwar seien die religiösen Gefühle der Bevölkerung zu respektieren, aber die katholische Kirche sei über Jahre an Verbrechen gegen den Wohlstand des spanischen Volkes beteiligt gewesen – der Staat müsse daher ihre Rolle neu definieren. Verklausuliert hieß das Enteignung und strikte Trennung von Kirche und Staat. "Die nationale Revolution ist ein Unternehmen, das es als Spanier zu verwirklichen gilt, katholisches Leben hat damit nichts zu tun, denn es betrifft nicht den Spanier, sondern den Menschen, der seine Seele retten will." Hier wurde also nicht an die traditionelle katholisch bestimmte Gesellschafts- und Staatsordnung angeknüpft. Die Propaganda wandte sich ohnehin an die sozial benachteiligten Schichten wie Landarbeiter und Industrieproletarier, die der Kirche weitgehend entfremdet waren. Durch die Parolen vom syndikalistischen Staat sollten von den Grabenkämpfen innerhalb der CNT frustrierte Anarchisten gewonnen werden, bei denen schließlich auch Malaparte einen gewissen Ruf besaß. Das Werben um die Ultralinke hatte wenig Erfolg, auch wenn sich der Madrider Anarchistenführer Nicasio Álvarez de Sotomayor der Gruppe anschloss. Im Juli 1931 landete Ledesma Ramos als Folge seiner aggressiven Agitation erstmals im Gefängnis, und nach mehreren Ermittlungsverfahren und Verboten stellte die „Conquista del Estado“ im Oktober ihr Erscheinen für immer ein. Trotz der Bedeutungslosigkeit der Gruppe hatte Ramiro Ledesma Ramos als erster die Idee eines revolutionären Nationalsyndikalismus propagiert und der Bewegung wichtige Schlagworte gegeben.
Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista
Onésimo Redondo Ortega, der dritte wichtige spanische Frühfaschist, wurde wie Ledesma Ramos im Jahre 1905 geboren, und zwar in Valladolid. Redondo Ortega war zunächst als Finanzbeamter tätig und arbeitete dann als wissenschaftlicher Assistent an der Handelsschule Mannheim, wo er ebenfalls mit dem Nationalsozialismus in Berührung kam. Anschließend beschäftigte ihn ein Verband altkastilischer Großgrundbesitzer, wobei er Einblicke in Fragen der wirtschaftlichen Organisation gewann. Die Kontakte zu den ländlichen Arbeitgebern Altkastiliens sollten niemals abreißen. Um Redondo Ortega sammelte sich ein weiterer Zirkel spanischer Faschisten, der sich im Gegensatz zum Radikalfaschismus der „Conquista“-Gruppe eher auf nationale Einheit, traditionelle spanische Werte und soziale Gerechtigkeit besann. Am 13. Juni 1931 erschien die Wochenzeitung „La Libertad“. Unter Verherrlichung der traditionellen ländlichen Gesellschaftsordnung wurde Kastilien aufgerufen, den spanischen Gesamtstaat vor Materialismus und Kulturzersetzung zu retten. Antisemitische und frauenfeindliche Anklänge waren hierbei durchaus vorhanden.
Da der politische Katholizismus als unzureichend erschien, strebte Redondo Ortega den Aufbau einer radikal-nationalistischen Jugendbewegung an – konservativ in Religions- und Kulturfragen, aber militant in Stil und Taktik. Die „Libertad“ bekannte sich offen zu einer gesunden Gewaltanwendung. Spanien lebe bereits im Zustand des Bürgerkrieges, also solle sich die Jugend zum Kampf bereitmachen. Im August gründete der Zirkel zusammen mit Studenten der Universität Valladolid und anderen Anhängern die „Juntas Castellanas de Actuación Hispánica“. Zwar war diese Gruppierung deutlich reaktionärer als Ledesma Ramos, aber im Kampf gegen Materialismus, Dekadenz und Bourgeoisie lagen erhebliche Gemeinsamkeiten.
Am 10. Oktober 1931 kündigte die „Conquista del Estado“ den Zusammenschluss beider Fraktionen zu den „Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista“ (Nationalsyndikalistische Angriffsgruppen, JONS) an. Man übernahm yugo y flechas, zu denen sich als Symbol für den revolutionären Charakter der Bewegung die schwarz-rote Fahne der Anarchisten gesellte. Basiseinheit war die Gruppe aus 10 militantes unter einem Gruppenführer; 10 Gruppen wiederum bildeten eine Junta unter Leitung eines Triumvirates. Der Lokalrat, consejo local, als Parteigremium auf unterster Ebene setzte sich aus allen Triumviraten der betreffenden Gemeinde zusammen. Auch dem consejo local stand ein Dreiergremium vor. Die Lokalräte entsandten Delegierte in den consejo provincial, und die Delegierten der Provinzialräte bildeten schließlich den consejo nacional. Als höchstes Parteiorgan erteilte der Nationalrat bindende Befehle, Richtlinien und Mitteilungen. Die Geschäftsführung hatte ein aus den Reihen des consejo nacional gewähltes Zentraltriumvirat inne. Zu einer echten Verschmelzung kam es nicht, und faktisch bestanden die Jonsistas aus zwei verschiedenen Flügeln um Ledesma Ramos und Redondo Ortega. Ungeachtet der angesichts der zahlenmäßigen Schwäche maßlos übertriebenen Organisationsstruktur verhinderte diese doch, dass es eine absolute Befehlsgewalt eines Einzelnen gab. Als erste überregionale faschistische Organisation standen die JONS sowohl in Frontstellung gegen die Linke wie gegen die katholische und monarchistische Rechte.
Das Programm der JONS stellte gegenüber dem der „Conquista“-Gruppe einen Rückschritt dar. Der Parlamentarismus sollte durch ein sich auf die nationalsyndikalistischen Milizen und die Volksmassen stützendes Regime abgelöst werden. Innenpolitisch waren einerseits Anerkennung der katholischen Tradition, Unterordnung des Individuums unter die Ziele des Vaterlandes, Säuberung der Verwaltung, Verbot aller marxistischen und antinationalen Parteien, Ausmerzung ausländischer Einflüsse und Aburteilung von Spekulanten und verräterischen Politikern vorgesehen. Auf der anderen Seite enthielt das Programm aber auch das Konzept der Zwangssyndikate (die unter dem besonderen Schutz des Staates stehen sollten) und der staatlichen Wirtschaftskontrolle. Aller Reichtum hatte sich den Belangen der Nation unterzuordnen, zu denen explizit der wirtschaftliche Aufbau, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit im Bildungswesen und eine gemäßigte Agrarreform gehörten. Gänzlich neu war die Forderung nach einer imperialistischen Außenpolitik, vor allem in Hinblick auf Gibraltar, Marokko und Algerien. Erwähnt sei noch die interessante Bestimmung, dass im Neuen Staat die Inhaber höchster Ämter mit Erreichen des 45. Lebensjahres zurückzutreten hatten.
Redondo Ortega führte infolge seiner größeren finanziellen Möglichkeiten zunächst das Wort, aber für Ledesma Ramos blieb infolge zahlreicher vager Definitionen Freiraum genug. Einzelne Aktivisten und kleine Gruppen von Kommunisten, Trotzkisten und Anarchisten konnten gewonnen werden. Die Expansion der JONS erfolgte vor allem im so genannten „anarchistischen Bogen“ Spaniens zwischen Barcelona, Valencia und Málaga sowie in Madrid. Gerade hier etablierte sich eine stark mit ehemaligen Anarchisten durchsetzte und entschieden antiklerikale Gruppe. Im Verlauf des Jahres 1932 waren die Jonsistas kaum aktiv. Ledesma Ramos provozierte am 2. April 1932 im Madrider Athenäum den ersten Zusammenstoß mit Linken, es folgten Angriffe auf linke Zeitungskioske oder Sowjetfilme zeigende Kinos. Die Fraktion Redondo Ortegas zeigte sich aktiver und lieferte sich mehrfach heftige Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern. Auf einer Demo gegen den katalanischen Separatismus am 11. Mai 1932 in Valladolid hatte die Bewegung ihren ersten Toten zu beklagen, als es zu einer Straßenschlacht mit der Polizei kam. Da der rechte Parteiflügel am Rande in den dilettantischen Rechtsputsch des General Sanjurjo verwickelt war, musste Redondo Ortega sich im August 1932 nach Portugal absetzen. Ledesma Ramos und der Großteil der Aktivisten wurden zunächst inhaftiert, und am Jahresende zählten die JONS vielleicht 200 auf freiem Fuß befindliche Mitglieder.
Lesen Sie auch:
* Falange Espanola – Nationalsyndikalismus in Spanien - Teil 2: José Antonio und die Gründung der Falange 1933-1934
* Falange Espanola – Nationalsyndikalismus in Spanien - Teil 1: Faschismus der Intellektuellen (1922-1932)
* Falange Espanola – Nationalsyndikalismus in Spanien - Prolog: Die Entstehung des spanischen Nationalismus
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, syndicalisme, national-syndicalisme, phalange, phalangisme, fascisme, espagne, guerre civile espagnole, années 30, théorie politique, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 novembre 2009
Triste mondialisation...
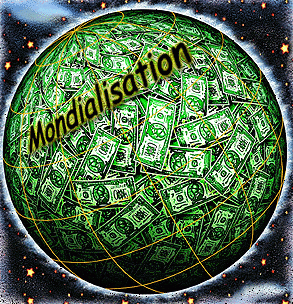
| Triste mondialisation... |
| « En vingt ans, les pays de l'Est se sont mondialisés à la vitesse grand V. A peine le mur de Berlin était-il tombé que les enseignes du "monde libre" déboulaient en force pour y planter leur logo. […] Les mêmes chaînes de vêtements low-cost, les mêmes fast-foods, les mêmes centres commerciaux, reproduits à l'identique et à l'infini aux quatre coins de la planète. Les sorties dans les shopping centers sont d'ailleurs devenues un but d'excursion en soi. […] Grâce à Ikea, les intérieurs du monde ont d'ailleurs de plus en plus tendance à tous se ressembler. Ne dit-on pas que, déjà, un Européen sur dix aurait été conçu sur un lit Ikea ? Pour ensuite vivre sa vie dans des salons et des chambres à coucher copies conformes des pages du catalogue. Question gastronomie, voyager loin ne permet plus forcément de manger différemment et de découvrir des plats typiques. Tant il devient difficile d'échapper à la dictature des hamburgers et à leurs corollaires : les pizzas, les crêpes et les sandwiches, assortis de quelques nouilles sautées. Ces fleurons de la world food nous poursuivent jusqu'au bout du monde, sur les plages de Tunisie ou de Thaïlande, comme au pied des pyramides d'Egypte ou de la Grande Muraille de Chine. Est-ce pour éviter tout dépaysement ? L'aéroport de Genève vient en tout cas d'inaugurer "un nouveau concept de restauration" (sic) qui, sous l'appellation Les Jardins de Genève, réunit la quintessence de la bouffe mondialisée – Burger King, Starbucks Coffee, Upper Crust... Mais à l'heure où même le Musée du Louvre à Paris va prochainement accueillir un McDonald's, il n'y a plus qu'à s'incliner. Et à se diriger dare-dare vers le premier M jaune venu, pour y commander tranquillement son McRösti. »
Catherine Morand, Le Matin Dimanche, 18 octobre 2009 |
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : globalisation, libéralisme, néo-libéralisme, mondialisation, économie, universalisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, sociologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La resistencia corporativa en Francia: socialismo, tradicionalismo y "comunidades naturales"
| La resistencia corporativa en Francia: socialismo, tradicionalismo y “comunidades naturales”
por Sergio Fernández Riquelme / http://www.arbil.org/ Una introducción histórica explicativa | |
| Socialismo y tradicionalismo, supuestos enemigos doctrinales (histórica e ideológicamente) presentan rasgos comunes, e incluso caminos paralelos, en la Historia de las ideas políticas y sociales, en especial sobre el tema del corporativismo. Como bien demostró en el caso español Gonzalo Fernández de la Mora, mostrando las raíces organicistas comunes en tradicionalistas y socialistas, e incluso de liberales (al calor de la introducción del krausismo en España), “lo corporativo” sigue siendo es una realidad presente en el funcionamiento extraparlamentario (sindicatos y lobbys, colegios profesionales y grupos de presión, intereses económicos y poderes locales) de las democracias parlamentarias en Europa y en América a inicios del siglo XX. Y esta realidad, en su trayecto histórico, puede ser ejemplificada en el caso francés, paradigma del centralismo estatista y laicista, pero sede también de importantes debates y teorías de naturaleza corporativa. Así, y como otras modalidades de la Política social difundidas desde 1848 [1] , el corporativismo fue respuesta directa a la Cuestión social, presentada por historiadores sociales, sociólogos y juristas como consecuencia del impacto de la Revolución industrial, y como un mal que afectaba a la relación armónica entre clases. Pero lo corporativo no solo asumió la forma de una política social jurídica (política del trabajo) o asistencial; su especificidad radicaba en su propuesta grupal de regulación del conflicto surgido en las relaciones entre la propiedad y el trabajo. Los cuerpos sociales intermedios desempeñaban para Patrick de Laubier, un papel mediador clave para alcanzar la finalidad de la Política social, la “justice sociale” [2] . El poder político se convertía por ello en “l´intemédiaire de grupes organisés”, y el corporativismo aparecía como mediación entre el Estado y el Sindicalismo, los dos actores principales de la Política social. En este contexto, el notable desarrollo conceptual y doctrinal del corporativismo francés, desde su génesis en el siglo XIX, de tanta influencia en España [3] , no fue siempre paralelo al de su institucionalización jurídico-política. Bajo la herencia de la Ley Le Chapelier (1791), que marcó el camino en Europa a la destrucción legal de las “comunidades naturales” (en esencia las funciones sociales de municipios, gremios y familias), durante el siglo XIX tanto el liberalismo jacobino como el doctrinario hicieron caso omiso a las propuestas “socialistas” de Luis Blanc y Hénri de Saint Simon, y al legado “tradicionalista” de Luis de Bonald [1754-1840] y de Joseph de Maestre [1753-1821]. Incluso, las propuestas de reforma corporativa del modelo constitucional de la III República francesa, preconizadas por Émile Durkheim, Leon Duguit, M. Hariou, además de las tesis organicistas del liberal Bertrand de Jouvenel, no alcanzaron el sueño de una Cámara corporativa o gremial/profesional. Ni corporativismo ni solidarismo; sólo las presiones sindicales (con la CGT a la cabeza) y la influencia del Reichwirtschaftsrat de la Constitución de Weimar (1919), permitieron crear en Francia el Consejo Nacional de economía por el Decreto de 19 de enero de 1925, acuerdo corporativo reeditado en L´Accord de Matignon de junio de 1936 bajo la presidencia del frentepopulista León Blum [1872-1950] entre “les puissances économiques”: la CGPF empresarial y la CGT sindical [4] . Pero en este proceso de infructuosa institucionalización destacaron las elaboraciones de la sociología católica. A. de Mun, L. Harmel, F. Le Play o R. la Tour asumían ciertas tesis de los legitimistas de Bainville y los tradicionalistas de Bonald, especialmente la idealización de la pretérita sociedad de estamentos y gremios, de jerarquía patriarcal y núcleos familiares, de autonomías y solidaridades comunales. Frédéric Le Play [1886-1882] planteó una concepción “subsidiaria” del reformismo obrero y social, que situaba a la familia como “prototype de l´Etat” [5] . Esta propuesta fue sintetizada en la doctrina que denominaba como “patronalismo”, desarrollada en La réforme sociale en France (1864) y L´Organisation du travail (1870). Partiendo de la subordinación de lo político a lo ético, y de la interacción entre ciencia positiva y religión, Aunós leía en Le Play como “las intervenciones del Estado deben ser muy espaciadas, concretas y llenas de circunscripción, mostrándose igualmente pesimista en lo que se refiere al papel que han de desempeñar las asociaciones de clase”, y complementadas por el trabajo doméstico, la función social de la familia y la conciliación sociolaboral [6] . Igualmente, en el seno de la “L´Association Catholique” [1876-1890], junto al Manuel d´une corporation chrétienne (1890) de L.P. Harmel, destacó la obra del diputado católico Albert de Mun [1841-1914], dedicado no sólo a desarrollar los círculos católicos obreros en Francia, llegando hasta casi 30.000 miembros, o defender en el Parlamento de la III República los derechos de los fieles al magisterio vaticano; además generó una relevante teoría en sus discursos recogidos en La question ouvriére (1885) y L´Organisation professionelle (1901) [7] . Pero de todos los autores antes citados, destacó sobremanera el marqués René La Tour du Pin [1834-1942], de quién Aunós resaltaba su aportación de “los verdaderos cauces de las reformas sociales y de la organización corporativa” [8] . La Tour du Pin encabezó el modelo de Monarquía social católica desde la Francia finisecular. Frente al capitalismo burgués y el socialismo bolchevique, La Tour defendía la necesidad de un “Orden social católico” basado en la corporación profesional (de raigambre medieval): un orden que regulase corporativamente el mundo del trabajo (“organización corporativa de los talleres”), la economía y la política. “La constitución nacional” (o “leyes fundamentales del Reino”) era enemiga de las formas republicanas y monárquicas que sostenían el principio de la soberanía nacional. Las luchas sociales entre propietarios y obreros, la anarquía pública y el individualismo moral (visibles en 1848 y 1873) requerían con urgencia un nuevo modelo político social corporativo, de naturaleza cristiana y de modelo medieval-gremial. La doctrina sobre un “orden social cristiano” de La Tour se fundaba en el magisterio pontificio (religión católica), la mitología medieval (monarquía tradicional) y la fenomenología social (corporativismo de Durkheim). Bajo esta tras tradiciones, su orden resultaba así católico (“propiedad de Dios” bajo administración humana), monárquico (“un rey en la cúspide” que “cumple el más alto de los trabajos de la nación” y por ese “trabajo se hace verdaderamente rey”) traducido al lenguaje político-social), y orgánico (“por el cual los elementos que la componen se si ente unidos y solidarios, formando parte de un conjunto orgánico”). Un orden que se encontraba en condiciones, para La Tour, de adaptarse a las mutaciones contemporáneas mediante un “régimen corporativo” que “no debe implicar el retorno a las corporaciones medievales, sino la formación de otras más adecuadas al tiempo presente, a base de patrimonio corporativo, de la intervención en su constitución y gobierno de todos los elementos productores y el ascenso dentro de los oficios por obra de la capacidad profesional” [9] . Ahora bien, pese a décadas de notable fecundidad doctrinal, la escuela corporativa católica francesa se sometió, en gran parte, a las exigencias de realliment de la democracia cristiana con la III República francesa. Pese a ello, el fracaso del sistema político representativo de la III República, pese a la unidad nacional alcanzada por la movilización durante la I Guerra mundial, dio alas a nuevas fórmulas corporativas asentadas en regímenes fuertes y autoritarios, no directamente vinculadas al magisterio católico. En este proceso jugaron un papel determinante los doctrinarios participantes en el diario L`Action française (1905-1945), continuador de la Revue d'Action française fundada por Jacques Bainville [1879-1936]; intelectuales que definieron un moderno nacionalismo contrarrevolucionario, el cual fue modelo de renovación de los discursos, medios de difusión y aparatos organizativos de la creciente derecha antiliberal española [10] . En este movimiento jugó un papel decisivo su principal fundador e ideólogo, Charles Maurras [1868 1952], que convenció a cierto sector del nacionalismo galo de la necesidad de las tesis monárquicas y católicas. Influido por el nacionalismo de Maurice Barrès, Maurras retomó en esta revista el movimiento fundado en 1898< por el profesor de Filosofía Henri Vaugeois y el escritor Maurice Pujo. Trois idées politiques (1898) [11] fue el testimonio de su primera evolución ideológica [12] . De la mano de Maurras se generaba un nuevo tradicionalismo francés que integraba el bagaje intelectual del nacionalismo laico y positivista. Tras situarse radicalmente en contra del régimen parlamentario de la III República, Maurras encabezó la modernización de la doctrina tradicionalista combinando el positivismo sociológico y el legitimismo orleanista de Bainville [13] . En su obra Enquête sur la monarchie (1900-1909) fue delimitando doctrinalmente este nacionalismo integral y monárquico, que atrajo a numerosos republicanos y sindicalistas vinculados al ideal corporativo o a posiciones antiparlamentarias; su síntesis entre Nación y Tradición rompía la histórica posición antinacional del legitimismo, atrayendo a numerosos sectores de las clases medias deudoras espirituales de un catolicismo convertido en factor de legitimación cultural y de cohesión social, aunque nunca en dogma a seguir (visible en el público agnosticismo de Maurras) [14] . Maurras sintetizaba así las dispersas corrientes doctrinales de la derecha francesa, desde De Maistre hasta Bonald, pasando por Taine, Renan, Fustel de Coulanges, e incluso Proudhon- que había brotado a lo largo del siglo XIX como reacción al significado social y político de la Revolución de 1789 (tesis contenida en Romantisme et Révolution, 1922) [15] . Con todo ello, desde una visión positivista propia, que designó con el nombre de “empirismo organizador”, Maurras proclamó un nuevo orden en la sociedad, regido por una serie las leyes descubiertas por la historia y la sociología [16] . Siguiendo a Comte, Maurras asimilaba la sociedad a la naturaleza como “realidad objetiva”, independiente de la voluntad humana [17] . La sociedad suponía un “agregado natural” determinado por las leyes de jerarquía, selección, continuidad y herencia; así criticaba el romanticismo estético y literario de J.J. Rousseau, y vinculaba este método con la tradición católica y clasicista francesa (L'Action française et la religion catholique, 1914). Por ello cuestionaba tanto la Revolución de 1789, auténtica insurrección contra la genuina tradición francesa, representada por el orden monárquico, católico y clásico, inicio de la decadencia nacional que Francia padecía a lo largo del siglo XIX, y que llegaría a su cenit con la derrota ante Prusia en 1870; como la III República, culminación de estas “ideas destructivas” destructivas, especialmente una “democracia inorgánica” que sacralizaba el régimen electivo, la centralización administrativa, el monopolio burocrático, y con ello, la desintegración de la sociedad y el debilitamiento de la nación. Este nuevo orden propugnado por Maurras se materializaba, a través de una “encuesta histórica”, en la doctrina del nacionalismo integral y el ideal de la Monarquía como régimen de gobierno ideal y funcional [18] . La defensa de la nación francesa exigía la instauración de la monarquía tradicional y representativa, portadora de los valores característicos del catolicismo y del clasicismo [19] . Éste era el contenido de su “politique d'abord”, donde la monarquía hacía coincidir el interés personal del gobernante y el interés público, la herencia del poder político y la duración de la nación. Frente a la democracia republicana “desorganizada, discontinua y dividida, “el interés nacional” exigía la inmediata supresión del parlamentarismo y de los partidos políticos. Frente a ellos, la nueva Monarquía “representativa” reuniría el principio político monocrático en el monarca (que reunía en su persona la totalidad del poder) y el principio democrático en un conjunto de cámaras de carácter corporativo [20] . El Estado recuperaría, así, sus funciones tradicionales, respetando la libertad económica y social en mano de los individuos y las corporaciones. Este régimen garantizaría tanto la descentralización territorial (reconstruyendo las regiones), como la profesional restaurando los gremios, moral y religiosa (recuperando la influencia de la iglesia católica en la sociedad civil) [21] . Así llegó el momento de L'Action française [22] , empresa intelectual a la que se sumaron el economista Georges Valois [1878-1945], el polemista Leon Daudet, el historiador Jacques Bainville, el crítico Jules Lemaître, y unas juventudes proselitistas llamadas “ Camelots du Roi” [23] . Pero pronto se mostraron las veleidades políticas del grupo. En las elecciones de 1919 apoyaron a la Unión Nacional y lograron situar a Daudet en el Parlamento. Acusados de antisemitas y radicales, Pio XI condenó la obra de Maurras, situando sus libros en el Index Librorum Prohibitorum el 29 de diciembre de 1926 . Ahora bien, estas condenas no frenaron adhesiones como las de Georges Bernanos o Robert Brasillach, pero tampoco defecciones como la del mismo Valois, fundador del Faisceau, o de Louis Dimierm, nuevo dirigente de La Cagoule. Estas polémicas surgieron, en gran medida, de la posición ambivalente con respecto al fascismo italiano. Maurras alabó en numerosas ocasiones al nacionalismo fascista llegándolo a definir como “un socialismo libre de la democracia y de la lucha de clase”; pero también condenó tanto el totalitarismo de Mussolini como el estatismo exacerbado del nacionalsocialismo. En esta polémica medió el antiguo sindicalista Valois [24] , que propugnaba un entendimiento con estos regímenes, y con la “escuela” Georges Sorel. Así nació el Círculo Proudhon (1911), movimiento cultural contrario a la democracia liberal y a favor de la descentralización regional. Pero las posiciones esencialmente revolucionarias de los sorealianos, irreductibles en el ideal de la lucha de clases, se mostraron finalmente inadmisibles para la tradición organicista y gremialista del nacionalismo integral de Maurras. Georges Valois, pseudónimo de A.G. Greseent, vinculó tradicionalismo y fascismo en su obra L'économie nouvelle (1919). En ella planteaba un régimen sindical corporativizado, presidido por un gran Consejo económico y social nacional, articulado sobre la representación orgánica de oficios y regiones, y desarrollado a través de Consejos locales capaces de suministrar los representantes generales y de reflejar la voluntad de las pequeñas células de la vida social y económica [25] . Valois no hablaba del Parlamento del Trabajo socialista, sino de un esquema jerárquico divido en escalones de producción y en necesidades económica; por ello señalaba que “este esquema reposa no sobre una ideología, sino sobre principios deducidos de la observación de los hechos contemporáneos, y tiene en cuenta las necesidades de la producción y de las creaciones espontáneas de la vida económica” [26] . Esta preocupación por temas socioeconómicos le situó en la llamada “ala izquierda” de Accción francesa, ala que leia y debatía a G. Sorel y a P. Proudhon (Le Monarchie et la classe ouvriere, 1914, o La Revolution nacionale, 1922), y fue atraído finalmente por la experiencia del fascismo italiano (Le Fascisme, 1927) [27]. Años después, y a la sombra de Maurras, más de medio centenar de intelectuales buscaron en el “nacionalismo integral” el sistema político-social capaz de derrocar a la III República francesa. Esta generación tuvo su oportunidad en 1941, tras la división del país con la ocupación alemana. En febrero de 1941 Ch. Maurras denominó como “divina sorpresa” la decisión del mariscal Philippe Pétain [1856-1951] de expulsar a Pierre Laval del Gobierno; por ello apoyó de manera plena la política del Gobierno de Vichy, en el que vio el símbolo de la unidad nacional, como continuación de la "Unión sagrada ” de 1914. El mismo mariscal llamó a Maurras y sus discípulos para dotar al nuevo Estado francés de un armazón doctrinal corporativo y antiparlamentrio, amén de contar con “La legión de Combatientes y Voluntarios” del coronel La Roque como movimiento político, y de la integración de los miembros del PSF (Partido Social francés) y del PPF de Jaques Doriot (Partido popular francés). Así, en el París ocupado por las fuerza germanas, un sector declaradamente fascista se unió a las tesis de Drieu La Rochelle [1893-1945] sobre un Estado totalitario de extensión continental; mientras, en Vichy la “revolución nacional” desarrollada por Maurras tomó los valores conservadores de “trabajo, familia y patria”, alcanzando gran influencia los neotradicionalistas de Raphaël Alibert , convertido en ministro de Justicia, buscando establecer un régimen corporativo y agrarista. Los maurrasistas defendieron la retórica monárquica, los principios católicos, y la imagen idílica de la antigua sociedad gremialista y rural, gracias en gran medida a la labor de Philippe Henriot y Xaviert Vallat desde la Secretaria de propaganda. Pese a su rotundo “antigermanismo”, al final de la II Guerra mundial Ch. Maurras fue condenado a cadena perpetua y su revista fulminantemente prohibida. El nuevo régimen presidencialista y estatista marcado por el general Ch. De Gaulle [1890-1970], dejó al corporativismo limitado a la burocratización del poderoso sindicalismo obrero y funcionarial, y a las propuestas “populistas” de Pierre Poujade [1920-2003]. Poujade fue el responsable de la fundación en 1954 de la Union de défense des commerçants et artisans (UDCA), movimiento en defensa de los intereses de las clases profesionales y grupos artesanales de las provincias francesas, frente al sistema fiscal estatal y el monopolio burocrático propio de la IV República [28] . El poujadismo se convirtió durante varias décadas en el portavoz de los “trabajadores independientes", de los "artesanos y comerciantes" de la Francia “de abajo” contra las “200 familias privilegiadas” [29] . ·- ·-· -······-· Sergio Fernández Riquelme Notas
[1] Véase Jerónimo Molina, La política social en la historia. Murcia, Ediciones Isabor, 2004, págs. 160-189. [2] La aparición de la Política social respondía a una combinación de factores económicos políticos y psicológicos propios del siglo XIX, resultantes de la industrialización, el progreso de la democracia en el seno de los Estados centralizados y la creciente conciencia sobre los derechos políticos y sociales. Así definía a la Política social como “el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar las condiciones de vida material y cultural de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado”. Esta definición cubría, para De Laubier, “un dominio que se sitúa entre lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del poder el Estado”. Patrick de Laubier, La Polítique sociale dans les societés industrielles. 1800 à nos tours . París, Economica, 1984, págs. 8-9. [3] Las concepciones reformistas o autoritarias del corporativismo alumbradas al otro lado de los Pirineos, ejercieron una enorme influencia en nuestro país, bien por la cercanía geográfica, bien por el ascendiente de superioridad intelectual que gran parte de los académicos hispanos les otorgó. Del corporativismo católico, la modernización funcional del pasado romántico de La Tour du Pin fue el referente básico del Estado corporativo de Aunós y del Estado nuevo de Pradera, mientras Albert de Mun marcó en buena medida a Severino Aznar. De Durkheim tomaron nota algunos intelectuales, más cercanos al naciente debate sobre la ciencia sociológica que a las siempre lejanas tesis sobre el positivismo y el funcionalismo: el krausoinstitucionista Azcárate criticaba el “sociologismo” de Durkheim por abordar la materia religiosa desde el positivismo sociológico. Véase Gumersindo de Azcárate, La religión y las religiones, Conferencia en la Sociedad El Sitio. Bilbao, 16 de mayo de 1909, págs. 259-260), Adolfo G. Posada fue lector suyo de la mano de Duguit y Le Bon, mientras Severino Aznar hacía referencia al prefacio de la segunda edición de la División apuntado que “toda escuela sociológica y positivista científica que tiene admiradores en todo el mundo culto ha llegado a las mismas conclusiones que desde hace medio siglo están difundiendo los reformadores sociales católicos. Durkheim, que no tiene ninguna religión positivista, y que es hoy el mayor prestigio sociológico de Francia, llegó a las mismas conclusiones que Hitze, sacerdote, uno de los más ilustres campeones del régimen corporativo de Alemania” Cfr. Severino Aznar Estudios económicos y sociales. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1946, pág. 214. Las primeras ediciones de las obras de Durkheim en España reflejan, por sus fechas, cierta tardanza en su publicación, y por sus traductores, cierta pluralidad de corrientes: el abogado Antonio Ferrer y Robert, el jurista Mariano Ruiz Funes, el sociólogo Carlos G. Posada, el politólogo Francisco Cañada y el líder sindical Ángel Pestaña. Posteriormente fue objeto de atención por la filosofía social de la Escuela de Madrid, y en especial por José Ortega y Gasset y su modelo burgués y meritocrático, profesional y laico de “orden moral” para la sociedad de su época. Mientras, del corporativismo sindical implantado por la CGT, tomaron nota socialistas como Fabra, De los Ríos y Besteiro; del “nacionalismo integral” de Charles Maurras y el “legitimismo” de Bainville quienes ayudarían decisivamente al punto de inflexión de la tradición corporativa española desde las páginas de Acción española o en el organicismo de la Lliga catalanista de F. Cambó y Ventosa.
[4] Al respecto véase Daniel Ligou, Histoire du socialisme en France, 1871-1971. París, Presses Universitaires de France, 1962, págs. 416-417. [5] F. Ponteil, Les classes bourgeoises et l´avenement de la democratie, 1815-1914. París, Albin Michel, 1968, págs. 438 sq. [6] Ídem , pág. 482. [7] G. Fernández de la Mora , Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica. Barcelona, Plaza y Janés, 1986. pág. 175. [8] Aunós lo llegaba a considerar como el verdadero “anti-Marx” en el prologará en la edición española René la Tour du Pin, Hacia un orden social cristiano. Madrid, Cultura español, 1936, pág. 34-35. [9] Ídem, pág. 484. [10] Su idea de “Monarquía neotradicional” afectó sobremanera a los alfonsinos de Renovación española, a los tradicionalistas de Pradera y a distintos intelectuales nacionalistas españoles (de Eugenio d´Ors a Ernesto Giménez Caballero). Con la lectura de Maurras, el neotradicionalismo hispano rescataba a Donoso y Balmes (entrelazados con Bonald y De Maistre), modernizaba la difusión de su doctrina y sus medios de movilización. Pese al agnosticismo declarado del doctrinario provenzal y la condena vaticana a través de la Encíclica Nous avons lu, varios elementos le hacían imprescindible: la restauración monárquica, el antidemocratismo corporativista, el nacionalismo tradicionalista, y la posibilidad de una “solución de fuerza”contrarrevolucionaria. [11] Recogido en Charles Maurras , “Trois idees politiques”, en Romantisme et Revoiution. París, Nouvelle Librairie Nationale, 1922, págs. 262 sq.
[12] Herni Massi , La vida intelectual en Francia en tiempo de Maurras . Madrid, Rialp, 1956, págs. 21 sq. [13] A quién prologó su obra Jacques Bainville , Lectures. París, Arthème Fayard, 1937. [14] Sobre los orígenes de este movimiento destacan las obras de Raoul Girardet , Le Nationalisme français, 1871-1914, Seuil, Paris, 1983 ; y François Huguenin, À l'école de l'Action française, Lattès, Paris, 1998
[15] Sobre su influencia en España véase P.C. González Cuevas , “Charles Maurras y España”, en Hispania, vol. 54, nº 188. Madrid, CSIC, 1994, págs. 993-1040; y “Charles Maurras en Cataluña”, Boletín de la real Academia de la Historia, tomo 195, Cuaderno 2. Madrid, 1998, págs. 309-362 [16] Charles Maurras , Romantisme et Revolution, Nouvelle Librairie Nationale, París, 1922, pág. 11.
[17] Ch. Maurras , “La politique religieuse”, en La democratie religieuse. París, Nouvelles Editons Latines, 1978, pág. 289.
[18] Pierre Hericourt, Charles Maurras , escritor político. Madrid, Ateneo, 1953, págs. 13 sq. [19] Dimensión de su pensamiento analizada por Alberto Caturelli, La política de Maurras y la filosofía cristiana. Madrid, Ed.Nuevo Orden, 1975. [20] Ch. Maurras, Encuesta sobre la Monarquía. Madrid , Sociedad General Española de Librería, 1935, págs. 65 y 705-706. [22] Movimiento estudiado por Eugene Weber , L'Action Frangaise. París, Fayard, 1985. [23] Junto al diario L'Action Française, otros órganos de difusión de las ideas maurrasianas fueron el Círculo Fustel de Coulanges o la Cátedra Syllabus. [24] Sobre su obra doctrinal podemos citar el estudio de Yves Guchet, Georges Valois .L’action Française - Le Faisceau - La république Syndicale. París, Albatros, 1975. [25] Georges Valois , L'économie nouvelle. París, Nouvelle Librairie Nationale, 1919, págs. 24 sq. [26] Publicado en España como G. Valois , “La representación de intereses”, en Acción española, nº 51, Madrid, 1934, págs. 80 y 81. [27] Eugene Weber , “Francia”, en H. Rogger y E. Weber, op.cit., págs. 63-108 . [28] Poujade protagonizó desde 1953 una revuelta contra el Estado francés, encabezando un notable grupo de pequeños comerciantes que protestaba contra la que consideraban como una elevada presión tributaria, tanto normativa como administrativa. Nacía el llamado “poujadismo”, que tras fundar el grupo político ”Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos (UDCA)”, entró en la misma Asamblea Nacional de 1956 con 52 escaños, entre ellos el de un joven J. M. Le Pen. Aunque la llegada del general De Gaulle, a la presidencia de la República en 1958, comenzó a frenar la expansión de este experimento político, que años más tarde el Frente Nacional quiso capitalizar como antecedente. [29] Un testimonio directo lo encontramos en Pierre Poujade, J'ai choisi le combat Saint-Céré, Société générale des éditions et des publications, 1955. |
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, corporatisme, théorie politique, histoire, france, traditions, traditionalisme, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 novembre 2009
R. Steuckers: Propositions pour un renouveau politique (1997)

Propositions pour un renouveau politique
Intervention de Robert Steuckers au Colloque
de “Synergon-Deutschland”, Sababurg, 22-23 novembre 1997
L'effondrement du communisme depuis la perestroïka lancée par Gorbatchev en 1985, l'insatisfaction générale et planétaire que provoque la domination sans partage du libéralisme sur le globe tout entier, donne raison à tous ceux qui ont cherché d'autres solutions, des tierces voies ou une forme organique d'humanisme. La majorité de nos concitoyens, dans tous les pays d'Europe, sont désorientés aujourd'hui. Nous allons tenter de leur donner des repères.
Dans son ouvrage Zurück zur Politik. Die archemedische Wende gegen den Zerfall der Demokratie (1), Hermann Scheer constate (et nous partageons son constat):
- Il existe un fondamentalisme occidental, mixte de rationalisme outrancier, de moralisme universaliste, de relativisme délétère, d'économicisme plat et d'hostilité générale et pathologique à l'égard des legs de l'histoire;
- Ce fondamentalisme occidental ne se remet pas en question, ne s'ouvre à aucune nouveauté, ne révise pas ses certitudes, ne tient nullement compte de facteurs culturels non occidentaux, ce qui nous permet de le désigner comme un fondamentalisme équivalent aux autres, exhibant une dose équivalente ou supérieure de fanatisme;
- Ce fondamentalisme occidental est marqué d'hybris, de folie des grandeurs;
- Ce fondamentalisme occidental est subjectiviste, écrit Scheer; nous dirions qu'il est “individualiste” ou “hyper-individualiste”. Il réduit l'homme à sa pure individualité; le fondamentalisme occidental est dès lors un fondamentalisme qui exclut de son champ de prospection toutes les formes d'interrelations humaines. Le “sujet”, c'est-à-dire l'“individu”, n'a plus de devoirs à l'égard de la communauté au sein de laquelle il vit, car la notion même de “devoir” implique des relations réciproques, basées sur une éthique (Sittlichkeit) communément partagée.
Sans notion de “devoir”, le subjectivisme conduit au déclin moral, comme le constatent également les communautariens américains (2). De surcroît, les sociétés marquées par l'hyper-subjectivisme occidental, par le fondamentalisme individualiste, souffrent également d'une “monomanie économique”. Effectivement, le fondamentalisme occidental est obsédé par l'économie. Le double effet du subjectivisme et de la “monomanie économique” conduit à la mort de l'Etat et à la dissolution du politique. Telles sont les conclusions que tire Scheer. Elles sont étonnantes pour un homme qui s'inscrit dans le sillage des écologistes allemands et qui a le label de “gauche”. Cependant, il faut préciser que Scheer est un écologiste pragmatique, bien formé sur le plan scientifique; depuis 1988, il est le président de l'“European Solar Energy Association” (en abrégé: “Euro-Solar”).
Il a exprimé ses thèses dans deux ouvrages, avant de les reprendre dans Zurück zur Politik... (op. cit.):
- Parteien contra Bürger (1979; = “Les partis contre les citoyens”);
- Sonnen-Strategie (1993; = “Stratégie solaire”; cet ouvrage traite d'énergie solaire, clef pour acquérir une indépendance énergétique; à ce propos cf. Hans Rustemeyer, «Energie solaire et souveraineté», NdSE n°29, pp. 23-24).
 Les autres constatations de Scheer sont également fort pertinentes et rejoignent nos préoccupations:
Les autres constatations de Scheer sont également fort pertinentes et rejoignent nos préoccupations:
1. Dans la plupart des pays occidentaux, toute idéologie dominante ou acceptée, qu'elle soit au pouvoir ou provisoirement dans l'opposition, est influencée ou marquée par ce fondamentalisme occidental, par ce subjectivisme qui refuse de prendre acte des notions de “devoir” ou d'éthique communautaire, par cette monomanie économique qui dévalorise, marginalise et méprise toutes les autres activités humaines (les secteurs “non-marchands”, refoulés dans les sociétés occidentales).
2. La pratique des partis dominants ne sort pas de cette impasse. Au contraire, elle bétonne et pérennise les effets pervers de cette idéologie fondamentaliste.
3. Les intérêts vitaux des citoyens exigent pourtant que l'on dépasse et abandonne ces platitudes idéologiques. Dès 1979, Scheer constatait:
- que l'aversion des citoyens de base à l'encontre des partis ne cessait de reprendre vigueur;
- que les citoyens n'étaient plus liés à un seul parti dominant mais tentaient de se lier à diverses instances, soit à des instances de factures idéologiques différentes; le citoyen se dégage ainsi de l'étroitesse des enfermements partisans et cherche à diversifier ses engagements sociaux; le citoyen n'abandonne pas nécessairement les valeurs de sa famille politique d'origine, mais reconnait implicitement que les familles politiques d'“en face” cultivent, elles aussi, des valeurs valables et intéressantes, dans la mesure où elles peuvent contribuer à résoudre une partie de ses problèmes. Le citoyen, en bout de course, développe une vision de la politique plus large que le député élu ou le militant aliéné dans la secte que devient son parti.
- que les mutations de valeur à l'œuvre dans nos sociétés postmodernes impliquent un relâchement des liens entre les citoyens et leurs familles politiques habituelles;
- que les partis n'étaient plus à même de réceptionner correctement, de travailler habilement et de neutraliser efficacement les mécontentements qui se manifestaient ou pointaient à l'horizon (un chiffre: en France, aujourd'hui, plus de 25% des jeunes de moins de 25 ans sont sans travail et aucune solution à ce drame n'est en vue, dans aucun parti politique);
- qu'il est nécessaire que de “nouveaux mouvements sociaux” émergent, comme, par exemple: le mouvement populaire anti-mafia en Sicile, les mouvements populaires hostiles à la corruption politique dans toute l'Italie (dont la “Lega Nord”), les mouvements liés à la “marche blanche” en Belgique (qui n'ont mené à rien à cause de la naïveté de la population).
Scheer écrit (p. 97): «Les partis font montre d'une attitude crispée. Ils ne savent pas s'ils doivent considérer les idées nouvelles comme des menaces ou comme un enrichissement, s'ils doivent les bloquer, les intégrer ou coopérer avec elles». D'où l'indécision permanente qui conduit à la dissolution du politique et à l'évidement de l'Etat. Scheer constate, exactement comme le constatait Roberto Michels au début du siècle: «Il existe une loi d'airain de l'oligarchisation». Cette loi d'airain transforme l'Etat en instrument de castes fermées, jalouses de leurs intérêts privés et peu soucieuses du Bien commun. Quand ce processus atteint un certain degré, l'Etat cesse d'être le porteur du politique, le garant des libertés citoyennes et de la justice.
Plus loin, Scheer écrit (p. 111): «La démocratie partitocratique se trouve en plein processus d'érosion, car, comme jamais auparavant, elle connait une situation qu'Antonio Gramsci (...) aurait considéré comme la “plus aiguë et la plus dangereuse des crises”: “A un moment précis de l'évolution historique, les classes se détachent de leurs partis politiques traditionnels”. Il se constitue alors “une situation de divorce entre les représentés et les représentants”, qui doit immanquablement se refléter dans les structures de l'Etat». C'est précisément ce qui ne se passe pas: la masse croissante des exclus et des précarisés (même si leur statut est élevé, comme dans la médecine et dans l'enseignement) ne se reconnaissent plus dans leurs représentants et se défient des programmes politiques qu'ils avaient eu l'habitude de suivre.

Dans tous les pays, une situation analogue s'observe:
- en Allemagne, la contestation s'exprime dans les partis d'inspiration nationaliste, chez les Verts, dans les initiatives de citoyens (toutes tendances et inspirations confondues), chez les partisans du référendum (comme en Bavière);
- en Belgique, elle s'exprime dans les partis (VB, VU) inspirés par le nationalisme flamand (qui a toujours rassemblé en son sein les contestataires les plus radicaux de la machine étatique belge), en marge des partis libéraux qui prétendent défendre et refléter la révolte des indépendants et des classes moyennes spoliés (dans les années 60: le PLP/PVV; dans les années 90, le VLD de Guy Verhofstadt); ce dernier a prétendu canaliser “la révolte des citoyens contre la pillarisation de la société par les partis”; en Wallonie, cette révolte s'est d'abord exprimée chez les “écolos”, mouvement en lisière duquel des intellectuels comme Lambert et le Prof. Van Parijs ont développé une critique radicale et fondamentale du néo-libéralisme. Les travaux de Van Parijs ont acquis une notoriété internationale. Ensuite, la contestation, à partir de 1989, s'est exprimée dans le FN, scindé en deux clans depuis l'automne 1991; avec les scandales successifs (assassinat de Cools, disparition d'enfants, affaire Dutroux, scandales Agusta et Dassault), le mécontentement a débouché sur les manifestations d'octobre 1996, dont le point culminant fut la fameuse “marche blanche”, rassemblant 350.000 citoyens.
- en France, la contestation et le ras-le-bol s'expriment dans le vote FN; et, dans une moindre mesure, chez les Verts. La mouvance écologique n'est malheureusement plus dominée par une figure équilibrée comme Antoine Waechter, mais par l'aile pro-socialiste de Mme Voynet, qui s'est empressée de glâner quelques portefeuilles dans le gouvernement Jospin, condamné à l'échec face à l'ampleur de la crise en France.
- en Italie, où les formes de contestation de la partitocratie sont de loin les plus intéressantes en Europe, et les mieux étayées sur le plan théorique, la Lega Nord a cristallisé le mécontentement (nous y reviendrons lors d'un prochain séminaire).
Conclusion:
- Un mouvement comme le nôtre doit être attentif en permanence, afin de capter, de comprendre et de travailler les effervescences à l'œuvre dans la société. De percevoir et d'éliminer anticipativement les dysfonctionnements dès qu'ils se développent.
- Le fondamentalisme occidental repose sur une conception erronée de l'homme qui est:
a. non organique et donc non adaptée à l'être vivant qu'est l'homme;
b. hyper-individualiste (dans le sens où personne n'a plus de devoir à l'égard de l'autre, y compris à l'égard des membres de sa propre famille); le fondamentalisme occidental ruine la notion de “lignée”, donc de continuité anthropologique. Sur le plan pratique et quotidien, cela implique notamment la disparition de toute solidarité inter-générationnelle, tant à l'égard des ascendants que des descendants.
- Le fondamentalisme occidental débouche sur une pratique de la politique:
a. où les permanents des partis (les “bonzes”) sont irrémédiablement isolés de la vie réelle et inventent mesures, lois et règlements en vase clos, non pas dans la perspective de renforcer le Bien commun mais de conserver à leur profit personnel sinécures, avantages et passe-droits;
b. où le pur et simple fonctionnement des appareils des partis devient but en soi;
c. où ces appareils devenus buts en soi mènent tout droit au “malgoverno” qu'ont dénoncé les adhérents de la Ligue lombarde et le Professeur Gianfranco Miglio (cf. Vouloir n°109/113, 1993);
d. où les permanents des partis et les fonctionnaires d'Etat nommés par les partis se hissent sans vergogne au-dessus de la misère quotidienne des simples gens du peuple et, souvent aussi, au-dessus des lois (c'est le cas en Italie et en Belgique, où partis et magistrature sont manifestement liés à la pègre).
La notion de “malgoverno” désigne l'ensemble de toutes les conséquences négatives de la partitocratie. Les observateurs et les politologues italiens ont tiré des conclusions pertinentes de ce dysfonctionnement général. Mais, en France, des professeurs isolés, ignorés des médias aux ordres de la politique pégrifiée, ont également émis des constats intéressants; parmi eux, Jean-Baptiste de Foucauld et Denis Piveteau, dans Une société en quête de sens (3). Si Scheer était très dur et très critique, de Foucauld et Piveteau sont plus modérés. Ils sont en faveur de l'Etat social, de l'Etat-Providence. Celui-ci, à leurs yeux, est efficace, il peut mobiliser davantage de moyens que la solidarité spontanée et communautaire dont rêvent les réactionnaires et les idéalistes “fleur bleue”. Hélas, constatent de Foucauld et Piveteau, l'Etat-Providence ne suffit plus:
- Il ne peut plus intégrer tous les travailleurs de la communauté nationale;
- Il ne fonctionne plus que pour ceux qui disposent déjà d'un emploi, notamment les fonctionnaires et les salariés des grandes boîtes multinationales. En pratique, l'Etat-Providence n'est plus capable de résoudre le problème dramatique du chômage des jeunes;
- Les événements récents viennent de prouver que l'Etat-Providence peut affronter efficacement une situation donnée, à la condition que cette situation soit celle d'une “haute conjoncture”. En revanche, quand cette haute conjoncture se modifie sous la pression des événements internationaux ou d'innovations —bonnes ou mauvaises— l'Etat-Providence s'avère incapable de résoudre des problèmes nouveaux, soudains ou inattendus.
L'Etat-Providence est alors incapable de garantir la solidarité, parce qu'il ne remet pas en question des mécanismes de solidarité anciens mais devenus progressivement surannés. Les données et les faits nouveaux sont perçus comme des menaces, ce qui, dans tous les cas de figure, est une attitude erronée. A ce niveau, notre réflexion, dans ses dimensions “conservatrices-révolutionnaires”, c'est-à-dire des dimensions qui tiennent toujours compte des situations exceptionnelles, peuvent se montrer pertinentes: les processus à l'œuvre dans le monde sont multiples et complexes; ils ne nous autorisent pas à penser qu'il y aura ad vitam eternam répétition des “bonnes conjonctures”.
L'Etat-Providence repose sur une logique de l'intégration. Tout citoyen, tout travailleur immigré qui a été dûment accepté, devrait, dans un tel Etat-Providence, dans l'appareil social qu'il met en œuvre et organise, être pleinement intégré. Ce serait évidemment possible si les paramètres restaient toujours les mêmes ou si le progrès, immuablement, avançait selon une précision arithmétique ou exponentielle. Mais ce n'est jamais le cas... L'exception guette à tout moment, le pire survient à tout bout de champ. Ceux qui pensent et agissent en termes de paramètres immuables sont des utopistes et sont condamnés à l'échec politique. Ceux qui envisagent le pire font preuve de responsabilité.
Dans les médias, aujourd'hui, on ne cesse de parler d'intégration, mais la seule chose que l'on observe, c'est l'exclusion à grande échelle. Jadis, l'exclusion ne touchait que des gens sans revenus ou sans allocations de retraite. Aujourd'hui, de 10 à 20% de la population totale est exclue (derniers chiffres: 16% des personnes habitant la Région de Bruxelles-Capitale). Les exclus se recroquevillent dans leur cocon, se replient sur eux-mêmes, ce qui engendre un dangereux nihilisme, le sentiment de “no future”. Les liens communautaires disparaissent. Un isolement total menace l'exclu. Les intégrés sont immergés dans une cage de luxe, de réalité-ersatz, qui les tient éloignés du fonctionnement réel de la Cité.
J. B. de Foucauld et D. Piveteau analysent la situation et ne donnent pas de solutions toutes faites (personne ne croit plus d'ailleurs aux solutions toutes faites). Pour eux, la société est déterminée par une dynamique conflictuelle entre quatre pôles:
1. Le pôle de l'initiative: ceux qui prennent des initiatives n'acceptent que peu d'obstacles d'ordre conventionnel, notamment les obstacles installés par les administrations reposant sur une ergonomie obsolète ou sur des analyses vieilles de plusieurs décennies (exemple: il a fallu trente mois d'attente à une firme de pointe en Wallonie pour obtenir de la part des fonctionnaires —souvent socialistes, corrompus, incompétents et dépassés— le droit de lancer son initiative génératrice de 2500 emplois, alors que la région compte des zones où le chômage atteint 39% de la population active!). Le principe d'initiative peut aussi être pensé sur un mode exclusivement individualiste et relativiser ou transgresser le principe de “coopération”.
2. Le pôle de coopération.
3. Le conflit (inhérent à toute société), vecteur de changements.
4. La contrainte, qui peut avoir la fonction d'un régulateur.
Piveteau et de Foucauld dressent une typologie des sociétés bipolarisées (où seuls deux pôles entrent en jeu) et une typologie des sociétés tripolaires (où trois pôles sont en jeu). Pour ces deux auteurs, il s'agit de montrer que l'exclusion d'un ou de deux pôles conduit à de problématiques déséquilibres sociaux. Les valeurs qui se profilent derrière chaque pôle sont toutes nécessaires au bon fonctionnement de la Cité. Il est dangereux d'évacuer des éventails de valeurs et de ne pas avoir une vision holiste (ganzheitlich) et synergique des sociétés qu'on est appelé à gouverner.
Les sociétés bipolaires:
- Dans une société régie par le libéralisme pur, de facture hayekienne, où règne, dit-on, une “loi de la jungle” (bien qu'il me paraisse difficile de réduire l'œuvre complexe de Hayek à ce seul laisser-faire exagéré), les pôles de l'initiative et du conflit sont mis en exergue au détriment de la coopération (individualisme oblige) et de la contrainte (principe de liberté).
- Dans une société autoritaire, d'inspiration conservatrice (Salazar) ou communiste (la Pologne de Jaruzelski), les pôles de coopération et de contrainte sont privilégiés au détriment des pôles d'initiative et de conflit.
- Dans les sociétés où domine l'esprit civique, comme dans les nouvelles sociétés industrielles asiatiques, les pôles d'initiative et de coopération sont valorisés, tandis que les pôles de conflit et de contrainte sont mis entre parenthèses.
- Dans les sociétés purement conflictuelles et instables, les pôles du conflit et de la contrainte sont à l'avant-plan, ceux de l'initiative et de la coopération à l'arrière-plan ou carrément inexistants. Plus personne ne lance d'initiative, car c'est sans espoir, et personne ne coopère avec personne, car il n'y a ni confiance ni consensus. Aucune initiative et aucune coopération ne sont possibles. Exemples: les zones industrielles du début du XIXième siècle, décrites par Zola dans Germinal, ont généré des sociétés conflictuelles et contraignantes de ce type. Aujourd'hui, on les rencontre dans les bidonvilles brésiliens; les banlieues marginalisées des grandes villes françaises risquent à très court terme de se brasilianiser.
- Dans certaines sociétés sans esprit civique, l'initiative n'est possible qu'avec la contrainte. Piveteau et de Foucauld craignent que la France, leur pays, n'évolue vers ce modèle, car le dialogue social à la belge ou à l'allemande n'existe pas et que le syndicalisme y est resté embryonnaire.
- Au sein même des grandes sociétés industrielles, les grandes familles intactes, certaines organisations professionnelles, les minorités ethniques (y compris dans les banlieues à problèmes), développent un modèle principalement coopératif, dans un environnement fortement conflictuel, mais où l'initiative innovante est trop souvent absente et où la contrainte étatique est radicalement contestée. Avec, au pire, l'émergence de structures mafieuses.
Les sociétés tripolaires:
- Si seuls les pôles de la coopération, de l'initiative et de la contrainte entrent en jeu, le risque est d'évacuer tous les conflits, donc toutes les innovations, née de l'agonalité entre classes ou entre secteurs professionnels concurrents.
- Si le pôle de contrainte est évacué, le risque est d'assister à la contestation systématique et stérile de toute autorité féconde et/ou régulative.
- Si le pôle de coopération est exclu, la solidarité cesse d'exister.
- Si le pôle d'initiative est absent, l'immobilisme guette la société.
L'idéal pour de Foucauld et Piveteau est un chassé-croisé permanent et sans obstacle entre les quatre pôles. L'exclusion d'un seul ou de deux de ces pôles provoque des déséquilibres et des dysfonctionnements. Pour nos deux auteurs, les difficultés sont les suivantes:
1. Les partis politiques en compétition dans une société ne mettent que trop souvent l'accent sur un seul pôle ou sur deux pôles seulement. Ils n'ont pas une vision globale et synergique de la réalité sociale.
2. Les partis prennent l'habitude, parce que leur objectif majeur se réduit à leur propre auto-conservation, à ne défendre que certaines valeurs en excluant toutes les autres. Cette exclusion reste un vœu pieux, car les valeurs peuvent certes s'effacer, quitter l'avant-scène, mais ne disparaissent jamais: elles demeurent un impératif éthique. La vision politique des grands partis dominants est dès lors mutilée et mutilante. Elle conduit à la répétition de schémas et de routines politiques, en marge de l'évolution réelle du monde.
3. Un mouvement civil ou populaire comme le nôtre doit se donner la tâche (ardue) de réconcilier les quatre pôles, de les penser toujours simultanément, afin de favoriser un maximum de synergies entre eux.
4. De cette manière seulement, émergent une perception et une pratique holistes de la dynamique sociale.
5. Les schémas que nous proposent de Foucauld et Piveteau expliquent pourquoi diverses catégories de citoyens finissent par se lasser de la politique et des partis. Lorsqu'un pôle n'est pas pris en compte, de larges strates de la population sont frustrées, vexées, meurtries, marginalisées voire exclues. Ou ne peuvent plus exprimer leurs desiderata légitimes.
6. En plaidant pour une prise en compte de ces quatre pôles, Piveteau et de Foucauld visent à (re)donner du sens à la vie politique, car, s'il y a absence de sens, il y a automatiquement dissolution du politique, liquéfaction des institutions, effondrement de la justice et éparpillement des énergies.
La critique de Nicolas Tenzer
Un autre observateur français de la situation actuelle est le Prof. Nicolas Tenzer, énarque, enseignant auprès de l'Institut d'Etudes politiques de Paris. Dans Le Tombeau de Machiavel (4), Nicolas Tenzer part du constat que les “grands récits”, c'est-à-dire selon le philosophe Jean-François Lyotard, les visions vectorielles de l'histoire véhiculées par les progressistes, ne sont plus dans le grand public des objets de croyance et de vénération. L'électeur n'attend plus des partis et des hommes politiques qu'ils se mobilisent pour réaliser des projets téléologiques aussi “sublimes”. Mais ce désintérêt pour les grands mythes téléologiques recèle un risque: les sociétés ne formulent plus de perspectives d'avenir et les élites deviennent des “élites sans projet”. La pire conséquence de l'“effondrement des grands récits”, c'est que les partis et les hommes politiques se mettent à justifier sans discernement tous les faits de monde et de société présents, même ceux qui ne recèlent plus aucune potentialité constructive, ou ceux qui représentent un flagrant déni de justice.
Tenzer ne cite jamais Carl Schmitt, mais le jugement négatif qu'il pose sur cette médiocre justification des faits, indépendamment de ce qu'ils sont sur le plan des valeurs ou de l'efficacité, nous rappelle directement la critique négative que Carl Schmitt et Max Weber adressaient à la légalité, cage d'acier rigide emprisonnant la légitimité, qui, elle, est toujours souple et dynamique.
Pour Tenzer, la “deuxième gauche” (c'est-à-dire la gauche qui se considère comme modérée et socialiste et prétend ne pas vouloir gouverner avec les communistes) est une école politique qui légitimise, justifie et accepte les faits simplement parce qu'ils existent, sans plus déployer aucune prospective ni perspective, n'envisage plus aucun progrès et n'a plus la volonté de réaliser des plans, visant le Bien commun ou sa restauration. A ce niveau de la démonstration de Tenzer, nous sommes contraints d'apporter une précision sémantique. Tenzer condamne l'attitude de la “deuxième gauche” pour son acceptation pure et simple de tous les faits de monde et de société, sans esprit critique, sans volonté réelle de réforme ou d'élimination des résidus figés ou dysfonctionnants. Cette “deuxième gauche” prendrait ainsi, dit Tenzer, une attitude “naturaliste”. Pour la pensée conservatrice (du moins les “conservateurs axiologiques”) et les écologistes, il y a primat du naturel sur toutes les constructions. En règle générale, les gauches libérales et marxistes, accordent le primat aux choses construites. Mais en développant sa critique de la “deuxième gauche”, en la dénonçant comme “naturaliste”, Tenzer met les conservateurs (axiologiques) et les écologistes en garde contre une tendance politique actuelle, celle d'accepter tous les faits accomplis trop vite, de considérer toutes les dérives comme inéluctables, comme le résultat d'une “catallexie”, c'est-à-dire, selon Hayek, d'une évolution naturelle contre laquelle les hommes ne peuvent rien. Dans ce cas, la volonté capitule. Tenzer dénonce là la timidité à formuler des projets et la propension à faire une confiance aveugle à la “main invisible”, chère aux libéraux. Dans le fond, Tenzer ne critique pas le réalisme vitaliste de la pensée conservatrice et/ou écologiste, mais s'oppose à la notion néo-libérale de “catallexie”, réintroduite à l'époque de Thatcher, à la suite de la réhabilitation de la pensée de Hayek.
Dans la vie politique concrète, dans la situation actuelle, un “naturalisme” mal compris conduirait à accepter et à légitimer l'exclusion de millions de citoyens au nom du progrès, de la démocratie, de l'Etat de droit, de la morale, etc. Légitimer des faits aussi négatifs est évidemment absurde.
Tenzer nous avertit aussi du mauvais usage de la notion de “complexité”. Pour nous, dans notre perspective organique, la complexité constitue un défi, nous oblige à éviter toutes les formes de réductionnisme. En ce sens, nous avons retenu les leçons d'Arthur Koestler (Le cheval dans la locomotive), de Konrad Lorenz et, bien entendu, du biohumanisme qu'avait formulé Lothar Penz (5). Malheureusement, aux yeux d'un grand nombre de terribles simplificateurs, la complexité est devenu un terme à la mode pour esquiver les défis, pour capituler devant toutes les difficultés. Quand un problème se pose, on le déclare “complexe” pour ne pas avoir à l'affronter. Le réel est donc posé a priori comme trop “complexe” pour que l'homme ait la volonté de mener une action politique quelconque, d'élaborer des plans et de développer des projets. On accepte tout, tel quel, même si c'est erroné, injuste ou aberrant.
Tenzer ne rejette pas seulement le “naturalisme” (auquel il donne une définition différente de la nôtre) mais aussi
a) l'enthousiasme artificiel pour la complexité que répandent les journalistes qui se piquent de postmodernité et proposent insidieusement une idéologie de la capitulation citoyenne;
b) l'hypermoralisation; en effet, aujourd'hui, dans les médias, nous assistons à une inflation démesurée de discours moralisants et, en tant que tels, anesthésiants. La philosophie ne cherche plus à comprendre le réel tel qu'il est, mais produit des flots de textes moralisants et prescriptifs d'une confondante banalité, pour aveugler, dit Tenzer, le citoyen, le distraire du fonctionnement réel de sa communauté politique (Tenzer adresse cette critique à André Comte-Sponville notamment). Dans les médias, c'est sur base de telles banalités que l'on manipule les masses, pour les empêcher de passer à l'action. L'objectif principal de cet hyper-moralisme, c'est de “freiner toute action citoyenne”. Ceux qui veulent freiner cette action citoyenne entendent maintenir à tout prix le statu quo (dont ils sont souvent les bénéficiaires), se posent comme “légalistes” plutôt que comme “légitimistes”. Mais l'option légaliste (ou “légalitaire”) est foncièrement anti-politique, car elle refuse de considérer le politique comme une force qui chevauche et maîtrise la dynamique historique et sociale. Le légaliste-légalitaire est aussi celui qui conçoit le droit comme une idée abstraite, détachée de tout continuum historique. Dans le domaine du politique, ce qui est le produit direct d'un continuum historique est légitime. Une légalité rigide, en revanche, conduit à une rupture (souvent traumatisante) à l'endroit d'une continuité puis à la dissolution du politique et de l'Etat, car la dynamique qui émane du peuple, porteur du politique et acteur de l'histoire, est freinée et étouffée.
Dans le processus de dissolution de l'Etat, dans ses phases successives d'affaiblissement, celui-ci cesse d'être aimé, constate Tenzer, car, en effet, sa dissolution est toujours simultanément une dé-légitimisation, et, partant, une réduction à de la pure légalité.
Des élites sans projet
Revenons au débat allemand. Il y a quelques années, j'ai été étonné de découvrir que trois figures de proue de la politique allemande avaient écrit de concert un ouvrage très critique à l'encontre des partis. Ce livre s'intitulait Die planlosen Eliten (= “Les élites sans projet”) (6). Ses auteurs étaient Rita Süssmuth (aile gauche de la CDU démocrate-chrétienne), Peter Glotz (intellectuel en vue de la SPD socialiste) et Konrad Seitz (ministre de la FDP libérale). Dans ce livre, ils expriment:
- leur nostalgie d'une élite et d'une caste dirigeante cohérentes;
- leur souhait de voir cette élite résoudre les problèmes politiques, économiques et écologiques;
- leur inquiétude de voir la classe politique allemande décliner et tomber très bas dans l'estime des masses; ce déclin s'explique parce qu'il y a eu des scandales dans le financement des partis; parce que les promesses électorales n'ont jamais été tenues (p. ex.: réunification sans augmentation des impôts).
Nos trois auteurs écrivent (p. 181): «La fabrication en série de mythes et de grands sentiments conduit au cynisme et à l'apathie dans la population». Ensuite, ils déplorent que le procédé de recrutement de la classe politique reste le “travail à la base”; or celui-ci effraie les individualités créatives, imaginatives et intelligentes et les détourne de la politique. Süssmuth, Glotz et Seitz constatent à ce propos (p. 182): «C'est sans doute un paradoxe, mais on est bien obligé de constater qu'il est réel: la démocratisation des partis a conduit simultanément à leur fermeture. A l'époque de Weimar ou dans les premiers temps de la Bundesrepublik, les appareils dirigeants des partis pouvaient imposer des candidats à la “base”; de cette façon, des personnalités originales, des experts, des intellectuels, des conseillers de grandes entreprises et des représentants d'autres groupes s'infiltraient dans le monde politique. Mais aujourd'hui, celui qui refuse de se soumettre au contrôle des faciès opéré par les pairs des partis, n'a plus aucune chance». Ce constat affolant est suivi de plaidoyers:
- pour un changement dans la psychologie des hommes et des femmes politiques, où nos trois auteurs réclament plus de modestie (p. 192);
- pour une plus forte participation de la population aux décisions politiques directes (via des techniques de consultation comme le plébiscite et le referendum);
- pour une ouverture des partis politiques à la vie réelle des citoyens.
Enfin, Süssmuth, Glotz et Seitz émettent ce jugement terrible pour le personnel politique en place: «Quand on est âpre de prébendes, vulgaire et envieux, on ne doit pas s'attendre à susciter le respect des autres».
Les pistes que nous suggérons
La classe politique a failli partout en Europe. Elle n'est pas capable d'affronter les nouvelles donnes, parce que son personnel n'a ni l'intelligence ni la culture nécessaires pour orienter et réorienter les instances politiques sous la pression des faits. Telle est la situation. Mais quelles sont les réponses, ou les pistes, qu'un mouvement comme le nôtre peut apporter?
1. La première piste dérive d'une prise en compte des leçons du “communautarisme” américain.
- Le communautarisme américain constate que le modèle occidental est une impasse.
- Dans cette impasse, les citoyens ont perdu tous liens avec les valeurs qui fondent les sociétés et les maintiennent en état de fonctionner dans la cohérence. C'est ainsi qu'a disparu le sens civique. Et sans sens civique, il n'y a pas de démocratie viable. Sans sens civique, sans valeurs fondatrices, sans rejet explicite d'un relativisme omniprésent, il n'y a pas de justice.
- Nous devons coupler la réhabilitation de la notion de “communauté” que nous trouvons dans le communautarisme américain actuel à la notion schmittienne d'“ordre concret” (konkrete Ordnung). Pour Carl Schmitt, un ordre concret est un ordre produit par un continuum historique, par exemple un Etat né de l'histoire. A l'intérieur de tels Etats, nous trouvons, généralement, une façon précise et originale de dire le droit et d'appliquer une jurisprudence. Dès lors, les règles ne sont des règles réelles et légitimes que si elles sont imbriquées dans un ordre né d'une continuité historique précise.
En insistant sur la concrétude des ordres en place dans les sociétés traditionnelles et/ou légitimes, Carl Schmitt conteste le pur normativisme des Etats libéraux. Le normativisme libéral repose sur la norme, qui serait une idée générale propre à l'humanité toute entière, hissée au-dessus de toutes les contingences spatio-temporelles. La normativisation du droit conduit à un gouvernement du droit et non plus à un gouvernement d'hommes au service d'autres hommes. L'Etat de droit (où le droit est conçu comme le produit d'une histoire particulière) dégénère en Etat légal(iste), ce qui nous amène à l'actuelle “political correctness”. Par ailleurs, le pur décisionnisme, qu'avait défendu Carl Schmitt à ses débuts, en même temps que les fascistes, ne permet pas à l'homme d'Etat de saisir la dynamique historique, le noyau fondamental de la Cité qu'il est appelé à régir. Raison pour laquelle, l'homme d'Etat doit simultanément se préoccuper des institutions, de la continuité institutionnelle (selon la définition que donne Hauriou de l'institution, soit un “ordre concret”), et des décisions, à prendre aux moments cruciaux, pour trancher des “nœuds gordiens” et sortir la Cité d'une impasse mortelle. Au sein des ordres concrets, qui ont produit un système juridique au fil de l'histoire, les communautés humaines concrètes fondent du sens. Ces communautés charnelles d'hommes et de femmes de diverses lignées et générations acquièrent ainsi priorité sur les normes abstraites. Les communautariens américains s'efforcent de contribuer, comme nous, au rétablissement de l'Etat de droit, contre toutes les tentatives entreprises pour le remplacer par l'Etat normatif, “politiquement correct”, excluant en même temps que toutes les valeurs léguées par l'histoire, tous les possibles qui pourraient contredire ou atténuer la rigueur abstraite de la norme.
Ernst Rudolf Huber et le «Kulturstaat»
2. Ce débat de fond suscite d'autres questions. Par exemple: quelles facettes doit présenter un Etat porté par les ordres concrets qui vivent et se déploient en son sein? De notre point de vue, un tel Etat serait celui qu'Ernst Rudolf Huber a défini comme Kulturstaat (“Etat-culture”) (7). Pour Huber, “le Kulturstaat est le gardien de la culture populaire face à la destruction dont la menace la société” (i. e.: les intérêts privés, désolidarisés du Bien commun, ndlr). La “culture” dans ce sens est à la fois constitutive de la Staatlichkeit (de la substance de l'Etat) et la légitimise. L'action de l'Etat est soumise aux valeurs substantielles que véhicule cette culture. En conséquence, l'Etat n'est pas un pur instrument, car la culture n'est pas une fabrication faite à l'aide d'instruments, mais un héritage et une matrice de valeurs qui, en dernière instance, ne sont ni rationalisables ni normalisables. En ce sens, cette matrice est elle-même une valeur qu'il convient de préserver contre les intérêts matériels et factieux, contre les agents de déliquescence, intérieurs ou extérieurs. En théorisant la notion de Kulturstaat, Huber entend étoffer la notion hégélienne de Sittlichkeit (éthique, mœurs) en l'imbriquant dans une culture et la solidarisant d'office avec toutes les autres manifestations de cette culture. L'éthique cesse automatiquement d'être un jeu propret de concepts purs, détachés de la vie réelle et trépidante des peuples.
Tout Kulturstaat est nécessairement organisé selon un modèle fédéral, il est un Bundesstaat (qui respecte le principe de subsidiarité), car toute communauté au sein de cet Etat est un ordre concret, qui doit être respecté en tant que tel, auquel il faut assurer un avenir. Pour le juriste français Stéphane Pierré-Caps, dans son ouvrage intitulé La multination (8), le futur Etat mitteleuropéen ne pourra pas se bâtir sur le modèle unitaire, centraliste et jacobin de l'Etat-Nation, où la norme abstraite régente, oblitère et émascule tous les ordres concrets et toutes les institutions et les communautés concrètes, mais devra opter pour une forme d'Etat qui respecte et organise institutionnellement toutes les différences vivantes d'un territoire donné.
Ce principe est universellement valable, tant pour le territoire d'un Etat national classique que pour des territoires éventuellement plus vastes, comme les sphères culturelles (ex.: la Mitteleuropa, l'Europe en voie d'unification, des regroupements régionaux comme l'espace Alpes-Adriatique). Certes ces espaces connaîtront encore des frontières, mais celles-ci délimiteront les “civilisations” dont parle Samuel Huntington dans Le choc des civilisations (9). Ces civilisations diviseront demain l'humanité en vastes sphères différenciées voire antagonistes (dans le pire des cas), sans que l'on n'ait à appliquer globalement des normes générales, abstraites et universalistes, lesquelles ne sont en aucun cas des valeurs. Ces normes sont closes sur elles-mêmes, fermées et rigides, car elles sont des produits de l'esprit de fabrication et purement prescriptives. Les valeurs sont vivantes, ouvertes aux innovations fusant de toutes parts, effervescentes et dynamiques. Les valeurs ne sont jamais univoques, contrairement aux normes, elles sont “plurivoques”. Les normes ne recèlent en elles qu'un seul possible. Les valeurs sont à même de générer une pluralité de possibles.
Conclusion: Pour rétablir les communautés des communautariens, les ordres concrets qui fondent le droit selon Carl Schmitt, les Kulturstaaten selon Huber, les communautés de Kulturstaaten à l'intérieur de sphères culturelles ou de grands espaces de civilisation, nous devons renvoyer les “élites sans projet”, dénoncées par Süssmuth, Glotz et Seitz, et faire advenir des élites conscientes de leur devoir de respecter les acquis et de façonner l'avenir. De telles élites cultivent une éthique de la responsabilité. Celle-ci a été définie avec brio par des philosophes comme Max Weber, Hans Jonas et Karl-Otto Apel (10). Elle constituera le thème d'un prochain séminaire de “Synergies européennes”. Appelé à compléter celui d'aujourd'hui.
Robert STEUCKERS.
Forest, novembre 1997.
Notes:
(1) Hermann SCHEER, Zurück zur Politik. Die archimedische Wende gegen den Zerfall der Demokratie, Piper, München, 238 S., DM 29,80, ISBN 3-492-03782-8.
(2) Walter REESE-SCHÄFER, Was ist Kommunautarismus?, Campus, Frankfurt a. M., 1994, 191 S., DM 26,80, ISBN 3-593-35056-4. Voir également/Siehe auch: Transit. Europäische Revue, Nr. 5 («Gute Gesellschaft»), Winter 1992/93, Verlag Neue Kritik, Frankfurt a.M., ISSN 0938-2062.
(3) Jean-Baptiste de FOUCAULD & Denis PIVETEAU, Une société en quête de sens, Odile Jacob, Paris, 1995, 301 p., 140 FF, ISBN 2-7381-0352-9.
(4) Nicolas TENZER, Le tombeau de Machiavel, Flammarion, Paris, 1997, 546 p., 140 FF, ISBN 2-08-067343-2.
(5) Lothar PENZ, siehe Hefte von Junges Forum (genaue Angaben)
(6) Peter GLOTZ, Rita SÜSSMUTH, Konrad SEITZ, Die planlosen Eliten. Versäumen wir Deutschen die Zukunft?, edition ferenczy bei Bruckmann, München, 1992, 251 S., ISBN 3-7654-2701-2.
(7) Max-Emanuel GEIS, Kulturstaat und kulturelle Freiheit. Eine Untersuchung des Kulturstaatskonzepts von Ernst Rudolf Huber aus verfassungsrechtlicher Sicht, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1990, 298 S., ISBN 3-7890-2194-6.
(8) Stéphane PIERRÉ-CAPS, La multination. L'avenir des minorités en Europe centrale et orientale, Odile Jacob, Paris, 1995, 341 p., 160 FF, ISBN 2-7381-0280-8.
(9) Samuel HUNTINGTON, Le choc des civilisations, Odile Jacob, Paris, 1997, 402 p., 150 FF, ISBN 2-7381.0499.1.
(10) Detlef HORSTER, Politik als Pflicht. Studien zur politischen Philosophie, Suhrkamp, stw 1109, Frankfurt, 1993, 281 S., DM 19,80, ISBN 3-518-28709-5.
00:05 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, écologie, pensée organique, droite, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 octobre 2009
Revolte: met het nationalisme tegen het kapitalisme
Met het nationalisme tegen het kapitalisme
Geplaatst door yvespernet op 22 October 2009
Ondertussen al een paar weken uitgekomen, maar daarom niet minder interessant.

De inhoudstafel is als volgt:
( 1 ) Voorpost en het solidarisme - Johan van Slambrouck
( 2 ) Economische soevereiniteit – Sacha Vliegen
( 3 ) Verankering van de economie – Johan van Slambrouck
( 4 ) Over het Amerikaans bankensysteem – Yannick Goossens
( 5 ) Cultuur en globalisme – Yves Pernet
( 6 ) Het verschil tussen natinonaal en internationaal kapitaal – Yves Pernet
( 7 ) Boekbespreking “The Web of Debt” – Yves Pernet
( 8 ) Vlamingen een volk van meiden en knechten, mag het ietsje meer zijn? – Eddy van Buggenhout
( 9 ) De ondergang van Fortis – Johan van Slambrouck
( 10 ) Boekbespreking “The world is flat” – Yannick Goossens
( 11 ) Omdat economie niet aan de economen mag worden overgelaten – Joost Venema
( 12 ) Huizen van Vlaamse solidariteit: solidarisme in de praktijk – Luc Vermeulen
Wie denkt in dit Revoltenummer enkel oproepen te vinden om “alles anders te doen” zonder invulling zal nog verschieten. Meerdere analyses van wat er is fout gelopen, wat er anders moet, hoe dat moet en waarom. Dat is wat u kan verwachten.
Mijn bijdragen plaats ik later nog op dit weblog.
00:20 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : flandre, nationalisme, capitalisme, libéralisme, économie, finances, politique, théorie politique, solidarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 octobre 2009
Basic Bakunin
Basic Bakunin
Republished from the (British) Anarchist Communist Federation’s original pamphlet in 1993 by P.A.C. (Paterson Anarchist Collective) Publications. This electronic version has the extra ACF text added to the PAC version, for more completeness.
“The star of revolution will rise high above the streets of Moscow, from a sea of blood and fire, and turn into a lodestar to lead a liberated humanity”
-Mikhail Bakunin
Preface
The aim of this pamphlet is to do nothing more than present an outline of what the author thinks are the key features of Mikhail Bakunin’s anarchist ideas.
Bakunin was extremely influential in the 19th century socialist movement, yet his ideas for decades have been reviled, distorted or ignored. On reading this pamphlet, it will become apparent that Bakunin has a lot to offer and that his ideas are not at all confused (as some writers would have us think) but make up a full coherent and well argued body of thought. For a detailed but difficult analysis of Bakunin’s revolutionary ideas, Richard B. Saltman’s book, “The Social and Political Thought of Michael Bakunin” is strongly recommended. Ask your local library to obtain a copy.
Class
Bakunin saw revolution in terms of the overthrow of one oppressing class by another oppressed class and the destruction of political power as expressed as the state and social hierarchy. According to Bakunin, society is divided into two main classes which are fundamentally opposed to each other. The oppressed class, he variously described as commoners, the people, the masses or the workers, makes up a great majority of the population. It is in ‘normal’ time not conscious of itself as a class, though it has an ‘instinct’ for revolt and whilst unorganized, is full of vitality. The numerically much smaller oppressing class, however is conscious of its role and maintains its ascendancy by acting in a purposeful, concerted and united manner. The basic differences between the two classes, Bakunin maintained, rests upon the ownership and control of property, which is disproportionately in the hands of the minority class of capitalists. The masses, on the other hand, have little to call their own beyond their ability to work.
Bakunin was astute enough to understand that the differences between the two main classes is not always clear cut. He pointed out that it is not possible to draw a hard line between the two classes, though as in most things, the differences are most apparent at the extremes. Between these extremes of wealth and power there is a hierarchy of social strata which can be assessed according to the degree to which they exploit each other or are exploited themselves. The further away a given group is from the workers, the more likely it is to be part of the exploiting category and the less it suffers from exploitation. Between the two major classes there is a middle class or middle classes which are both exploiting and exploited, depending on their position of social hierarchy.
The masses who are the most exploited form, in Bakunin’s view, the great revolutionary class which alone can sweep away the present economic system. Unfortunately, the fact of exploitation and its resultant poverty are in themselves no guarantee of revolution. Extreme poverty is, Bakunin thought, likely to lead to resignation if the people can see no possible alternative to the existing order. Perhaps, if driven to great depths of despair, the poor will rise up in revolt. Revolts however tend to be local and therefore, easy to put down. In Bakunin’s view, three conditions are necessary to bring about popular revolution.
They are:
- sheer hatred for the conditions in which the masses find themselves
- the belief the change is a possible alternative
- a clear vision of the society that has to be made to bring about human emancipation
Without these three factors being present, plus a united and efficient self organization, no liberatory revolution can possibly succeed.
Bakunin had no doubts that revolution must necessarily involve destruction to create the basis of the new society. He stated that, quite simply, revolution means nothing less than war, that is the physical destruction of people and property. Spontaneous revolutions involve, often, the vast destruction of property. Bakunin noted that when circumstances demanded it, the workers will destroy even their own houses, which more often than not, do not belong to them. The negative, destructive urge is absolutely necessary, he argued, to sweep away the past. Destruction is closely linked with construction, since the “more vividly the future is visualized, the more powerful is the force of destruction.”
Given the close relationship between the concentration of wealth and power in capitalist societies, it is not surprising that Bakunin considered economic questions to be of paramount importance. It is in the context of the struggle between labor and capital that Bakunin gave great significance of strikes by workers. Strikes, he believed, have a number of important functions in the struggle against capitalism. Firstly they are necessary as catalysts to wrench the workers away from their ready acceptance of capitalism, they jolt them out of their condition of resignation. Strikes, as a form of economic and political warfare, require unity to succeed, thus welding the workers together. During strikes, there is a polarization between employers and workers. This makes the latter more receptive to the revolutionary propaganda and destroys the urge to compromise and seek deals. Bakunin thought that as the struggle between labor and capital increases, so will the intensity and number of strikes. The ultimate strike is the general strike. A revolutionary general strike, in which class conscious workers are infused with anarchist ideas will lead, thought Bakunin, to the final explosion which will bring about anarchist society.
Bakunin’s ideas are revolutionary in a very full sense, being concerned with the destruction of economic exploitation and social/political domination and their replacement by a system of social organization which is in harmony with human nature. Bakunin offered a critique of capitalism, in which authority and economic inequality went hand in hand, and state socialism, (e.g. Marxism) which is one sided in its concentration on economic factors whilst, grossly underestimating the dangers of social authority.
State
Bakunin based his consistent and unified theory upon three interdependent platforms, namely:
- human beings are naturally social (and therefore they desire social solidarity)
- are more or less equal and,
- want to be free
His anarchism is consequently concerned with the problem of creating a society of freedom within the context of an egalitarian system of mutual interaction. The problem with existing societies, he argued, is that they are dominated by states that are necessarily violent, anti-social, and artificial constructs which deny the fulfillment of humanity.
Whilst there are, in Bakunin’s view, many objectionable features within capitalism, apart from the state, (e.g. the oppression of women, wage slavery), it is the state which nurtures, maintains and protects the oppressive system as a whole. The state is defined as an anti-social machine which controls society for the benefit of an oppressing class or elite. It is essentially an institution based upon violence and is concerned with its maintenance of inequality through political repression. In addition the state relies upon a permanent bureaucracy to help carry out its aims. The bureaucratic element, incidentally, is not simply a tool which it promotes. All states, Bakunin believed, have internal tendencies toward self perpetuation, whether they be capitalist or socialist and are thus to be opposed as obstacles to human freedom.
It might be objected that states are not primarily concerned with political repression and violence and indeed that liberal democratic states, in particular, are much interested in social welfare. Bakunin argues that such aspects are only a disguise, and that when threatened, all states reveal their essentially violent natures. In Britain and Northern Ireland this repressive feature of state activity has come increasingly to the fore, when the state has been challenged to any significant degree, it has responded with brutal firmness.
And developments within Britain over the last couple decades tend to substantiate another feature of the state which Bakunin drew attention to, their tendency toward over increasing authoritarianism and absolutism. He believed that there were strong pressures in all states whether they are liberal, socialist, capitalist, or whatever, toward military dictatorship but that the rate of such development will vary, however according to factors such as demography, culture and politics.
Finally, Bakunin noted that states tend toward warfare against other states. Since there is no internationally accepted moral code between states, then rivalries between them will be expressed in terms of military conflict. “So long as there’s government, there will be no peace. There will only be more or less prolonged respites, armistices concluded by the perpetually belligerent states; but as soon as a state feels sufficiently strong to destroy this equilibrium to its advantage, it will never fail to do so.”
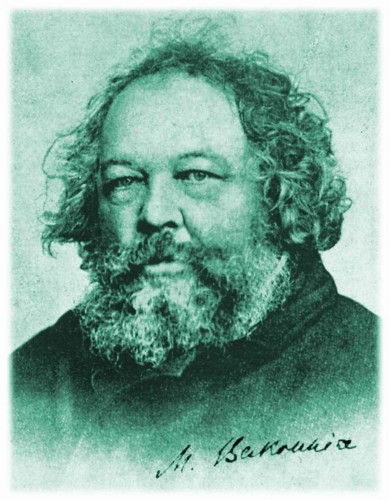 Bourgeois Democracy
Bourgeois Democracy
Political commentators and the media are constantly singing the praises of the system of representative democracy in which every few years or so the electorate is asked to put a cross on a piece of paper to determine who will control them. This system works good insofar as the capitalist system has found a way of gaining legitimacy through the illusion that some how the voters are in charge of running the system. Bakunin’s writings on the issue are of representative democracy were made at the time when it barely existed in the world. Yet he could see on the basis of a couple of examples (the United States and Switzerland) that the widening of the franchise does little to improve the lot of the great mass of the population. True, as Bakunin noted, middle class politicians are prepared to humble themselves before the electorate issuing all sorts of promises. But this leveling of candidates before the populace disappears the day after the election, once they are transformed into members of the Parliament. The workers continue to go to work and the bourgeoisie takes up once again the problems of business and political intrigue.
Today, in the United States and Western Europe, the predominant political system is that of liberal democracy. In Britain the electoral system is patently unfair in its distribution of parliamentary seats, insofar as some parties with substantial support get negligible representation. However, even where strict proportional representation applies, the Bakuninist critique remains scathing. For the representative system requires that only a small section of the population concern itself directly with legislation and governing (in Britain a majority out of 650 MP’s (Members of Parliament)).
Bakunin’s objections to representative democracy rests basically on the fact that it is an expression of the inequality of power which exists in society. Despite constitutions guaranteeing the rights of citizens and equality before the law, the reality is that the capitalist class is in permanent control. So long as the great mass of the population has to sell its labor power in order to survive, there can not be democratic government. So long as people are economically exploited by capitalism and there are gross inequalities of wealth, there can not be real democracy. As Bakunin made clear, economic facts are much stronger than political rights. So long as there is economic privilege there will be political domination by the rich over the poor. The result of this relationship is that representatives of capitalism (bourgeois democracy) “posses in fact, if not by right, the exclusive privilege of governing.”
A common fiction that is expounded in liberal democracies is that the people rule. However the reality is that minorities necessarily do the governing. A privileged few who have access to wealth, education and leisure time, clearly are better equipped to govern than ordinary working people, who generally have little free time and only a basic education.
But as Bakunin made clear, if by some quirk, a socialist government be elected, in real terms, things would not improve much. When people gain power and place themselves ‘above’ society, he argued, their way of looking at the world changes. From their exalted position of high office the perspective on life becomes distorted and seems very different to those on the bottom. The history of socialist representation in parliament is primarily that of reneging on promises and becoming absorbed into the manners, morality and attitudes of the ruling class. Bakunin suggests that such backsliding from socialist ideas is not due to treachery, but because participation in parliament makes representatives see the world through a distorted mirror. A workers parliament, engaged in the tasks of governing would, said Bakunin, end up a chamber of “determined aristocrats, bold or timid worshipers of the principle of authority who will also become exploiters and oppressors.”
The point that Bakunin makes time and time again in his writings is that no one can govern for the people in their interests. Only personal and direct control over our lives will ensure that justice and freedom will prevail. To abdicate direct control is to deny freedom. To grant political sovereignty to others, whether under the mantle of democracy, republicanism, the people’s state, or whatever, is to give others control and therefore domination over our lives.
It might be thought that the referendum, in which people directly make laws, would be an advance upon the idea of representative democracy. This is not the case according to Bakunin, for a variety of reasons. Firstly, the people are not in a position to make decisions on the basis of full knowledge of all the issues involved. Also, laws may be a complex, abstract, and specialized nature and that in order to vote for them in a serious way, the people need to be fully educated and have available the time and facilities to reflect upon and discuss the implications involved. The reality of referenda is that they are used by full-time politicians to gain legitimacy for essentially bourgeois issues. It is no coincidence that Switzerland, which has used the referendum frequently, remains one of the most conservative countries in Europe. With referenda, the people are guided by politicians, who set the terms of the debate. Thus despite popular input, the people still remain under bourgeois control.
Finally, Bakunin on the whole concept of the possibility of the democratic state: For him the democratic state is a contradiction in terms since the state is essentially about force, authority and domination and is necessarily based upon an inequality of wealth and power. Democracy, in the sense of self rule for all, means that no one is ruled. If no one rules, there can be no state. If there is a state, there can be no self rule.
Marx
Bakunin’s opposition to Marxism involves several separate but related criticisms. Though he thought Marx was a sincere revolutionary, Bakunin believed that the application of the Marxist system would necessarily lead to the replacement of one repression (capitalist) by another (state socialist).
Firstly, Bakunin opposed what he considered to be the economic determinist element in Marx’s thought, most simply stated that “Being determines consciousness.” Put in another way, Bakunin was against the idea that the whole range of ’super structural’ factors of society, its laws, moralities, science, religion, etc. were “but the necessary after effects of the development of economic facts.” Rather than history or science being primarily determined by economic factors (e.g. the ‘mode of production’), Bakunin allowed much more for the active intervention of human beings in the realization of their destiny.
More fundamental was Bakunin’s opposition to the Marxist idea of dictatorship of the proletariat which was, in effect, a transitional state on the way to stateless communism. Marx and Engles, in the Communist Manifesto of 1848, had written of the need for labor armies under state supervision, the backwardness of the rural workers, the need for centralized and directed economy, and for wide spread nationalization. Later, Marx also made clear that a workers’ government could come into being through universal franchise. Bakunin questioned each of these propositions.
The state, whatever its basis, whether it be proletarian or bourgeois, inevitably contains several objectionable features. States are based upon coercion and domination. This domination would, Bakunin stated, very soon cease to be that of the proletariat over its enemies but would become a state over the proletariat. This would arise, Bakunin believed, because of the impossibility of a whole class, numbering millions of people, governing on its own behalf. Necessarily, the workers would have to wield power by proxy by entrusting the tasks of government to a small group of politicians.
Once the role of government was taken out of the hands of the masses, a new class of experts, scientists and professional politicians would arise. This new elite would, Bakunin believed, be far more secure in its domination over the workers by means of the mystification and legitimacy granted by the claim to acting in accordance with scientific laws (a major claim by Marxists). Furthermore, given that the new state could masquerade as the true expression of the people’s will. The institutionalizing of political power gives rise to a new group of governors with the same self seeking interests and the same cover-ups of its dubious dealings.
Another problem posed by the statist system, that of centralized statist government would, argued Bakunin, further strengthen the process of domination. The state as owner, organizer, director, financier, and distributor of labor and economy would necessarily have to act in an authoritarian manner in its operations. As can be seen by the Soviet system, a command economy must act with decision flowing from top to bottom; it cannot meet the complex and various needs of individuals and, in the final analysis, is a hopeless, inefficient giant. Marx believed that centralism, from whatever quarter, was a move toward the final, statist solution of revolution. Bakunin, in contrast opposed centralism by federalism.
Bakunin’s predictions as to the operation of Marxist states has been borne out of reality. The Bolsheviks seized power in 1917, talked incessantly of proletarian dictatorship and soviet power, yet inevitably, with or without wanting to, created a vast bureaucratic police state.
Unions
Most of the left in Britain view the present structures of trade unions in a positive light. This is true for members of the Labor Party, both left and right, the Communist Party, the Militant Tendency and many other Marxist organizations. These bodies wish to capture or retain control of the unions, pretty much as they stand, in order to use them for their own purposes. As a result, there are frequently bitter conflicts and maneuverings within the unions for control. This trend is most apparent in the C.P.S.A. where a vicious anti-communist right wing group alternates with the Militant Tendency and its supporters for control of the union executive and full time posts. The major exception to this is the Socialist Workers Party which advocates rank and file organization, so long as the S.W.P. can control it.
Bakunin laid the foundations of the anarchist approach to union organization and the general tendency of non-anarchist unions to decay into personal fiefdoms and bureaucracy over a century ago. Arguing in the context of union organization within the International Working Mens Association, he gave examples of how unions can be stolen from the membership whose will they are supposed to be an expression of. He identified several interrelated features which lead to the usurpation of power by union leaders.
Firstly, he indicated a psychological factor which plays a key part. Honest, hardworking, intelligent and well meaning militants win through hard work the respect and admiration of their fellow members and are elected to union office. They display self sacrifice, initiative and ability. Unfortunately, once in positions of leadership, these people soon imagine themselves to be indispensable and their focus of attention centers more and more on the machinations within the various union committees.
The one time militant thus becomes removed from the every day problems of the rank and file members and assumes the self delusion which afflicts all leaders, namely a sense of superiority.
Given the existence of union bureaucracies and secret debating chambers in which leaders decide union actions and policies, a ‘governmental aristocracy’ arises within the union structures, no matter how democratic those structures may formally be. With the growing authority of the union committees etc., the workers become indifferent to union affairs, with the exception Bakunin asserts, of issues which directly affect them e.g. dues payment, strikes etc. Unions have always had great problems in getting subscriptions from alienated memberships, a solution which has been found in the ‘check off’ system by which unions and employers collaborate to remove the required sum at source, i.e. from the pay packet.
Where workers do not directly control their union and delegate authority to committees and full-time agents, several things happen. Firstly, so long as union subscriptions are not too high, and back dues are not pressed too hard for, the substituting bodies can act with virtual impunity. This is good for the committees but brings almost to an end the democratic life of the union. Power gravitates increasingly to the committees and these bodies, like all governments substitute their will for that of the membership. This in turn allows expression for personal intrigues, vanity, ambition and self-interest. Many intra-union battles, which are ostensibly fought on ideological grounds, are in fact merely struggles for control by ambitious self seekers who have chosen the union for their career structure. This careerism occasionally surfaces in battles between rival leftists, for example where no political reasons for conflict exist. In the past the Communist Party offered a union career route within certain unions and such conflicts constantly arose.
Presumably, within the Militant Tendency, which also wishes to capture unions, the same problem exists.
Within the various union committees, which are arranged on a hierarchical basis (mirroring capitalism), one or two individuals come to dominate on the basis of superior intelligence or aggressiveness. Ultimately, the unions become dominated by bosses who hold great power in their organizations, despite the safeguards of democratic procedures and constitutions. Over the last few decades, many such union bosses have become national figures, especially in periods of Labor government.
Bakunin was aware that such union degeneration was inevitable but only arises in the absence of rank and file control, lack of opposition to undemocratic trends and the accession to union power to those who allow themselves to be corrupted. Those individuals who genuinely wish to safeguard their personal integrity should, Bakunin argued, not stay in office too long and should encourage strong rank and file opposition. Union militants have a duty to remain faithful to their revolutionary ideals.
Personal integrity, however, is an insufficient safeguard. Other, institutional and organizational factors must also be brought into play. These include regular reporting to the proposals made by the officials and how they voted, in other words frequent and direct accountability. Secondly, such union delegates must draw their mandates from the membership being subject to rank and file instructions. Thirdly, Bakunin suggests the instant recall of unsatisfactory delegates. Finally, and most importantly, he urged the calling of mass meetings and other expressions of grass roots activity to circumvent those leaders who acted in undemocratic ways. Mass meetings inspire passive members to action, creating a camaraderie which would tend to repudiate the so called leaders.
(Electronic Ed- From this, one can conclude that Bakunin was a major inspiration for the anarcho-syndicalist movement.)
Revolutionary Organization
Above all else, Bakunin the revolutionary, believed in the necessity of collective action to achieve anarchy. After his death there was a strong tendency within the anarchist movement towards the abandonment of organization in favor of small group and individual activity. This development, which culminated in individual acts of terror in the late nineteenth century France, isolating anarchism from the very source of the revolution, namely the workers.
Bakunin, being consistent with other aspects of his thought, saw organization not in terms of a centralized and disciplined army (though he thought self discipline was vital), but as the result of decentralized federalism in which revolutionaries could channel their energies through mutual agreement within a collective. It is necessary, Bakunin argued, to have a coordinated revolutionary movement for a number of reasons. Firstly, is anarchists acted alone, without direction they would inevitably end up moving in different directions and would, as a result, tend to neutralize each other. Organization is not necessary for its own sake, but is necessary to maximize strength of the revolutionary classes, in the face of the great resources commanded by the capitalist state.
However, from Bakunin’s standpoint, it was the spontaneous revolt against authority by the people which is of the greatest importance. The nature of purely spontaneous uprisings is that they are uneven and vary in intensity from time to time and place to place. The anarchist revolutionary organization must not attempt to take over and lead the uprising but has the responsibility of clarifying goals, putting forward revolutionary propaganda, and working out ideas in correspondence with the revolutionary instincts of the masses. To go beyond this would undermine the whole self-liberatory purpose of the revolution. Putchism has no place in Bakunin’s thought.
Bakunin then, saw revolutionary organization in terms of offering assistance to the revolution, not as a substitute. It is in this context that we should interpret Bakunin’s call for a “secret revolutionary vanguard” and “invisible dictatorship” of that vanguard. The vanguard it should be said, has nothing in common with that of the Leninist model which seeks actual, direct leadership over the working class. Bakunin was strongly opposed to such approaches and informed his followers that “no member… is permitted, even in the midst of full revolution, to take public office of any kind, nor is the (revolutionary) organization permitted to do so… it will at all times be on the alert, making it impossible for authorities, governments and states to be established.” The vanguard was, however, to influence the revolutionary movement on an informal basis, relying on the talents of it’s members to achieve results. Bakunin thought that it was the institutionalization of authority, not natural inequalities, that posed a threat to the revolution. The vanguard would act as a catalyst to the working classes’ own revolutionary activity and was expected to fully immerse itself in the movement. Bakunin’s vanguard then, was concerned with education and propaganda, and unlike the Leninist vanguard party, was not to be a body separate from the class, but an active agent within it.
The other major task of the Bakuninist organization was that it would act as the watchdog for the working class. Then, as now, authoritarian groupings posed as leaders of the revolution and supplied their own members as “governments in waiting.” The anarchist vanguard has to expose such movements in order that the revolution should not replace one representative state by another ‘revolutionary’ one. After the initial victory, the political revolutionaries, those advocates of so-called workers’ governments and the dictatorship of the proletariat, would according to Bakunin try “to squelch the popular passions. They appeal for order, for trust in, for submission to those who, in the course and the name of the revolution, seized and legalized their own dictatorial powers; this is how such political revolutionaries reconstitute the state. We on the other hand, must awaken and foment all the dynamic passions of the people.”
Anarchy
Throughout Bakunin’s criticisms of capitalism and state socialism he constantly argues for freedom. It is not surprising, then, to find that in his sketches of future anarchist society that the principle of freedom takes precedence. In a number of revolutionary programs he outlined which he considered to be the essential features of societies which would promote the maximum possible individual and collective freedom. The societies envisioned in Bakunin’s programs are not Utopias, the sense of being detailed fictional communities, free of troubles, but rather suggest the basic minimum skeletal structures which would guarantee freedom. The character of future anarchist societies will vary, said Bakunin depending on a whole range of historical, cultural, economic and geographical factors.
The basic problem was to lay down the minimum necessary conditions which would bring about a society based upon justice and social welfare for all and would also generate freedom. The negative, that is, destructive features of the programs are all concerned with the abolition of those institutions which lead to domination and exploitation. The state, including the established church, the judiciary, state banks and bureaucracy, the armed forces and the police are all to be swept away. Also, all ranks, privileges, classes and the monarchy are to be abolished.
The positive, constructive features of the new society all interlink to promote freedom and justice. For a society to be free, Bakunin argued, it is not sufficient to simply impose equality. No, freedom can only be achieved and maintained through the full participation in society of a highly educated and healthy population, free from social and economic worries. Such an enlightened population, can then be truly free and able to act rationally on the basis of a popularly controlled science and a thorough knowledge of the issues involved.
Bakunin advocated complete freedom of movement, opinion, morality where people would not be accountable to anyone for their beliefs and acts. This must be, he argued, complete and unlimited freedom of speech, press and assembly. Freedom, he believed, must be defended by freedom, for to “advocate the restriction of freedom on the pretext that it is being defended is a dangerous delusion.” A truly free and enlightened society, Bakunin said, would adequately preserve liberty. An ordered society, he thought, stems not from suppression of ideas, which only breeds opposition and factionalism, but from the fullest freedom for all.
This is not to say that Bakunin did not think that a society has the right to protect itself. He firmly believed that freedom was to be found within society, not through its destruction. Those people who acted in ways that lessen freedom for others have no place; These include all parasites who live off the labor of others. Work, the contribution of one’s labor for the creation of wealth, forms the basis of political rights in the proposed anarchist society. Those who live by exploiting others do not deserve political rights. Others, who steal, violate voluntary agreements within and by society, inflict bodily harm etc. can expect to be punished by the laws which have been created by that society. The condemned criminal, on the other hand, can escape punishment by society by removing himself/herself from society and the benefits it confers. Society can also expel the criminal if it so wishes. Basically thought, Bakunin set great store on the power of enlightened public opinion to minimize anti-social activity.
Bakunin proposed the equalization of wealth, though natural inequalities which are reflected in different levels of skill, energy and thrift, should he argued be tolerated. The purpose of equality is to allow individuals to find full expression of their humanity within society. Bakunin was strongly opposed to the idea of hired labor which if introduced into an anarchist society, would lead to the reintroduction of inequality and wage slavery. He proposed instead collective effort because it would, he thought, tend to be more efficient. However, so long as individuals did not employ others, he had no objection to them working alone.
Through the creation of associations of labor which could coordinate worker’s activities, Bakunin proposed the setting up of an industrial assembly in order to harmonize production with the demand for products. Such an assembly would be necessary in the absence of the market. Supplied with statistical information from the various voluntary organization who would be federated, production could be specialized on an international basis so that those countries with inbuilt economic advantages would produce most efficiently for the general good. Then, according to Bakunin, waste, economic crisis and stagnation “will no longer plague mankind; the emancipation of human labor will regenerate the world.”
Turning to the question of the political organization of society, Bakunin stressed that they should all be built in such a way as to achieve order through the realization of freedom on the basis of the federation of voluntary organizations. In all such political bodies power is to flow “from the base to the summit” and from “the circumference to the center/” In other words, such organizations should be the expressions of individual and group opinions, not directing centers which control people.
On the basis of federalism, Bakunin proposed a multi-tier system of responsibility for decision making which would be binding on all participants, so long as they supported the system. Those individuals, groups or political institutions which made up the total structure would have the right to secede. Each participating unit would have an absolute right to self-determination, to associate with the larger bodies, or not. Starting at the local level, Bakunin suggested as the basic political unit, the completely autonomous commune. The commune, on the basis of universal suffrage, would elect all of its functionaries, law makers, judges, and administrators of communal property.
The commune would decide its own affairs but, if voluntarily federated to the next tier of administration, the provincial assembly, its constitution must conform to the provincial assembly. Similarly, the constitution of the province must be accepted by the participating communes. The provincial assembly would define the rights and obligations existing between communes and pass laws affecting the province as a whole. The composition of the provincial assembly would be decided on the basis of universal suffrage.
Further levels of political organization would be the national body, and, ultimately, the international assembly. As regards international organization, Bakunin proposed that there should be no permanent armed forces, preferring instead, the creation of local citizens’ defense militias. Disputes between nations and their provinces would be settled by an international assembly. This assembly, if required, could wage war against outside aggressors but should a member nation of the international federation attack another member, then it faces expulsion and the opposition of the federation as a whole.
Thus, from root to branch, Bakunin’s outline for anarchy is based upon the free federation of participants in order to maximize individual and collective well being.
Bakunin’s Relevance Today
Throughout most of this pamphlet Bakunin has been allowed to speak for himself and any views by the writer of the pamphlet are obvious. In this final section it might be valuable to make an assessment of Bakunin’s ideas and actions.
With the dominance of Marxism in the world labor and revolutionary movements in the twentieth century, it became the norm to dismiss Bakunin as muddle-headed or irrelevant. However, during his lifetime he was a major figure who gained much serious support. Marx was so pressured by Bakunin and his supporters that he had to destroy the First International by dispatching it to New York. In order that it should not succumb to Anarchism, Marx killed it off through a bureaucratic maneuver.
Now that Marxism has been seriously weakened following the collapse of the USSR and the ever increasingly obvious corruption in China, Bakunin’s ideas and revolutionary Anarchism have new possibilities. If authoritarian, state socialism has proved to be a child devouring monster, then libertarian communist ideas once again offer a credible alternative.
The enduring qualities of Bakunin and his successors are many, but serious commitment to the revolutionary overthrow of capitalism and the state must rank high. Bakunin was much more of a doer than a writer, he threw himself into actual insurrections, much to the trepidation of European heads of state. This militant tradition was continued by Malatesta, Makhno, Durruti, and many other anonymous militants. Those so-called anarchists who adopt a gradualist approach are an insult to Anarchism. Either we are revolutionaries or we degenerate into ineffective passivism.
Bakunin forecast the dangers of statist socialism. His predictions of a militarized, enslaved society dominated by a Marxist ruling class came to pass in a way that even Bakunin could not have fully envisaged. Lenin, Trotsky and Stalin outstripped even the Tsars in their arrogance and brutality. And, after decades of reformist socialism which have frequently formed governments, Bakunin’s evaluations have been proved correct. In Britain we have the ultimate insult to working people in the form of “socialist Lords”. For services to capitalism, Labor MP’s are ultimately granted promotion to the aristocracy.
Bakunin fought for a society based upon justice, equality and freedom. Unlike political leaders of the left he had great faith in the spontaneous, creative and revolutionary potential of working people. His beliefs and actions reflect this approach. So, revolutionaries can learn much of value from his federalism, his militancy and his contempt for the state, which, in the twentieth century, has assumed gigantic and dangerous proportions, Bakunin has much to teach us but we too must develop our ideas in the face of new challenges and opportunities. We must retain the revolutionary core of his thought yet move forward. Such is the legacy of Bakunin.
With this in mind, the Anarchist Communist Federation is developing a revolutionary anarchist doctrine, which whilst being ultimately based on Bakunin’s ideas, goes much further to suit the demands of present-day capitalism. Ecological issues, questions of imperialist domination of the world, the massive oppression of women, the automation of industry, computerized technology etc. are all issues that have to be tackled. We welcome the challenge!
FURTHER READING
There are two main compilations of Bakunin’s works which are quite readily available through public libraries. They are “Bakunin on Anarchy” edited by Sam Dolgoff and “The Political Philosophy of Bakunin” edited by G.P. Maximoff. Also worth looking at, if you can get hold of them are “The Basic Bakunin – Writings 1869-1871″ edited by Robert M. Cutler and “Mikhail Bakunin – From Out of the Dustbin”, edited by the same person.
For an understanding of the full profundity of Bakunin’s ideas, there is nothing to match “The Social and Political Thought of Michael Bakunin” by Richard B Saltman. This American publication should be available through your local library.
Bakunin’s works currently available:
- “God and the State”
- “Marxism, Freedom and the State” (edited by K.J. Kenafik)
- “The Paris Commune and the Idea of the State”
- “Statism and Anarchy” (heavy going) ed. Marshall Shatz.
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anarchisme, gauche, théorie politique, sciences politiques, politologie, histoire, russie, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 19 octobre 2009
Ernst Krieck (1882-1947)
 KRIECK Ernst, 1882-1947
KRIECK Ernst, 1882-1947
Né à Vögisheim en pays de Bade le 6 juillet 1882, ce pédagogue entame une carrière d'instituteur en 1900, puis de directeur d'école primaire, pour devenir, après s'être formé en autodidacte, docteur honoris causa de l'Université de Heidelberg en 1923. En 1928, Krieck est nommé à l'«Académie pédagogique» de Francfort s.M. Ses convictions nationales-socialistes lui valent plusieurs mesures disciplinaires. Après la prise du pouvoir par Hitler, il est nommé professeur ordinaire à Francfort. De 1934 à 1945, il enseigne à Heidelberg. Avec ses amis M.R. Gerstenhauer et Werner Kulz, il édite de 1932 à 1934 la revue Die Sonne, fondée en 1924. A partir de 1933, il publie seul la revue Volk im Werden. Il collabore dans le même temps à plusieurs publications consacrées à la pédagogie. L'objectif de ses études historiques sur la pédagogie était d'ordre philosophique, écrit-il, car elles visaient à cerner le noyau commun de tous les modes d'éducation, juif, grec, romain, médiéval, allemand (de l'humanisme de la Renaissance au rationalisme du XVIIIième et de celui-ci au romantisme national(iste)). A partir de 1935, Krieck abandonne la pédagogie stricto sensu pour vouer tous ses efforts à l'élaboration d'une anthropologie «völkisch» au service du nouveau régime.
Krieck est surtout devenu célèbre pour sa polémique contre Heidegger, amorcée dans les colonnes de Volk im Werden et dans son discours de Rectorat à l'Université de Francfort prononcé le 23 mai 1933. Outre sa polémique agressive et sévère contre le langage abstrait, calqué sur les traditions grecques et juives, de l'auteur de Sein und Zeit, Krieck reprochait à Heidegger de vouloir sauver la philosophie, la «plus longue erreur de l'humanité hespériale», une erreur qui consiste à vouloir «refouler et remplacer le réel par le concept». Refoulement et oblitération du réel qui conduisent au nihilisme. Partisan inconditionnel de l'hitlérisme, Krieck affirme que la révolution nationale-socialiste dépassera ce nihilisme engendré par la dictature des concepts. Reviendra alors le temps des poètes homériques, inspirés par le «mythe», et des «historiens» en prise directe sur les événements politiques, dont l'ancêtre génial fut Hérodote, l'ami du tragédien Sophocle. Figure emblématique de la Terre-mère, idée mobilisatrice de la Vie, puissance du destin, sentiment tragique de l'existence, cosmos, sont les mots-clefs de cette pensée du pédagogue Krieck, en guerre contre la philosophie du concept. Le règne du logos, inauguré par Héraclite d'abord, puis surtout par Platon, l'ennemi des poètes, conduit les hommes à vivre dans un monde aseptisé, inerte, dépourvu de tragédie: le «monde des idées» ou de l'Etre. La pensée doit donc faire retour au charnel grouillant et bouillonant, aux matrices (Mutterschoß et Mutterboden), aux «lois incontournables du sang et de la race», dans un maëlstrom de faits et de défis sans cesse effervescent, ne laissant jamais aucun repos à la volonté, cette force intérieure qui arraisonne ce réel inépuisablement fécond.
Interné dans le camp de concentration de Moosberg en 1945, pour son appartenance aux cadres de la NSDAP, Krieck y meurt le 19 mars 1947.
L'idée de l'Etat allemand (Die deutsche Staatsidee), 1934
L'intérêt de cet ouvrage est de nous livrer une histoire de la pensée politique allemande, telle que peut la concevoir un vitaliste absolu qui adhère au mouvement hitlérien. Pour Krieck, les sources de l'Etat moderne résident dans l'absolutisme, instauré graduellement à partir de la fin du XVième siècle. Avant l'absolutisme règnait en Allemagne le droit communautaire germanique. L'irruption dans le discours politique de l'idée et de l'idéologie du droit naturel est le fruit du rationalisme et du mathématisme du XVIIième siècle, renforcé au cours du XVIIIième et trouvant son apothéose chez Kant. Dans l'optique du droit naturel et du rationalisme, le droit et l'Etat sont des formes aprioristiques de l'esprit et ne sont pas le résultat d'un travail, d'une action, d'une aventure historique tragique. En ce sens, le droit naturel est abstrait, explique Krieck. C'est une pensée politique idéaliste et non organique. Krieck définit ce qu'est pour lui l'organique: c'est l'unité vivante qu'il y a dans un être à composantes multiples. C'est la constance que l'on peut observer malgré les mutations successives de forme et de matière. C'est, enfin, l'immuabilité idéelle de certains traits essentiels ou de caractère. Le libéralisme s'est opposé au constructivisme absolutiste; en Angleterre, il vise à limiter l'emprise de l'Etat et à multiplier les droits politiques pour la classe possédante. En France, depuis la révolution jacobine, tout le poids décisionnaire de l'appareil étatique bascule entre les mains de la majorité électorale sans tenir compte des intérêts des oppositions. En Allemagne, le libéralisme anti-absolutiste est d'une autre nature: il est essentiellement culturel. Ses protagonistes entendent sans cesse se former et se cultiver car le droit à l'épanouissement culturel est le premier des droits de l'homme. L'Etat libéral allemand doit par conséquent devenir une sorte d'institut d'éducation éthique permanente. Dans cette optique, sont condamnables toutes les forces qui contrarient le développement de l'éducation. Humboldt est la figure emblématique de ce libéralisme. Krieck entend mettre les «illusions» de Humboldt en exergue: la figure de proue du libéralisme culturaliste allemand croit que l'homme, dès qu'il est libéré du joug de l'absolutisme, va spontanément adhérer à l'idéal de la culture. Cette vision idéalisée de l'homme est désincarnée et l'Etat se trouve réduit à un rôle minimal, même s'il est sublime. Humboldt a raison de dire que l'énergie est la première des vertus de l'homme mais l'idéal qu'il propose est, lui, dépourvu d'énergie, de socle dynamisant. L'humanité, contrairement à ce que croit Humboldt, ne se déploie pas dans l'espace en harmonie mais à partir d'une lutte constante entre entités vitales supra-personnelles. Il y a émergence d'une Bildung originale là où s'affirme une force dans une lutte qui l'oppose à des résistances. Mais quand on parle de force, on doit toujours parler en terme d'holicité et non d'individu. Une force est toujours collective/communautaire et révèle dans le combat son idée motrice, créatrice d'histoire. Humboldt, dit Krieck, est prisonnier d'une méthodologie individualiste, héritée de l'Aufklärung. Or la Bildung n'est pas le produit d'une individualité mais le reflet du meilleur du peuple, sinon elle ne serait qu'originalité inféconde. L'Etat doit organiser la Bildung et l'imposer à tout le corps social/populaire. Affirmer ce rôle de l'Etat: voilà le pas que n'a pas franchi Humboldt. Il rejette l'absolutisme et la bureaucratie, qui en découle, comme des freins à l'épanouissement de la Bildung sans conjuguer l'idée d'un Etat éthique avec l'idéal de cette Bildung.
L'Etat doit être la puissance éducatrice et «éthicisante» du peuple. Krieck reprend à son compte, dans sa synthèse, l'héritage de l'Aufklärung selon l'agitateur et pédagogue rousseauiste Basedow. Au XVIIIième siècle, celui-ci militait pour que l'Etat —et non plus l'Eglise— organise un système d'enseignement cohérent et fondateur d'une élite politique. Après l'échec de la vieille Prusse devant les canons napoléoniens, la pensée allemande prend conscience de la nécessité de structurer le peuple par l'éducation. Krieck rappelle une parole de Fichte qui disait que l'Etat allemand qui aurait pour programme de faire renaître la nation par l'éducation, tout en promouvant l'idée de l'Etat éducateur, en tirerait le maximum de gloire. Dans cette perspective pédagogisante fichtéenne/krieckienne, l'Etat, c'est l'organisation des moyens éducatifs au bénéfice de ses objectifs propres. Krieck se réfère ensuite au Baron von Stein qui avait la volonté de fusionner trois grands courants d'idées en Allemagne: le prussianisme (avec son sens du devoir et du service), l'idée de Reich et l'idée culturelle/spirituelle de Nation. De cette volonté de fusion découlait une vision originale de ce que doit être l'éducation: faire disparaître les disharmonies existant au sein du peuple et provoquées par les querelles entre états (Stände), de façon à ce que «chaque ressortissant du Volk puisse déployer ses forces dans un sens moral». Stein ne se contente donc pas de vouloir éliminer des barrières mais veut très explicitement diriger et encadrer le peuple façonné par la Bildung. L'éducation fait de l'Etat un organisme animé (beseelter Organismus) qui transmet sa force aux générations futures. Pour Fichte —et en écho, pour Krieck— l'éducation doit susciter une Tatbereitschaft, c'est-à-dire une promptitude à l'action, un ensemble de sentiments puissants qui, ajoutera ultérieurement Schleiermacher, donne une âme à l'Etat et cesse d'en faire un simple jeu de mécanismes et d'engrenages. Hardenberg est une autre figure de la Prusse post-napoléonienne qu'analyse Krieck. Souvent cité en même temps que Stein, Hardenberg est toutefois moins radical, parce que plus lié aux anciennes structures absolutistes: il prône un laissez-faire d'inspiration anglaise (Adam Smith) et ne conçoit l'Etat que comme police. Pour Krieck, c'est là une porte ouverte au primat de l'économie sur l'éducation, à l'emprise du manchesterisme et du monopolisme ploutocratique à l'américaine sur le devenir de la nation.
Krieck critique Schelling, personnage jugé par lui trop aristocratique, trop isolé du peuple, et qui, par conséquent, a été incapable de formuler une philosophie satisfaisante de l'Etat et de l'histoire. En revanche, certaines de ses intuitions ont été géniales, affirme Krieck. L'Etat, pour Schelling, n'est plus une «œuvre d'art», le produit d'une technique, mais le reflet de la vie absolue. Droit et Etat, chez Schelling, n'existent pas a priori pour qu'il y ait équilibre dans la vie mais l'équilibre existe parce que la vie existe, ce qui corrobore l'idée krieckienne qu'il n'y a que la vie, sans le moindre arrière-monde. Krieck regrette que Schelling ait enfermé cette puissante intuition dans une démarche trop esthétisante. Adam Müller complète Schelling en politisant, historicisant et économicisant les thèses de son maître à penser. Krieck énumère ensuite les mérites de Hegel. L'idée de l'Etat éducateur connaît par la suite des variantes conservatrices, réformistes et économistes. Les conservateurs cultivent l'idéal médiévisant d'un Etat corporatiste (Ständestaat) mais centralisé: ils retiennent ainsi les leçons de l'Aufklärung et de la révolution. Paul de Lagarde est un précurseur plus direct de l'Etat éducateur national-socialiste, qui ramasse toutes les traditions politiques allemandes, les fusionne et les ancre dans la réalité. Lagarde affirmait, lui aussi, que le premier but de la politique, c'était l'éducation: «la politique est à mon avis rien d'autre que pédagogie, tant vis-à-vis du peuple que vis-à-vis des princes et des hommes d'Etat». Dans cet ouvrage datant des premiers mois de la prise du pouvoir par Hitler, Krieck propose pour la première fois de transposer ses théories pédagogiques dans le cadre du nouveau régime qui, croit-il, les appliquera.
Anthropologie politique völkisch (Völkisch-politische Anthropologie), 1936
Les fondements du réel politique sont biologiques: ils relèvent de la biologie universelle. Tel est la thèse de départ de l'anthropologie völkisch de Krieck. La biologie pose problème depuis le XVIIIième siècle, où elle est entrée en opposition au «mécanicisme copernicien». La «Vie» est alors un concept offensif dirigé contre les philosophies mécanicistes de type cartésien ou newtonien; ce concept réclame l'autonomie de la sphère vitale par rapport aux lois de la physique mécanique. L'épistémologie biologique, depuis ses premiers balbutiements jusqu'aux découvertes de Mendel, a combattu sur deux fronts: contre celui tenu par les théologiens et contre celui tenu par les adeptes des philosophies mécanicistes. Leibniz avait évoqué la téléologie comme s'opposant au mécanicisme universel en vogue à son époque. Les théologiens, pressentant l'offensive de la biologie, ont mis tout en œuvre pour que la téléologie retourne à la théologie et ne se «matérialise» pas en biologie. Le débat entre théologiens et «réalitaires biologisants» a tourné, affirme, Krieck, autour du concept aristotélicien d'entéléchie, revu par Leibniz, pour qui l'entéléchie est non plus l'état de l'être en acte, pleinement réalisé, mais l'état des choses qui, en elles, disposent d'une suffisance qui les rend sources de leurs actions internes. La biologie est donc la science qui étudie tout ce qui détient en soi ses propres sources vitales, soit les êtres vivants, parmi lesquels les peuples et les corps politiques.
Pour Krieck, la Vie est la réalité totale: il n'y a rien ni derrière ni avant ni après la Vie; elle est un donné originel (urgegeben), elle est l'Urphänomen par excellence dans lequel se nichent tous les autres phénomènes du monde et de l'histoire. La conscience est l'expression de la Vie, du principe vital omni-englobant. Les peuples, expressions diverses de cette Vie, tant sur le plan phénoménal que sur le plan psychique, sont englobés dans cette totalité vitale. Le problème philosophique que Krieck cherche à affronter, c'est de fonder une anthropologie politique où le peuple est totalité, c'est-à-dire base de Vie, source vitale, où puisent les membres de la communauté populaire (les Volksgenoßen) pour déployer leurs énergies dans le cosmos. Tout peuple est ainsi une niche installée dans le cosmos, où ses ressortissants naissent et meurent sans cesser d'être reliés à la totalité cosmique. L'idée de Vie dépasse et englobe l'idée évangélique de l'incarnation car elle pose l'homme comme enraciné dans son peuple de la même façon que le Christ est incarné en Dieu, son Père, sans que l'homme ne soit détaché de ses prochains appartenant à la même communauté de sang. Le cycle vital transparaît dans la religiosité incarnante (incarnation catholique mais surtout mystique médiévale allemande), qui est une religion de valorisation du réel qui, pour l'homme, apparaît sous des facettes diverses: humanité, Heimat, race, peuple, communauté politique, communauté d'éducation, etc. Dans la sphère de l'Etat, se trouvent de multiples Volksordnungen, d'ordres dans le peuple, soit autant de niches où les individus sont imbriqués, organisés, éduqués (Zucht) et policés. Krieck oppose ensuite l'homme sain à l'homme malade; la santé, c'est de vivre intensément dans le réel, y compris dans ses aspects désagréables, en acceptant la mort (sa mort) et les morts. Cette santé est le propre des races héroïques dont les personnalités se perçoivent comme les maillons dans la chaîne des générations, maillons éduqués, marqués par l'éthique de la responsabilité et par le sens du devoir. Les hommes malades —c'est-à-dire les esclaves et les bourgeois— fuient la mort et la nient, éloignent les tombes extra muros, indice que l'idée d'une chaîne des générations a disparu.
Caractère du peuple et conscience de sa mission. L'éthique politique du Reich (Volkscharakter und Sendungsbewußtsein. Politische Ethik des Reiches), 1940
Cet ouvrage de Krieck comprend deux volets: 1) une définition du caractère national allemand; 2) une définition de la «mission» qu'implique l'idée de Reich. Le caractère national allemand a été oblitéré par la christianisation, même si les Papes évangélisateurs des régions germaniques ont été conscients du fait que l'esprit chrétien constituait une sorte d'Übernatur, d'adstrat artificiel imposé à l'aide de la langue latine, qui recouvrait tant bien que mal une naturalité foncièrement différente. Le Moyen Age a été marqué par un christianisme véhiculant les formes mortes de l'Antiquité. Seuls les Franciscains ont laissé plus ou moins libre cours à la religiosité populaire et permis au Lied allemand de prendre son envol. La Renaissance, l'humanisme et le rationalisme n'ont fait que séculariser une culture détachée du terreau populaire. Le national-socialisme est la révolution définitive qui permettra le retour à ce terreau populaire refoulé. Il sera la pleine renaissance de la Weltanschauung germanique, qui relaie et achève les tentatives avortées d'Albert le Grand, d'Eike von Repgow, de Walther von der Vogelweide, de Maître Eckehart, de Nicolas de Cues, de Luther, de Paracelse, etc. Sans cesse, l'Allemagne a affirmé son identité nationale grâce à un flux continu venu du Nord. S'appuyant sur les thèses du scandinaviste Grönbech, Krieck parle du sentiment nordique de la communauté, du service dû à cette communauté et à la volonté de préserver son ancrage spirituel contre les influences étrangères. Pour Grönbech et Krieck, l'individu ne s'évanouit pas dans la communauté mais résume en lui cette communauté dont les ressortissants partagent les mêmes sentiments, les mêmes projets, le même passé, le même présent et, res sic stantibus, le même avenir. Ce destin commun s'exprime dans l'honneur, la Ehre.
Krieck insiste sur la notion de Mittgart (ou Midgard) qui, dans la mythologie germanique/scandinave, désigne le monde intermédiaire entre l'Asgard (le monde des Ases, le monde de lumière) et l'Utgard (le monde de l'obscurité). Ce Mittgart est soumis au devenir (urd) et aux caprices des Nornes. C'est un monde de tensions perpétuelles, de luttes, de dynamique incessante. Les périodes de paix qui ensoleillent le Mittgart sont de brefs répits succédant à des victoires jamais définitives sur les forces du chaos, émanant de l'Utgard. Le mental nordique retient aussi la notion de Heil, une force agissante et fécondante, à connotations sotériologiques, qui anime une communauté. Cette force induit un flux ininterrompu de force qui avive la flamme vitale d'une communauté ou d'une personne et accroît ses prestations. Le substrat racial nordique irradie une force de ce type et génère un ordre axiologique particulier qu'il s'agit de défendre et d'illustrer. La foi nouvelle qui doit animer les hommes nouveaux, c'est de croire à leur action pour fonder et organiser un Reich, un Etat, un espace politique, pour accoucher de l'histoire.
Le droit doit devenir le droit des hommes libres à la façon de l'ancien droit communautaire germanique, où le Schöffe (le juge) crée sans cesse le droit, forge son jugement et instaure de la sorte un droit vivant, diamétralement différent du droit abstrait, dans la mesure où il est porté par la «subjectivité saine d'un homme d'honneur». Le droit ancestral spontané a été oblitéré depuis la fin du XVième siècle par le droit pré-mécaniciste de l'absolutisme, issu du droit romain décadent du Bas-Empire orientalisé. L'avénement de ce droit absolutiste ruine l'organisation sociale germanique de type communautaire. Néanmoins, au départ, l'absolutisme répond aux nécessités de la nouvelle époque; le Prince demeure encore un primus inter pares, responsable devant ses conseils. Le césaro-papisme, impulsé par l'Eglise, introduit graduellement le «despostisme asiatique», en ne responsabilisant le Prince que devant Dieu seul. Les pares se muent alors en sujets. L'arbitraire du Prince fait désormais la loi (Hobbes: auctoritas non veritas facit legem; Louis XIV: L'Etat, c'est moi!). Dans ces monarchies ouest-européennes, il n'y a plus de Reich au sens germanique, ni d'états mais un Etat. Le droit est concentré en haut et chichement dispersé en bas. Les devoirs, en revanche, pèsent lourdement sur les épaules de ceux qui végètent en bas et ne s'adressent guère à ceux qui gouvernent en haut. La révolution bourgeoise transforme les sujets en citoyens mais dépersonnalise en même temps le pouvoir de l'Etat et du souverain tout en absolutisant la structure dans laquelle sont enfermés les citoyens. Dans cette fiction règne le droit du plus puissant, c'est-à-dire, à l'âge économiste, des plus riches. L'essence de la justice se réfugie dans l'abstraction du «pur esprit», propre de l'humanisme kantien ou hégelien, une pensée sans socle ni racines. Cette idéologie est incapable de forger un droit véritablement vivant, comme le montre la faillite du système bismarckien, forgé par les baïonnettes prussiennes et la poigne du Chancelier de fer, mais rapidement submergé par l'éclectisme libéral et le marxisme, deux courants politiques se réclamant de ce droit universaliste-jusnaturaliste sans racines.
Krieck définit ensuite la Vie, vocable utilisé à profusion par toutes les écoles vitalistes, comme un «cosmos vivant», un All-Leben. Ce dynamisme de l'All-Leben, nous le trouvons également chez les Grecs d'avant Socrate et Platon. Mais les Grecs ont très tôt voulu freiner le mouvement, bloquer le dynamisme cosmique au profit d'un statisme et de formes (en autres, de formes politiques) fermées: la Polis, l'art classique, expressions du repos, de quiétisme. Les Germains n'ont pas connu ce basculement involutif du devenir à l'Etre. L'aristotélisme médiéval n'a pas oblitéré le sens germanique du devenir: le monachisme occidental et la scolastique n'ont jamais été pleinement quiétistes. Cluny et les bénédictins ont incarné un monachisme combattant donc dynamique, même si ce dynamisme a été, en fin de compte, dirigé par Rome contre la germanité. Après cette phase combattante seulement, la scolastique s'est détachée du dynamisme naturel des peuples germaniques, a provoqué une césure par rapport à la vie, césure qui a trouvé ultérieurement ses formes sécularisées dans le rationalisme et l'idéalisme, contesté par le romantisme puis par la révolution nationale-socialiste.
En proposant une «caractérologie comparée» des peuples, Krieck part d'une théorie racisante: les peuples produisent des valeurs qui sont les émanations de leur caractère biologiquement déterminé. Derrière toutes les écoles philosophiques, qu'elles soient matérialistes, idéalistes, logiques, sceptiques —orientations que l'on retrouve chez tous les peuples de la Terre— se profile toujours un caractère racialement défini. Les Allemands, tant dans leurs périodes de force (comme au Haut Moyen Age ottonien) que dans leurs périodes de faiblesse (le Reich éclaté et morcelé d'après 1648), se tournent spontanément vers le principe d'All-Leben, de cosmicité vitale, contrairement aux peuples de l'Ouest, produits d'une autre alchimie raciale, qui suivent les principes cartésiens et hobbesiens du pan-mécanicisme (All-Mechanistik). La pensée chinoise part toujours d'une reconnaissance du Tao universel et vise à y adapter la vie et ses particularités. L'ethos chinois exprime dès lors repos, durée, équilibre, régularité, déroulement uniforme de tout événement, agir et comportement. La pensée indienne résulte du mélange racial sans doute le plus complexe de la Terre. Contrairement à la Chine homogène, l'Inde exclut la réminiscence historique, la conscience historique et est, d'une certaine façon, impolitique. Autre caractéristique majeure de l'âme indienne, selon Krieck: l'ungeheure Triebhaftigkeit, la foisonnante fécondité des pulsions et la prolifération des expressions de la vie: fantaisie et spéculation, désir (Begier) et contemplation, sexualité et ascèse, systématique philosophique et méthodique psycho-technique, etc. Cette insatiabilité des pulsions fait de l'Inde le pôle opposé de la Grèce (mises à part certaines manifestations de l'hellénisme): l'âme indienne submerge toujours la forme dans l'informel, le démesuré, les figures grimaçantes et grotesques. L'hybris, faute cardinale chez les Grecs, est principe de vie en Inde: le roi n'y a jamais assez de puissance, l'ascète n'y est jamais assez ascétique, etc. Le génie grec, quant à lui, est génie de la mesure, de l'équilibre intérieur de la forme.
Le mécanicisme newtonien est l'expression du caractère anglais, surtout quand il met en exergue l'antagonisme des forces. Cet antagonisme s'exprime par ailleurs dans le bipartisme de la vie politique anglaise, dans la concurrence fairplay de la sphère économique, dans le sport. Le génie français (Descartes, Pascal, d'Alembert, H. Poincaré) procède d'une méthode analytique et géométrique. Ce géométrisme se perçoit dans l'architecture des jardins, de la poésie, de l'art dramatique du XVIIième siècle et du rationalisme politique centralisateur de la révolution de 1789.
Conclusion de Krieck: le peuple allemand est le seul peuple suffisamment homogène pour adhérer directement à la Vie sans le détour mutilant des schémas mécanicistes, du logos ou de la «philosophie de l'Etre». Adhésion à la vie qui s'accompagne toujours d'une discipline intérieure et d'un dressage.
L'idée de Reich, à rebours de toute soumission ou oppression, vise la communauté des Stämme (des tribus, des régions). Centre de l'Europe, enjeu de l'histoire européenne, le Reich offre, dit Krieck, une forme politique acceptable pour tous les Européens et pour tous les peuples extra-européens. Dans cette perspective, le monde doit être organisé et structuré d'après les communautés qui le composent, afin d'aboutir à la communauté des peuples. Tous, sur la Terre, doivent bénéficier d'espace et de droit: tel est la réponse de l'Allemagne au «moloch» qu'est l'impérialisme britannique. La mission universelle du Reich est d'assurer un droit à toutes les particularités ethniques/nationales nées de la vie et de l'histoire.
Enfin, il convient de former une élite disciplinée, qui dresse les caractères par la Zucht et la Selbstzucht (maîtrise de soi). La poésie et l'art ont un rôle particulier à jouer dans ce processus de dressage permanent, de lutte contre l'Utgard, l'Unheil.
Education nationale-politique (Nationalpolitische Erziehung), 1941
Ouvrage qui définit tout un ensemble de concepts pédagogiques et qui reprend les théories de Krieck pour les replacer dans le cadre du nouvel Etat national-socialiste. Les définitions proposées par l'auteur sont soumises à une déclaration de principe préalable: l'ère de la raison pure est désormais révolue, de même que celle de la science dépourvue de préjugés et de la neutralité axiologique (Wertfreiheit). La règle du subjectivisme absolu triomphe car la science prend conscience que des préjugés de tous ordres précèdent son action. L'acceptation de ces préjugés imbrique la science dans le réel. Son rôle n'est pas de produire quelques chose d'essentiel car le monde n'est jamais le produit des idées. La science doit au contraire se poser comme la conscience du devenir et, ainsi, pouvoir pré-voir, pressentir ses évolutions ultérieures, puis planifier en conséquence et se muer de la sorte en «technique», en force méthodique de façonnage, de mise en forme du réel. Grâce à la science/technique ainsi conçue, la pulsion (Trieb) devient acte (Tat), le grouillement de la croissance vitale (Wachsen) se transforme en volonté, l'événémentiel est dompté et permet un agir cohérent. Krieck annonce la fin de la science désincarnée; le sujet connaissant fait partie de ce monde sensoriel, historique, ethnique, racial, temporel. Il exprime de ce fait un ensemble de circonstances particulières, localisées et mouvantes. Reconnaître ces circonstances et les maîtriser sans vouloir les biffer, les figer ou les oblitérer: telle est la tâche d'une science réelle, incarnée, racisée. L'homme est à la fois sujet connaissant et objet de connaissance: il est certes le réceptacle de forces universelles, communes à toutes les variantes de l'espèce homo sapiens, mais aussi de forces particulières, raciales, ethniques, temporelles/circonstancielles qui font différence. Une différence que la science ne peut mettre entre parenthèses car ses multiples aspects modifient l'impact des forces universelles. Il y a donc autant de sciences qu'il y a de perspectives nationales (science française, allemande, anglaise, chinoise, juive, etc.). Krieck insiste sur un adage de Fichte: Was fruchtbar ist, allein ist wahr (Ce qui est fécond seul est vrai). Mais Krieck demeure conscient du danger de pan-subjectivisme que peuvent induire ses affirmations. Il pose la question: la science ne risque-t-elle pas, en perdant son autonomie et sa liberté par rapport au «désordre» des circonstances particulières, de n'être plus qu'une servante, une «prostituée» (Dirne) au service d'intérêts ou de stratégies partisanes? La réponse de Krieck tombe aussitôt, assez lapidaire: cela dépend du caractère de ceux qui instrumentalisent la science. Celle-ci a toujours été déterminée et instrumentalisée par le pouvoir. Le pouvoir indécis du libéralisme, démontre Krieck, a affaibli et la science et le peuple. Un pouvoir mené par des personnalités au caractère fort enrichit la science et le peuple.
Parmi les définitions proposées par Krieck, il y a celle de «révolution allemande», en d'autres termes, la révolution nationale-socialiste. La «révolution allemande» devra créer la «forteresse Allemagne», soit forger un Etat capable de façonner et de dresser (zuchten) les énergies du Volk, d'organiser l'espace vital de ce peuple. L'Etat doit éduquer les Allemands sur bases de leurs caractéristiques raciales et organiser la santé collective et la sécurité sociale. Cette révolution est organique et dépasse les insuffisances délétères des mécanicismes libéral et marxiste.
Krieck nous présente une définition du terme «race». La race consiste en l'ensemble transmissible par hérédité des caractéristiques déterminées des corps et des prédispositions spirituelles. Ces caractéristiques corporelles et ces prédispositions spirituelles dépassent l'individu; elles se situent au-delà de lui, dans sa famille, son clan, sa tribu, son peuple, sa race. La Zucht, le dressage, vise la rentabilisation maximale de cet héritage. L'absence de dressage conduit au mixage indifférencié et à la dégénérescence des instincts et des formes. La politique raciale, qui doit logiquement découler de cette définition, n'a pas que des facettes biologiques: elle a surtout une dimension psychique et spirituelle, greffée par l'éducation et le dressage. L'homme est néanmoins un tout indissociable qui doit être étudié sous tous ses aspects. Les interventions éducatives de l'Etat doivent progresser simultanément dans les domaines corporel, psychique et spirituel. En Allemagne, l'idéaltype racial qui doit prévaloir est le modèle nordique. La race nordique doit demeurer le pilier, l'assise de tout Etat allemand viable. La saignée de 1914-1918 a affaibli le corps de la nation allemande-nordique. Les idéologies universalistes étrangères ont eu le dessus pendant la période de Weimar, avant que le substrat racial-psychique-spirituel ne revienne à la surface par l'action des Nationaux-Socialistes. Ce mouvement politique, selon Krieck, constate la faillite du libéralisme diviseur et rassemble toutes les composantes régionales, confessionnelles, sociales du peuple allemand dans une action révolutionnaire instinctuelle et non intellectuelle.
Les diverses phases de l'éducation se déroulent dans la famille, les ligues de jeunesse et la formation professionnelle. L'ère bourgeoise a été l'ère de l'économie, affirme Krieck, et l'ère nationale (völkische) sera l'ère des métiers, de la créativité personnelle et de l'éducation professionnelle.
L'Etat doit être une instance portée par une strate sélectionnée, politisée et organisée en milice de défense, homogène et cohérente, recrutée dans tout le peuple et répartie à travers lui. C'est elle qui formera la volonté politique de la collectivité. Au XIXième siècle, cette «strate sélectionnée» était l'élite intellectuelle bourgeoise (bürgerliche Bildungselite), universitaire et savante. Mais cette bourgeoisie, en dépit de la qualité remarquable de ses productions intellectuelles, n'avait pas d'organisation qui traversait tout le corps social. Sa capillarisation dans le corps social était insuffisante: ce qui la condamnait à disparaître et à ne jamais revenir.
Krieck définit aussi ce qu'est la Weltanschauung, mot-clef des démarches organicistes de la première moitié du siècle. La Weltanschauung, pour Krieck, est la façon de voir le monde propre à un peuple et au mieux incarnée dans la strate sélectionnée. L'homme primitif élaborait une Weltbild, une image du monde magique-mythique. L'homme de la civilisation rationaliste est désorienté, sans image-guide, ne perçoit plus aucun sens. Sa pensée est dissociée de la vie. L'homme qui a dépassé la phase rationaliste/bourgeoise maîtrise et la vie et la technique, a le sens de la totalité/holicité (Ganzheit) de la vie, allie le magique et le rationnel, le naturel et l'historique. Trois types d'hommes se côtoient: ceux qui sont animés par la foi et ses certitudes, ceux qui imaginent tout résoudre par la raison et ses schémas et, enfin, ceux qui veulent plonger entièrement dans le réel et acceptent joyeusement les aléas du destin et du tragique qu'il suscite. Ces derniers sont les héros, porteurs de la révolution que Krieck appelle de ses vœux.
Dans la dernière partie de son ouvrage, l'auteur récapitule ses théories sur l'éducation et les replace dans le contexte national-socialiste.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: pour un recencement complet des écrits de Krieck, cf. Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989 (3ième éd.). Nous recensons ci-dessous les principaux livres de l'auteur: Persönlichkeit und Kultur. Kritische Grundlegung der Kulturphilosophie, Heidelberg, 1910; Lessing und die Erziehung des Menschengeschlechtes, Heidelberg, 1913; Philosophie der Erziehung, Iéna, 1922; Menschenformung. Grundzüge der vergleichenden Erziehungswissenschaft, Leipzig, 1925; Bildungssysteme der Kulturvölker, Leipzig, 1927; Deutsche Kulturpolitik?, Francfort s.M., 1928 (2ième éd., Leipzig, 1936); Staat und Kultur, Francfort s.M., 1929; Nationalpolitische Erziehung, Leipzig, 1932; Völkisch-politische Anthropologie (3 vol., 1936, 1937, 1938; vol. I, Die Wirklichkeit; vol. II, Das Handeln und die Ordnungen; vol. III, Das Erkennen und die Wissenschaft); Leben als Prinzip der Weltanschauung und Problem der Wissenschaft, Leipzig, 1938; Mythologie des bürgerlichen Zeitalters, Leipzig, 1939; Volkscharakter und Sendungsbewußtsein. Politische Ethik des Reichs, Leipzig, 1940; Der Mensch in der Geschichte. Geschichtsdeutung aus Zeit und Schicksal, Leipzig, 1940; Natur und Wissenschaft, Leipzig, 1942; Heil und Kraft. Ein Buch germanischer Weltweisheit, Leipzig, 1943.
- Sur Krieck: W. Kunz, Ernst Krieck. Leben und Werk, 1942; Georg Lukacs, Die Zerstörung der Vernunft, 1962 (l'éd. originale hongroise est parue en 1954); E. Thomale, Bibliographie v. Ernst Krieck. Schriftum, Sekundärliteratur, Kurzbiographie, 1970; K. Ch. Lingelbach, Erziehung und Erziehungstheorien in national-sozialistischen Deutschland, 1970; Gerhard Müller, Ernst Krieck und die nationalsozialistische Wissenschaftsreform, 1978; Jürgen Schriewer, «Ernst Krieck», in Neue Deutsche Biographie, 13. Band, Duncker & Humblot, 1982; Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, 1987, pp. 312-318; Léon Poliakov & Josef Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker, 1989 (2ième éd.).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, pédagogie, national-socialisme, années 20, années 30, allemagne, vitalisme, panvitalisme, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 octobre 2009
Otto Koellreutter (1883-1972)
KOELLREUTTER, Otto 1883-1972
Ce professeur de droit public nait à Fribourg en Brisgau le 26 novembre 1883. Etudiant en droit, il rédige une thèse sur la figure du juge anglais puis poursuit ses investigations après la première guerre mondiale, où il est appelé sous les drapeaux, en se spécialisant dans le droit administratif anglais. Enseignant à Halle et à Iéna, il formule un antiparlementarisme couplé à la recherche d'une forme d'«Etat populaire» (Volksstaat) reposant sur des principes radicalement autres que ceux du positivisme juridique. Il reçoit à cette époque l'influence des idées d'Oswald Spengler. De 1927 à 1944, il est le co-éditeur de la célèbre revue Archiv des öffentlichen Rechts. Militant national-socialiste depuis les élections du 14 septembre 1930, il espère que le nouveau régime transposera dans le réel ses théories de l'«Etat populaire». D'essence bourgeoise et d'inspiration anglo-saxonne, les idées de Koellreutter peuvent être qualifiées de conservatrices. En fait, elles relèvent d'un conservatisme particulier qui croit percevoir une alternative viable au libéralisme dans le mouvement hitlérien. De 1933 à 1942, Koellreutter édite la revue Verwaltungsarchiv (= Archives d'administration). Au fil du temps, ses espoirs sont déçus: le régime déconstruit l'Etat de droit sans rien construire de solide à la place. Il visite le Japon, en étudie le droit, et se transforme, à partir de 1938/39 en adversaire du régime dont il s'était fait le propagandiste zélé entre 1930 et 1936, en écrivant à son intention une longue série de brochures didactiques et précises. Ces nombreux écrits recèlent tous de pertinentes polémiques à l'encontre des thèses de Carl Schmitt, notamment de celle qui fait de la distinction ami/ennemi le fondement du politique. En 1942, la rupture est consommée: dans un article de la revue Verwaltungsarchiv, il compare le droit et la figure du juge tels qu'ils sont perçus en Allemagne et en Angleterre, démontrant que ce dernier pays respecte davantage les principes du vieux droit germanique. Koellreutter quitte l'université en 1952, rédige pendant sa longue retraite trois sommes sur le droit constitutionnel et administratif. Il meurt le 23 février 1972 dans sa ville natale.
Peuple et Etat dans la vision-du-monde du national-socialisme (Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus), 1935
Brochure didactique destinée à dévoiler aux juristes allemands les nouveaux principes qui allaient dorénavant gouverner l'Allemagne. Elle est intéressante car elle résume toute la polémique entre l'auteur et Carl Schmitt. Koellreutter commence par expliquer en quoi sa position n'est nullement «objective», au sens conventionnel du terme. L'objectivité, telle que la conçoivent les libéraux, est a-politique; elle ne recèle aucune énergie politique. Les concepts politiques doivent être en rapport avec le réel et avec une substance politique concrète, en l'occurrence le peuple. L'idée d'Etat chez Carl Schmitt est purement constructive; les ressortissants de l'Etat ont le devoir moral de le construire mais Carl Schmitt ne précise pas quelle doit être l'essence de cet Etat que postule l'éthique. La distinction fondamentale opérée par Carl Schmitt entre l'ami et l'ennemi conduit à percevoir le travail politique comme un conflit perpétuel, où l'homme se transforme en «carnassier». Schmitt inverserait ainsi Rousseau, en transformant son idyllisme pastoraliste en idyllisme du carnassier. En ce sens, seule la guerre est politique, ce que conteste Koellreutter qui, comme Clausewitz, ne voit en elle qu'un moyen. Chez Schmitt, cette apologie implicite de la guerre participe du propre même des idéologies niant la primauté du Volk. Elle exprime bien l'essence du Machtstaat libéral ou de l'impérialisme. La pensée völkische du national-socialisme, elle, part du principe de la communauté, de la définition de l'ami, du camarade. Elle insiste sur ce qui unit les hommes et non sur ce qui les sépare. Dans une telle optique, la guerre n'a rien d'essentiel et la paix entre les nations est une valeur cardinale.
Dans Staat, Bewegung und Volk, le petit livre où Carl Schmitt tente de parfaire son aggiornamento national-socialiste, l'Etat est l'instance statique et conservante, porté par le fonctionnariat et l'armée; le mouvement est l'instance dynamique, qui recueille, trie et affecte les énergies émanant du peuple; quant à ce dernier, s'il n'adhère pas au mouvement, il n'est qu'une masse inerte a-politique. Pour Koellreutter, cette définition du peuple comme masse inerte a-politique relève d'une «doctrine du pouvoir étrangère aux lois du sang», dérivée de Hegel et de la pensée politique latine sans ancrage ethnique précis. Elle est fasciste, dans le sens où Guido Bartolotto, dans Die Revolution der jungen Völker , a défini l'idéologie italienne née sous l'impulsion de Mussolini: le national-socialisme repose sur la substance ethnique; le fascisme sur la culture, la tradition et l'éthique, toutes instances sans incarnation —au sens littéral du mot— précise. Toute pensée germanique, à la différence des pensées politiques romanes, s'ancre dans une substance populaire, ce qui interdit de penser le peuple comme une masse amorphe a-politique. Ce sont au contraire l'Etat et le mouvement qui puisent leurs énergies dans le peuple. Pour Koellreutter, l'Etat n'a pas de valeur en soi; il n'est qu'un moyen parmi d'autres moyens pour faire rayonner les énergies émanant du peuple. Cette idée de rayonnement génère la paix dans le monde, car le régime qui œuvre au rayonnement du peuple dont il est l'émanation politique respecte ipso facto les institutions qui permettent le rayonnement d'un peuple voisin.
Le droit constitutionnel allemand. Une vue d'ensemble (Deutsches Verfassungsrecht. Ein Grundriß), 1936
Ouvrage abordant l'ensemble des questions fondamentales de la politologie, Deutsches Verfassungsrecht commence par définir le politique comme l'expression d'une attitude spirituelle et d'un type humain particulier. Cette attitude et ce type humain varient selon les époques: c'est le bourgeois à l'heure où le libéralisme entre en scène; c'est le soldat politique après que les valeurs du libéralisme se soient écroulées dans les tranchées du front. D'emblée, Koellreutter formule sa critique majeure à l'endroit des thèses de Carl Schmitt. Celui-ci a déduit sa notion du politique à partir de la distinction ami-ennemi. La faiblesse de cette définition réside en ceci: l'ami n'est plus que le non-ennemi. D'où, estime Koellreutter, Schmitt évacue la dimension communautaire et pose un type d'homme politique purement formel qui risque, ambiance darwinienne aidant, par se transformer en «carnassier politique». C'est ce qui explique pourquoi Carl Schmitt affirme que seule la guerre relève du politique à l'état pur. Koellreutter refuse cette affirmation schmittienne car elle implique que l'essence de la politique extérieure ne réside que dans le conflit entre les peuples. Pour Carl Schmitt, seule la politique extérieure est essentiellement politique. Il y a chez Schmitt, constate et conteste Koellreutter, un primat de la politique extérieure.
A rebours de Schmitt, la conception völkische, ethniste et populiste, voit l'essence du politique dans l'orientation communautaire. Cette conception désigne plutôt l'ami, le Volksgenosse, le camarade. Elle est issue de la camaraderie des tranchées. Elle est l'expression typique du soldat politique qui participe et se donne à une communauté. Pour les nationaux-socialistes, il n'y a pas de primat de la politique extérieure; il n'y a en fait aucun primat qui soit. A l'intérieur, le national-socialisme veut forger la «communauté populaire» (la Volksgemeinschaft), c'est-à-dire une communauté de soldats politiques, qui englobe toute la réalité politique. A l'extérieur, Koellreutter veut qu'il y ait reconnaissance mutuelle entre les peuples et non conflit ou inimitié. L'accent n'est donc pas mis sur l'ennemi mais sur la solidarité. Le national-socialisme, du moins de la façon dont le conçoit Koellreutter, doit reconnaître la valeur des ethnicités étrangères. La guerre n'est pas un idéal social mais un moyen extrême pour conserver la plus haute valeur d'une communauté populaire: son honneur.
Avant l'avènement du national-socialisme, deux courants d'idées dominaient en Occident et dans le monde: le libéralisme anglais et la démocratie formelle française. Ces deux courants étaient déterminants pour l'ensemble des systèmes politiques. En Allemagne, pourtant, l'un et l'autre étaient incompatibles avec les racines du droit allemand. Koellreutter procède à une définition du libéralisme politique. Il correspond à la nature du peuple anglais et à la géographie insulaire. L'insularité met à l'abri d'attaques venues de l'étranger, ce qui donne un sentiment de liberté. Mais le libéralisme radical, comme par exemple celui que veut promouvoir un Hans Kelsen, dès qu'il est exporté en Allemagne, provoque la dissolution et la dégénérescence car il ne peut s'appliquer à un peuple qui est perpétuellement sur la défensive, le long de frontières ouvertes, menacées par plusieurs puissances ennemies. L'Allemagne a besoin de cohésion et de solidarité, vertus diamétralement opposées à la liberté au sens anglo-saxon.
La définition que nous donne Koellreutter de la démocratie formelle repose sur l'idée du contrat social de Rousseau, où l'on repère une exigence d'égalité formelle, laquelle doit, pour pouvoir s'appliquer, limiter la liberté personnelle. Les individus soumis à la démocratie formelle sont pensés dans l'abstrait et sont par principe porteurs de droits politiques égaux. Dans un tel contexte, c'est la majorité arithmétique qui règne, domine et, en certaines circonstances, écrase ses adversaires. Cette majorité arithmétique veut absolument faire l'identité entre dominants et dominés, les homogénéiser. C'est cette majorité circonstancielle qui détermine le contenu de la liberté et de l'égalité. De cet état de choses découle un relativisme que Koellreutter juge pernicieux car à chaque élection, ce contenu est susceptible de changer. Il n'y a plus de valeurs politiques absolues et permanentes, ancrées dans les tréfonds de l'âme populaire. Les seules valeurs qui subsistent sont celles, aléatoires, que crée l'individu au gré des circonstances. Ce qui interdit toute symbiose entre les individus et l'Etat, lequel déchoit en simple appareil, en «veilleur de nuit». Dans une démocratie formelle, les portes sont ouvertes au libéralisme, surtout dans le domaine de l'économie.
Le marxisme est fruit du libéralisme car sa position de base ne retient aucune forme d'ethnicité. Quant à l'Etat-appareil de la démocratie formelle, il se mue, après une révolution de type marxiste, en un Etat de classe. En effet, la seule réalité politique pour le marxisme, c'est la lutte des classes. Peuple et Etat ne relèvent que de la superstructure idéologique, ne sont finalement que du «vent». Pour les marxistes comme pour Carl Schmitt, c'est l'antagonisme qui prime. Les thèses des uns comme de l'autre ne retiennent aucun volet constructif impliquant qu'il faille forger la Volksgemeinschaft. Cette lacune explique pourquoi la démocratie libérale ne peut dépasser le marxisme. L'ère de Weimar a prouvé que la seule possibilité pour sauver le libéralisme et la démocratie formelle, c'est de s'allier aux marxistes. Mais ce compromis est fragile: le marxisme étant conséquent à l'extrême, comme l'a démontré le bolchévisme russe, il élimine en bout de course la démocratie bourgeoise. Ou bien, autre possibilité, il veut raviver les liens qui unissent l'individu à son peuple et à l'Etat comme en Italie et se mue alors en fascisme ou, dans le cas allemand, en national-socialisme.
Au vu de ces évolutions, Koellreutter conclut que seule la révolution nationale-socialiste est une vraie révolution car elle transforme de fond en comble les assises de l'Etat et crée le Führerstaat. Le peuple n'est plus alors une somme arithmétique de citoyens mais une unité vivante. La notion de race, l'accent mis sur le sol et la patrie charnelle, l'insistance sur le principe de totalité (Ganzheit) assurent la continuité du processus politique, reflet de la vie du peuple à travers les siècles. L'Etat n'a pas de valeur en soi. Il sert à donner forme, mais reste extérieur à la substance. Si la substance finit par se retrouver à l'étroit dans la forme étatique qui l'enserre, elle s'en débarrasse par une révolution et en crée une nouvelle. Pour Otto Koellreutter, l'idée d'Etat, comme «réalité de l'idée éthique» (Hegel), est un instrument précieux mais il faut se garder de l'idolâtrer.
Le droit que préconise Koellreutter est d'inspiration «communautaire». Ce droit, expression des idées innées du peuple, doit refléter ce qui apparaît juste pour la protection, la promotion et le développement du peuple. Le droit et l'Etat doivent être des fonctions multiplicatrices des forces vitales du peuple. Un tel Etat est de droit puisqu'il évacue les barrières qui s'opposent à ou freinent l'épanouissement des potentialités du peuple. Le droit qu'il défend et ancre dans la réalité est davantage légitimité que légalité, contrairement au libéralisme.
L'objet de toute constitution est de faire l'unité du peuple. La conception libérale de la constitution veut que l'Etat libéral soit un Etat constitutionnel capable de réaliser les idées de liberté et d'égalité. Elle laisse une large place aux droits fondamentaux de l'individu dans la pensée constitutionnaliste. Ensuite, le libéralisme veut écrire le droit donc le figer. Un droit écrit est très difficile à modifier car le juriste doit alors inventer des techniques juridiques excessivement complexes qui ralentissent les processus de transformation nécessaires de la société. A ce droit constitutionnel individualiste/libertaire et égalitaire, techniquement complexe, doit se substituer une pensée constitutionnaliste nationale-socialiste, écrit Koellreutter, inspirée du modèle anglais qui se passe de constitution, car, à l'époque de Cromwell (celle du Führerstaat anglais dans sa forme la plus pure), l'Angleterre ne connaissait pas les exagérations de l'individualisme. La constitution anglaise est en fait implicite et non écrite. Elle croît organiquement. Ont valeur de constitution des lois comme le Bill of Rights de 1689 qui assure les libertés individuelles ou le Parliament Act de 1911 qui diminue considérablement le rôle de la Chambre des Lords dans l'élaboration des lois. Ce mode de fonctionnement organique est d'essence germanique, conclut Koellreutter. Aussi, en Allemagne, il importe d'introduire une constitution vivante qui puisse répondre immédiatement aux impératifs de l'heure. Le national-socialisme a déjà procédé de la sorte, constate Koellreutter, en citant la loi de prise du pouvoir du 24 mars 1933 —la fameuse Ermächtigungsgesetz— la loi du plébiscite du 14 juillet 1933, la loi sur l'unité du parti et de l'Etat du 1er décembre 1933, les lois raciales de Nuremberg sur la «protection du sang et de l'honneur allemands» (15 septembre 1935). De telles lois peuvent être modifiées sans grandes complications d'ordre technique. L'objet ne doit donc pas être de construire un système écrit de normes mais de façonner politiquement et juridiquement le corps du peuple par une direction (Führung) liée à ce même peuple.
La science juridique libérale est positiviste, ce qui la fait basculer dans la technicité et la dogmatique juridiques. Le droit étatique déchoit en annexe du droit privé et lui est subordonné (cf. Paul Laband et Otto Mayer). Otto von Gierke a été pionnier, estime Koellreutter, en explorant le droit communautaire et le Genossenschaftsrecht allemands (le droit des compagnonnages). De cette exploration, il est permis de conclure que la veine communautaire constitue l'essentiel du droit allemand. Il s'avère donc nécessaire de hisser ces principes communautaires aux niveaux du peuple, de l'Etat et du droit. Ce sens inné du droit a rendu impopulaire la démocratie formelle et le positivisme juridique de Weimar, d'autant plus que la «camaraderie des tranchées» avait évacué les réflexes individualistes bourgeois. Koellreutter constate dès lors un rejet du constructivisme juridique pur, de la théorie pure du droit et de l'Etat (Hans Kelsen). Droit et Etat ne sont plus que des constructions abstraites. D'où le but des nouvelles sciences juridiques est désormais de forger un droit porté par les chefs naturels qui se sont imposés par leurs qualités personnelles dans les tranchées.
Le modèle du futur droit allemand est anglais. Car le droit anglais rejette les dogmes et les spéculations tout en allant droit au vécu. Il suscite une pensée juridique qui fusionne droit et politique. Le contenu, la substance politique, prime la forme juridique. Aux formes figées du droit, il faut donner un sens politique, sans pour autant les abolir. Il suffit de reprendre ce qui est utile. S'il y avait harmonie totale au sein de la communauté populaire, il n'y aurait pas besoin de droit ni d'Etat. Mais, tonne Koellreutter, il y a les indisciplinés et les «tire-au-flanc» (Drückeberger). Donc croire à une harmonie totale relève d'une pensée anti-politique (impolitique). L'esprit communautaire naît par l'action de fortes personnalités.
En présentant à ses lecteurs la pensée juridique völkische, Koellreutter formule une seconde critique à l'encontre de Carl Schmitt. Notamment contre sa distinction entre les Ordnungsdenken (les pensées de l'ordre) normatif, décisionniste et concret. La pensée juridique völkische refuse les distinctions trop discriminantes et, par conséquent, trop abstraites. Elle entend s'orienter par rapport à la réalité politique. Elle refuse la spéculation pour privilégier la mise en forme. La concrétude se manifeste toujours par le sens particulier, typé, de la concrétude que génère un peuple donné. Norme et décision jouent un rôle important car la norme met le sens de la concrétude en forme et la décision tranche dans le sens de l'épanouissement de la communauté populaire.
Koellreutter aborde également les fondements historiques du droit constitutionnel allemand depuis l'époque médiévale jusqu'au XIXième siècle, en abordant successivement l'essence du Reich, des pouvoirs territoriaux allemands (Prusse et Autriche), de la Confédération Germanique, le défi de l'unification économique graduelle, l'évolution du droit constitutionnel prussien (l'impact de la pensée du Baron von Stein), l'évolution du droit constitutionnel des Etats de l'Allemagne méridionale, la signification de l'Assemblée nationale de Francfort en 1848 (première représentation d'un mouvement populaire, issu des corporations étudiantes —les célèbres Burschenschaften— et des combattants de la guerre de libération de 1813). Cette histoire révèle une opposition constante entre la légitimité et la légalité. Opposition patente dans le cas du Parlement de Francfort qui sous-estimait le poids des constitutions prussienne et autrichienne, impossibles à évacuer sans combat donc sans guerre civile. Les juristes allemands ont tenté de combler le hiatus entre la légalité et la légitimité dans la nouvelle constitution du Reich de 1849 en introduisant un système bicaméral et en pensant juridiquement la Confédération nord-allemande (Norddeutscher Bund). Le Reich de Bismarck, porté par l'armée populaire victorieuse en 1871, était un Etat fédéral (Bundesstaat), où les Etats allemands gardaient leur souveraineté et le Bundesrat (le Conseil fédéral) regroupait les souverains de ces Etats membres de la confédération. Le Bundesrat était présidé par le roi de Prusse qui acquérait ainsi la dignité d'Empereur. Koellreutter explique que ce fédéralisme était perçu comme provisoire, ce que prouve également la querelle entre l'école du Bavarois von Seydel, pour qui les Etats du Reich demeurent pleinement souverains, et l'école de Laband, pour qui ces Etats ont transféré définitivement leur souveraineté à l'instance englobante qu'est le Reich. Koellreutter estime que le Bundesstaat bismarckien ne tenait que grâce à la personnalité charismatique du Chancelier de Fer. Ce dernier, pourtant, par manque de temps, n'a pas réussi à éduquer une caste de dirigeants nouveaux; son départ a provoqué le cafouillage du wilhelminisme, puis les querelles de prestige sur la scène internationale qui ont abouti aux carnages de 1914.
Koellreutter procède ensuite à une analyse de la constitution de Weimar. La République d'après 1918 est également un faux Etat fédéral. Son principal défaut est de n'avoir qu'une seule Volkskammer (Chambre du Peuple) et de refuser toute forme de Sénat comme contraire au principe d'égalité. Ensuite le système de Weimar laisse la bride sur le cou des partis. L'Etat partitocratique ne fonctionne que s'il y a unité de vue entre tous les partis sur les choses essentielles du politique. En Allemagne, cette unanimité était inexistante. Les partis se sont affrontés sans vouloir faire le moindre compromis parce qu'ils représentaient des Weltanschauungen trop différentes, sur les plans de l'économie, de la religion et de la culture. Les querelles ont provoqué la multiplication des partis donc l'ingouvernabilité du pays. Le système de Weimar est un liberaler Machtstaat qui ne défend que les intérêts d'une bourgeoisie numériquement infime, donc dépourvue d'assises tangibles dans la population. En fait, cette république et une dictature camouflée, explique Koellreutter, avec son Président comme «gardien de la Constitution». Elle maintient telle quelle une Constitution qui ne répond plus aux besoins de survie de la nation.
Koellreutter définit ensuite les notions de peuple (Volk) et de nation. La notion de Volk que propose Koellreutter s'oppose diamétralement à celle que suggère Carl Schmitt. Pour Koellreutter, le Volk n'est pas la masse non politisée de la nation: une telle définition serait le propre du libéralisme musclé ou du fascisme. Le Volk, bien au contraire, est source du droit et du pouvoir. Koellreutter insiste alors sur la spécificité raciale/biologique et entend dépasser la définition spenglérienne du Volk comme communauté d'histoire et de destin. Il reconnaît cependant que le peuple allemand est le résultat d'un mixage complexe qui doit être préservé comme telle en tant qu'Artgleicheit (égalité/homogénéité de l'espèce, de la race). Cette volonté de préservation s'exprime dans les lois de protection de la race et des terroirs.
Quant au concept de nation, c'est un concept français révolutionnaire ou italo-fasciste. Pour les idéologies françaises et italiennes, la nation est le produit d'un pouvoir; elle est créée par l'Etat. Koellreutter rejette ces définitions: pour lui, et pour la conception völkische qu'il entend défendre et illustrer, Volk et nation ne sont pas des notions essentiellement différentes. La nation est pour lui la volonté d'une communauté populaire de se positionner sur la scène internationale.
L'auteur aborde ensuite les fondements de la Führung. Le caractère populaire (völkisch) de la Führung permet de distinguer la «totalité de l'idée völkische» de l'«Etat total» d'inspiration mussolinienne ou latine. La différence est nette pour Koellreutter; il s'agit de deux totalités très différentes. L'idée völkische est une totalité naturelle; l'idée d'Etat total exprime la revendication de l'appareil du pouvoir dans son ensemble pour conserver sa position non völkische. L'autorité, pour Koellreutter et la tradition völkische, doit s'enraciner dans une éthique communautaire qui unit le peuple et la Führung et s'exprime dans une forme politique, un Etat. Les vrais chefs fusionnent en eux, dans leur personnalité, le Volksgeist et le Volkswille (la volonté populaire). Derrière de tels figures charismatiques, il convient de rassembler une Gefolgschaft (une suite), unissant de plus en plus de citoyens. L'histoire a révélé plusieurs types de chefs politiques. La Führung de l'Etat princier absolu (absoluter Fürstenstaat) est l'aristocratie. L'Etat libéral-démocratique porte au pouvoir les politiciens bourgeois. En Angleterre, l'aristocratie est une aristocratie «ouverte», incorporant des bourgeois méritants pour former la caste dirigeante baptisée society. L'Etat national-socialiste trouve ses racines dans l'esprit des combattants de la Grande Guerre et des militants politiques de la «longue marche» de la NSDAP vers le pouvoir.
La Führung politique nationale-socialiste se donne trois instruments de gouvernement: 1) le Parti (ou le Mouvement), instrument politique direct de la Führung; 2) le fonctionnariat professionnel, recruté dans toutes les strates du peuple est l'instrument traditionnel au service de toute Führung; 3) l'armée, la Wehrmacht, instrument militaire. Ces trois instruments s'enracinent dans l'ensemble du peuple. Les citoyens qui les servent doivent être éduqués dans l'esprit de l'Etat nouveau. Le parti dirige toutes les forces du peuple contre l'ancien appareil. Dès qu'il arrive au pouvoir, sa mission change. Il commande alors l'Etat et éduque le peuple. Koellreutter refuse la séparation des pouvoirs, car le législatif et l'exécutif sont deux modalités de la Führung qui doit rester unitaire. Pour assurer une représentation et donner forme à la pluralité du peuple, la Führung organise corporativement la nation.
L'ouvrage se termine par une théorie de l'organisation économique, religieuse et culturelle du nouvel Etat, accompagnée de projets d'organisation corporative. A la liberté d'opinion libérale doit succéder une régulation de la vie culturelle. Le nouvel Etat doit garantir la liberté de la recherche scientifique.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: Richter und Master, 1908 (dissertation); Verwaltung und Verwaltungsrechtsprechung im modernen England, 1920; Die Staatslehre Oswald Spenglers, 1924; Die politischen Parteien im modernen Staate, 1926; Staat, Kirche und Schule im heutigen Deutschland, 1926; Der deutsche Staat als Bundesstaat und als Parteienstaat, 1927; Integrationslehre und Reichsreform, 1929; Der Sinn der Reichtagswahlen vom 14. Sept. 1930 und die Aufgabe der deutschen Staatslehre, 1930; Der nationale Rechtsstaat. Zum Wandel der deutschen Staatsidee, 1932; Volk und Staat in der Verfassungskrise, 1933; Grundriß der allgemeinen Staatslehre, 1933; Vom Sinn und Wesen der nationalen Revolution, 1933; Der deutsche Führerstaat, 1934; Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus, 1935; Deutsches Verfassungsrecht. Ein Grundriß, 1935 (2ième éd., 1938); Grundfragen unserer Volks- und Staatsgestaltung, 1936; Deutsches Verfassungsrecht, 1936 (2ième éd., 1938); Der heutige Staatsaufbau Japans, 1941; «Recht und Richter in England und Deutschland», in Verwaltungsarchiv, 47, 1942; Deutsches Staatsrecht, 1953; Staatslehre im Umriß, 1955; Grundfragen des Verwaltungsrechts, 1955.
- Sur Otto Koellreutter: C.H. Ule, in Verwaltungsarchiv, 63, 1972; Jürgen Meinck, Weimarer Staatslehre und Nationalsozialismus. Eine Studie zum Problem der Kontinuität im staatsrechtlichen Denken in Deutschland 1928 bis 1936, Frankfurt a.M., Campus, 1978; Michael Stolleis, «Otto Keullreutter», in Neue Deutsche Biographie, 12. Band, Duncker und Humblot, 1980; Joseph W. Bendersky, Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton University Press, 1983.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, théorie politique, révolution conservatrice, allemagne, années 20, années 30, national-socialisme, droit, constitution, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 octobre 2009
G. Gentile: un filosofo en el combate
|
por Primo Siena ( http://www.arbil.org ) Asesinado en abril de 1944, en el clima de odio que envenenaba entonces a una Italia percutida por una trágica guerra civil, Giovanni Gentile, filosofo del "idealismo actual", ha recobrado un insospechado interés intelectual después de haber padecido de un largo olvido motivado por sectarias exclusiones. | |
| Una muerte anunciada En el verano bochornoso del 1943, Giovanni Gentile - encerrado en el pueblo campesino de Troghi, en los alrededores de Florencia, escribe en pocos meses Génesis y estructura de la sociedad, obra que lleva como subtítulo Ensayo de filosofía y que termina con un XIII° capítulo titulado La Sociedad trascendental, la muerte y la inmortalidad.Se trata de una conclusión impresionante, después de profundas reflexiones desarrolladas en los capítulos anteriores sobre el Estado, la Historia y la Política. En el último párrafo, hablando de la muerte el filósofo escribe: "La muerte es un hecho social. Quien muere, muere con respeto a alguien. Una absoluta soledad - que es algo imposible - non conoce la muerte, porque no realiza aquella sociedad de la que la muerte representa la disolución". Terminado el libro, Gentile regresa a Florencia en los primeros días de setiembre; y mostrando el manuscrito a un amigo antifascista (Mario Manlio Rossi, también filósofo) exclama: "Vuestros amigos ahora pueden matarme. Mi tarea en esta vida ha terminado". Palabras que suenan como un siniestro presagio de una muerte presentida y anunciada, que se cumplirá trágicamente pocos meses después. Un clima político sombrío, cargado de dramática incertidumbre, abrumaba la Italia de entonces, involucrada desde el año 1940 en la segunda guerra mundial. Mussolini, relevado del poder por un golpe palaciego autorizado por el rey Victor Emmanuel III° el 26 de julio, había sido reemplazado por el mariscal Pietro Badoglio, quien estaba solicitando un armisticio a los angloamericanos, anunciado públicamente el 8 de setiembre de 1943. Aquel armisticio, pedido sin previo aviso a la aliada Alemania - y definido sucesivamente por el propio general H.D.Eisenhower "un negocio sucio" - causó la partición de Italia en dos bandos: uno monárquico, encabezado por Badoglio con una coalición de seis partidos antifascistas en el sur de Italia bajo dominación militar angloamericana; el otro de signo republicano-fascista, denominado República Social Italiana (RSI) y liderado por Mussolini recién rescatado de prisión, bajo el alero militar alemán, en el resto de Italia. Todos estos acaecimientos impactan profundamente a Giovanni Gentile. Especialmente el armisticio, que él consideró más bien una rendición incondicional como era en verdad, lo inducía a preguntarse: "¿Por cual Italia podemos vivir, pensar, enseñar, escribir? ¡Cuando la patria desaparece, nos falta el aire, el aliento!" Después de un encuentro con Mussolini - en noviembre de 1943 - Giovanni Gentile asume la presidencia de la Academia de Italia en representación del gobierno de la RSI, mientras el territorio italiano es campo de batallas entre ejércitos extranjeros. En una carta a la hija Teresita, motiva su grave decisión escribiendo: "Hay que marchar como dicta la conciencia. Esto es lo que he predicado toda mi vida. No puedo desmentirme ahora, cuando estoy para terminar mi camino; rehusarse habría sido suprema cobardía y demolición de toda una vida". Coherente con esta postura, el 19 de marzo de 1944 - impulsado por el mismo sentimiento de piedad patriótica que lo había llevado a pronunciar un fuerte discurso en el Campidoglio de Roma el 24 de junio de 1943 - Gentile habla nuevamente a la nación italiana para celebrar el bicentenario del filósofo Juan Bautista Vico. Dejando de lado todo sofisma prudencial, él denuncia una vez más el peligro de una disolución espiritual que acabaría con pulverizar la unidad moral del pueblo logrando así un desastre social mucho más grave que las destrucciones materiales producidas por la guerra total que azota a la Italia entera. Concluye su magistral oración sobre el pensamiento de Vico con palabras que encierran un trágico sabor profético: "¡Oh, para esta Italia nosotros, ya ancianos hemos vivido…Por ella, si fuera necesario, queremos morir porque sin ella no sabríamos sobrevivir entre los escombros de su miserable naufragio!". Veintiséis días después (el 15 de abril), un grupo comunista de guerrilla urbana ultimaba a tiros el senador Giovanni Gentile al interior de su auto, frente a Villa Montaldo, su morada en las afueras de Florencia. Hora antes de caer asesinado, Gentile había abogado por la vida de algunos jóvenes antifascistas detenidos por los responsables de la seguridad interior del Estado. Recibiendo su "hermana muerte" en el remolino de la guerra civil, no en la quietud del hogar rodeado de afectos familiares, el filósofo del idealismo actual sellaba socráticamente su milicia cultural sustentada por la identificación entre el pensar y el obrar, el pensamiento y la acción como el modo más coherente de practicar la identidad entre filosofía y vida. Años después, el filósofo católico italiano Gustavo Bontadini, reflexionando sobre la trayectoria filosófica y existencial de Gentile, en el marco de actuación de sus últimas horas de vida, reconocerá en su muerte el cumplimiento perfecto del compromiso cultural y político de un filósofo quien había hecho de su vida una reductio artium ad tehologiam. La filosofía del "Idealismo actualista" La investigación filosófica de Giovanni Gentile reactualiza el idealismo de Hegel pero reformándolo según el siguiente principio básico: nada es ajeno al pensamiento. No existe una dialéctica de lo pensado, sino de lo pensante; por lo tanto es una grave equivocación hacer distinciones entre pensamiento práctico y pensamiento teorético, siendo el pensamiento la actividad creadora por excelencia, actividad que coincide con el acto de pensar en cuanto acto del espíritu. El autor de este acto del pensamiento es el sujeto siempre idéntico a sí mismo, mientras que el objeto existe sólo en tanto que es pensado: momento dialéctico necesario por el cual la multiciplicidad del pensamiento pensado se resuelve en la simultánea unidad del pensamiento pensante por medio del acto creador del Espíritu. De aquí arranca la filosofía del actualismo gentiliano que es también un espiritualismo. Gentile concibe el espíritu no como ser sino como actividad en la cual es inmanente toda realidad; por lo tanto nada existe que no pertenezca a la actividad del Espíritu como acto del puro pensar en su permanente y simultánea actividad. Este acto puro nunca es hecho porque siempre es acto que supera las barreras del tiempo y del espacio, creaciones del mismo Espíritu que no es estático sino dinámico en su permanente actuar. Dios, la naturaleza, el bien y el mal, el error y la verdad, el pasado y el futuro no subsisten fuera del acto de pensar en el que se identifican. Para Gentile entonces ser significa conocer y conocer es identificar. El Espíritu Absoluto, acto puro creador, se hace a sí mismo (autoctisi) en el proceso continuo del "acto de pensar en su actualidad", concepto expresado en italiano sintéticamente como "pensiero pensante"; y coincide con el proceso autocreativo del Yo Absoluto que se pone a sí mismo come objeto del pensamiento:"categoría única, lógica, y metafísica" a la vez; lo que no es un espejo de la realidad, son más bien el principio vivo, siempre actual del cual brota toda realidad. La experiencia de los cuerpos - escribió Giovanni Gentile en el Sumario de Pedagogía como ciencia filosófica (1913-14) - no es más que una modalidad de la experiencia del pensamiento. Algunos objetos del pensamientos son cuerpos, otros son ideas, otros más son números, pero todos pertenecen al acto del pensar, son ellos mismos pensamientos". En la filosofía gentiliana, los seres individuales caben como realizaciones empíricas y transitorias del Espíritu Absoluto donde el pasado siempre revive como presente y la historia misma, coincidiendo con el acto del puro pensar se identifica con la filosofía. La filosofía es, por lo tanto, la más alta y completa manifestación del Espíritu: auto síntesis cumbre del pensamiento que en Gentile como en Hegel es un proceso dialéctico de tres momentos, pero en la especulación filosófica gentiliana este proceso se realiza al interior del Espíritu mismo y no en la Idea que precede al Espíritu, como acaecía en Hegel. Se trata, según Gentile, de tres momentos de una única categoría y que constituyen un único proceso espiritual. El momento estético del Arte (tesis) es la expresión subjetiva que se manifiesta como "actividad pensante" en su esencia; el artista, libre y autónomo, crea un mundo que se identifica consigo mismo. El arte es moralidad que aporta serenidad quietud, catarsis purificadora de las pasiones. El momento de la Religión (antítesis) constituye la expresión objetiva del proceso dialéctico del Espíritu que, alejado de sí mismo, contempla a Dios como Objeto Absoluto. Finalmente la Filosofía constituye la síntesis del momento del Arte y del momento de la Religión: momento culminante del Espíritu que se realiza a sí mismo por el pensamiento y de tal modo afirma su identidad y unidad, sin pasado o futuro porque en sí mismo contiene todo el pasado y todo el futuro. La filosofía constituye entonces la conceptualización de la realidad, siendo que toda la realidad es pensamiento en acto. En ese sentido la historia es concebida siempre como historia contemporánea porque los hechos trascurridos están presentes en nosotros como hechos actuales; de aquí la definición de la filosofía de Giovanni Gentile como actualismo o idealismo actualista". La catolicidad controvertida del filósofo Gentile La reflexión filosófica de Giovanni Gentile - según comenta José Ferrater Mora - "es un pensar que trasciende toda mera subjetividad: es pensar trascendental y no sujeto que conoce, y meno aún sujeto psicológico". De este modo el actualismo gentiliano mediante el predominio del acto puro y absolutamente actual busca de resolver las contradicciones que plantea el pensamiento mismo (1). Pero una contradicción, por lo meno, permanece por cuanto concierne la cuestión religiosa, como bien observó en su tiempo el filósofo italiano Giuseppe Maggiore; quien, con respeto del filósofo Gentile, escribió: "El Cristianismo, refutado en las primeras rígidas posiciones del inmanentismo absoluto, penetró gradualmente en su pensamiento con una ansiedad insaciable, como una necesitad de liberación. Él pensó y vivió como hombre justo - vir iustus - en el sentido veraz del Cristianismo, lo cual enseña que para vivir dignamente hay que saber morir"(2). Con respeto del problema religioso, las polémicas hacia Gentile y su idealismo actualista no fueron pocas. A pesar de haber confesado públicamente su adhesión a la religión católica, su posición religiosa fue considerada cuanto menos heterodoxa. Un año antes de su trágica muerte, dictando en Florencia una conferencia titulada "Mi religión" Gentile proclamó: "Repito mi profesión de fe, guste o no guste a quien me está escuchando: yo soy cristiano porque creo en la religión del espíritu. Pero, para fugar todas dudas, quiero agregar: yo soy católico". Después de haber negado que la religión pueda ser un asunto privado, como sostienen los reformadores luteranos, Gentile destacaba el carácter jerárquico y social del catolicismo del cual aceptaba hasta las formulaciones dogmáticas: "Lo que la Iglesia Católica quiere enseñar es digno de ser recogido en todos sus dogmas por parte de cada espíritu cristiano, consciente de que la revolución obrada en el pensamiento y en la vida del hombre por el Evangelio, es un descubrimiento de la vida del Espíritu". Ahondando en su concepto de la religión afirmaba, mas adelante: "El acto del espíritu nunca será puro arte, ni pura religión, porque la sola religión que se da es aquella que se celebra en la efectiva vida del espíritu, donde todo su vigor se manifiesta en la síntesis del pensamiento. Por lo tanto la religión se alimenta y cultiva en la inteligencia, fuera de la cual se disuelve y desvanece (…). La religión crece, se expande, se consolida y vive en la filosofía que elabora sin cesar el contenido inmediato de la religión y lo introduce en la vida de la historia (…). Se quiera o no, la religión tiene que atravesar el fuego del pensamiento para no quemarse las alas que la sustentan en su vuelo hacia Dios". Esta confesión pública, más que una profesión incondicional de fe católica, en palabras de Gentile resultaba la confesión de fe en un catolicismo personal, propio en la medida en la que el filósofo lograba repensar por su cuenta los conceptos de la doctrina católica; lo que constituye la modalidad propia de la filosofía actualista de vivir una doctrina: esto es, pensarla para vivirla. Comentando el asesinato del filósofo, Armando Carlini, anotó: "Gentile, el gran defensor de la inmanencia y de la historicidad del espíritu, ha vivido toda su vida en una esfera de valores trascendentales, más allá del mundo pequeño, donde los hombres hacen la historia". Por otra parte, un antiguo alumno de Gentile, Mario Casotti, después de haber superado los limites del pensamiento actualista alcanzando las riberas de la filosofía aristotélico-tomista, había destacado como el idealismo moderno, a pesar de sus errores particulares, hubiera logrado asimilarse con el realismo ideal de la filosofía clásica por medio de la concepción gentiliana del Espíritu como Acto Puro, porque - había observado oportunamente Casotti - "el Acto sin mixtura de potencialidad" (esto es: Acto Puro), desde Aristóteles en adelante es el Ser Absoluto: es decir Dios". Giovanni Gentile representa la paradoja de una sincera fe católica conviviente con una filosofía poco compatible con la ortodoxia del catolicismo; pero compatible con el catolicismo (y con el espíritu italianísimo de Pio XII°, como bien anota Piero Vassallo, filosofo italiano de corte tomista) era la idea de pacificación política y civil profesada casi proféticamente en los tiempos últimos de su existencia: El hecho que muchos entre los más destacados discípulos de Gentile (pienso sobretodo en Armando Carlini y en Michele Federico Sciacca) hayan recorrido un itinerario filosófico que alcanzó un éxito católico, hace pensar en la existencia de un filón místico en Giovanni Gentile; lo que inducía al franciscano Padre Agostino Gemelli, rector de la Universidad católica de Milán, a escribir en la Rivista di Filosofia Neoscolastica (Junio de 1944), lo siguiente: "La barbara muerte ha truncado una posible evolución ulterior del pensamiento gentiliano, que en sus últimos años se había abierto más hacia una visión del Cristianismo auténtico" El controvertido catolicismo de Giovanni Gentile fue considerado, además, por el filosofo católico Gustavo Bontadini un testimonio de aquella reductio artium ad theologíam postulada por San Buenaventura y que aflora también en la dialéctica del idealismo actualista cuando postula el pasaje desde el filosofar hacia el vivir concebido como una plena participación a la vida del Espíritu que busca Dios - el Dios Uno y Trino - y se deleita en Él. Se trata de un ansia especulativa en la que se asoma el alma del creyente atraído por su voz interior y que anhela el privilegio de la sublime fulguración divina, perseguida durante toda una vida a lo largo de un interminable camino hacia Damasco, para alcanzar la luz de la revelación cristiana. Y por esa ansia fervorosa que acompañó a Giovanni Gentile en toda su vida, me atrevo a pensar que el bautismo cristiano en las aguas, recibido por él al nacer por elección de sus padres católicos, tuvo su misteriosa y providencial confirmación en el bautismo de la sangre al morir. El humanismo para los nuevos tiempos En su obra Reforma della scuola in Italia (1932), Giovannji Gentile afirma: "El cuerpo humano es a base de toda nuestra actividad espiritual porque el hombre es el único ser viviente capaz de desarrollar el acto puro de pensar". En el pensamiento reside entonces la misma realidad existencial del hombre, según la filosofía gentiliana interpretada sucesivamente como una expresión de un existencialismo positivo por Vito A.Bellezza y como un peculiar espiritualismo personalista por Francesco La Scala. Coherente con esta arquitectura especulativa, en su último ensayo de filosofía practica escribió: "La política es una actividad inmanente el espíritu human. Por lo tanto quien, sinceramente y conociendo el significado de la palabra, se propusiera de apartarse de toda política, debería renunciar a vivir". Pero la política debe nutrirse de una profunda moralidad, porque Gentile concibe la actividad política como expresión de una voluntad moral que obra en el hombre concebido como "Unidad dinámica de esencia y existencia, de cuerpo y alma, de sentimientos y pensamientos"; individuo que por ser personalidad humana dotada de experiencia concreta y de existencia histórica y social, es además voluntad universal que sustenta el reino del espíritu. Por consiguiente, la Sociedad y el Estado, según Gentile, no se manifiestan Inter homines sino In interiore homine. Para el filósofo del actualismo, en el individuo concreto se manifiesta la autoconciencia que resume en sí misma el espacio, el tiempo y la naturaleza. Por consiguiente en el individuo coincide la comunidad universal al interior de la cual el yo convive siempre con un alter, un socius que hace del yo un nosotros: términos inseparables y que borran todas diferencias entre ellos, porque yo y nosotros - afirma Gentile - somos unos mismos dentro del Sujeto Único y Absoluto que forma la sociedad ideal definida como Sociedad trascendental: síntesis espiritual de todos los moldes particulares y históricos de la vida asociada. El soporte socio-político de esta sociedad trascendental - dibujada en Génesis y estructura de la Sociedad - es el humanismo del trabajo definido como el humanismo de los nuevos tiempos que, después del humanismo literario y filosófico, se abre para abarcar toda forma de actividad del hombre, permitiendo que se le reconozca al trabajador la misma alta dignidad reconocida que el hombre intelectual había descubierto en el pensamiento: cumbre de su voluntad y libertad. "El ciudadano - escribió Gentile con un cautivante lirismo - no es el hombre abstracto de la clase dominante, porque más culta o más adinerada, ni es el hombre que para saber leer o escribir domina el instrumento de una ilimitada comunicación espiritual. El hombre real es el hombre que trabaja, porque en verdad el valor está en el trabajo; y por su trabajo, diferenciado según su calidad y cantidad, el hombre vale lo que vale". Aquí radica la diferencia abismal entre el humanismo gentiliano y el utopismo marxista, que siempre ha repudiado la división del trabajo social. Gentile, además, nunca ha admitido la escisión entre el interés particular y el interés común, siendo el hombre, según él, un ser entero y concreto, éticamente concebido. Con el humanismo del trabajo, Gentile perfecciona y sella su polémica juvenil con el marxismo abierta en su años mozos (1897) con un ensayo crítico sobre el materialismo histórico donde había destacado el error central de Karl Marx: haber postulado una revisión morfológica del hecho, donde sólo el hecho relativo sería cierto de forma absoluta. De este modo -observó Gentile - Marx había expulsado el absoluto de Hegel por carecer de la relatividad, olvidando que no es posible concebir un absoluto que carezca de algo. Además - comentaba aún Gentile - el hecho no puede ser objeto de especulación filosófica, come Marx pretendía, siendo el hecho algo pertinente solo a la experiencia, y por lo tanto pertinente a la historia pura que -como muchos saben - se ocupa sólo de lo que ha acaecido y que, por consiguiente, no cabe en la filosofía de la historia. Aquí - anotaba Gentile - Marx confundió la forma con el contenido, atribuyendo al segundo las características de la primera. En esta confusión reside el gravísimo error especulativo del pensamiento marxista. En la sociedad configurada por el humanismo del trabajo, Gentile ha dibujado un proyecto socio-político, donde la libertad no debe negar la autoridad, ni la autoridad desconocer a la libertad, siendo vital la síntesis de ambos valores para que el trabajador pueda elevarse a la dignidad ética del artífice; quien - con el propósito de desmaterializar a la materia - se hace, además de faber fortunae suae, también faber sui ipsius: fautor - esto es - no solamente de su suerte sino de sí mismo, según una lección de transparente raíces agustinianas. El filósofo destacaba así la exigencia de dignificar éticamente toda actividad humana para resolver, de una vez, las seculares divergencias entre teoría (cultura) y praxis (producción), capita y trabajo, capitalistas y proletarios, sociedad y Estado versus individuo. Aquí la filosofía de Gentile que, en sus inicio, se desarrolló centrándose principalmente entorno a la noción del acto puro, se concluye haciendo del hombre - protagonista del pensamiento pensante - el eje central de su arquitectura especulativa ; y desde esa audaz postura, él había osado declarar en el discurso del Campidoglio (junio de 1943) - anticipando su teoría sobre el humanismo del trabajo - que los comunistas de entonces no se daban cuentas de ser simplemente unos "corporativistas impacientes". ¡Ahora bien! Aquella atrevida afirmación - a la luz de los acontecimientos del último decenio del siglo veinte - resulta una profecía igualmente audaz y acertadamente inactual porque proyectada hacia un futuro cercano, en tiempos en los cuales una fiebre libremercadista, después del derrumbe catastrófico del marxismo leninismo está reemplazando a la utopía comunista en un mundo inquieto que anhela aún a una mayor justicia moral y social, en una sociedad del mañana sustentada en valores espirituales y afirmada en principios trascendentes y no en un pragmatismo socioeconómico satisfecho sólo por éxitos materiales. Vigencia y sentido del pensamiento gentiliano A pesar de haber redactado la parte filosófica del capítulo dedicado a la voz fascismo en la Enciclopedia Italiana, en conjunto con Mussolini autor de la parte histórico-programática, Giovanni Gentile no alcanzó la ambición de ser el filósofo oficial del régimen fascista italiano porque su poder se fue políticamente debilitando desde los años treinta hasta el dramático 1943. Sin embargo, el hecho de que fuese el filósofo más destacado de la Italia fascista de entonces y su gran organizador cultural, que hubiera permanecido al lado de Mussolini por toda la vida, constituyó siempre un problema inquietante para la cultura italiana antifascista y post-fascista: por esa misma razón el recuerdo de Gentile padeció por largo tiempo injustas y sectarias exclusiones. Preguntándose porque Giovanni Gentile fue fascista, Piero Melograni ya en el lejano 1984 observaba que la opción política del filósofo era implicita en todo su itinerario intelectual. A su vez, Aldo Lo Schiavo destacaba que postulando la identidad entre ley y libertad, individuo y Estado, Gentile encontró en el fascismo mussoliniano la última forma de un nulo concepto de libertad, hija del siglo diecinueve: Esta sería la razón por la cual el mismo Gentile consideraba la necesitad de la crítica y de la oposición como una necesitad dialéctica imprescindible también en el fascismo, que por lo tanto aparecía al filósofo no una ideología o un sistema cerrado, sino más bien un proceso histórico y un proyecto ideal en perpetuo desarrollo (3). Aquí cabría - más allá de la misma generosidad, que fue un dato peculiar de su persona - también la explicación intelectual de la actitud comprensiva y tolerante hacia sus adversarios políticos; sobre todo hacia destacados intelectuales israelitas víctimas - como él mismo confesó - de "una infeliz fatalidad política". Estas generosas actitudes personales todavía no absolvieron a Gentile del delito de haber sido un fascista; delito considerado imperdonable por parte de un sectarismo prepotente que arrinconó en poco reductos académicos la obra filosófica de Gentile, a lo largo de más de medio siglo, llegando al extremo de negar en la Escuela Normal Superior de Pisa el recuerdo de veinte años de intenso y proficuo magisterio gentiliano. Pero la paciencia de la historia ha ido despejando, de a poco, las nieblas envenenadas por las sectas ideológicas, permitiendo que se asomara paulatinamente la deuda conceptual que la cultura italiana y europea tiene con Giovanni Gentile. Desde 1994, cuando bajo el alero de una administración municipal de centro-izquierda, se celebró en el Campidoglio de Roma un congreso sobre el pensamiento del filósofo asesinado, la herencia de Gentile afloró como un patrimonio conceptual nada fácil, pero todavía vigoroso y merecedor por lo tanto de ser revisado por el sentido de conciencia crítica que empuja al hombre intelectual hacia la búsqueda de la verdad sub specie aeternitatis. Ilustres filósofos, incluidos varios de ellos discrepantes con las posturas del idealismo actualista, reconocieron en aquel congreso la vigencia de distintos aspectos del pensamiento gentiliano, destacando entre otros el concepto de organicidad: condición implícita en el pluralismo de las instituciones y en las articulaciones de los cuerpos intermedios, porque Gentile ha enseñado que en el pluralismo se hace efectiva la interrelación de los elementos heterogéneos con los elementos homogéneos, todos ellos asumidos en el acto del pensar. Se consideró vigente además el concepto de identidad como propuesta de conciliación dialéctica entre revolución y conservación, autoridad y libertad, libertad y deber, individuo y comunidad, Sociedad y Estado; y vigente resultó sobre todo la concepción moral de la sociedad política nutrida de valores ético-religiosos y que otorgan a la política el carácter peculiar de teología civil. Finalmente se destacó la permanente vigencia de la humanidad del hombre generoso que fue Giovanni Gentile, humanidad manifestada concretamente hacia los adversarios, y que a un paso de la muerte enfrentada socráticamente grabó el epitafio de su vida con esta palabras de bronce:"La fuerza del espíritu que está en todos nosotros, paulatinamente supera las divergencias, transforma las luchas en sendero de paz; y desde el odio - antes o después - brota el Amor". Recordando este impresionante testimonio, el gentiliano Fortunato Aloi ha justamente definido a Giovanni Gentile un "filósofo sin barreras (4); quien al franquear las barreras de la vida terrenal, victimado como Sócrates por cobarde furor humano, nos dejó in extremis la más honda lección moral. Una lección, frente a cual se inclina reverente también quien - como el suscrito - no asume la especulación filosófica del idealismo actualista pero reconoce en ella un profundo magisterio postfilosófico que concibe la vida como combate incesante, vocación de una milicia permanente que evoca aquella del legionario romano inmortalado por Spengler: estoicamente inmóvil, en la puerta de Pompeya, bajo la lluvia volcánica del Vesubio para no faltar a su consigna. •- •-• -••• •••-• Primo Siena Notas 1..J.FERRATER MORA, Diccionario de F filosofía. Tomo II° (E-J)"Gentile, Giovanni". Ed.Arial, Barcelona 1994, pp. 1453-55. 2..G. MAGGIORE, La filosofia del Diritto in G.Gentile (en G. Gentile, la vita e il pensiero) Ed. Sansoni, Firenze 1948, p. 244. 3..A. LO SCHIAVO, Introduzione a Gentile. Ed. Laterza, Bari 1974. 4..F.ALOI, Attualitá di Gentile. Ed Diaco, Bovalino 1992.
|
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, italie, fascisme, actualisme, années 20, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, histoire, politique, théorie politique, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 octobre 2009
Fascism and the Meaning of Life
Fascism and the Meaning of Life

Review: MODERNISM AND FASCISM: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. Roger Griffin (Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007)
Roger Griffin, Professor in Modern History at Oxford Brookes University, first introduced the idea of 'Palingenesis' to the field of fascist studies over 15 years ago, making him immediately a leading figure in his chosen vocation. He isolated the syncretic fascist core as being palingenetic, populist ultra-nationalism, with overtones of a phoenix-like heroic rebirth. Since then he has extended and elaborated his theory that essential to the definition of the 'fascist minimum' is the notion of national rebirth or renaissance - “myths that generated policies and actions designed to bring about collective redemption, a new national community, a new society, a new man...engineered through the power of the modern state.” - culminating in this masterwork which rightly places fascism at the centre of wider modernist movements.
Epiphanic versus Programmatic Modernism
Griffin's insights have previously been recognized as audacious and perceptive, no more so than here. Part One of the book tackles the at first seemingly tricky concept of Modernism itself, which Griffin clarifies brilliantly. Modernism's “common denominator lies in the bid to achieve a sense of transcendent value, meaning of purpose despite Western culture's progressive loss of a homogeneous value system and overarching cosmology (nomos) caused by the secularizing and disembedding forces of modernization.” Modernization is experienced by those caught up in its slipstream as a relentless juggernaut unzipping the fabric of meaningful existence and leaving in its wake the abyss of permanently unresolved ambivalence. In short, Modernism is defined as a reaction against the decadent* nihilism of intellectual, societal and technical modernization. While Marx, other Leftists and liberals consider modern man's condition as one of angst and alienation induced by class warfare and industrial production, the Right sees anomie as both the cause and the principle symptom of our modern malaise. “It is the black hole of existential self-awareness in all of us, our fear of 'the eternal silence of infinite spaces' that so alarmed [Blaise] Pascal, which produces culture”. This modern culture is further divided by Griffin into what might be called introvert and extrovert reactions: the introvert reaction is generally individualistic and in Griffin's expression an 'epiphanic modernism' – the path of the artist – while the extrovert, collective reaction is defined as 'programmatic modernism'. The latter seeks to change the world and resolve the permanent crisis of modernity (“all that is solid melts into air” - Marx) by a collective act of 'reconnection forwards' (Moeller van den Bruck). It is not difficult to make the short step from 'programmatic modernism' to fascism; the transcendent politics proposed by van den Bruck at the beginning of the Twentieth Century are not so different from Guillaume Faye's 'Archaic Futurism' at its end. Both are, in the phrase of Guy Debord, “technically equipped archaism”.
Amongst the epiphanic modernists Griffin includes Nietzsche, Eliot, Joyce, Proust, van Gogh, Kandinsky and Malevich, but perhaps the truth of Griffin's argument is demonstrated by the man widely-acknowledged as the greatest modern painter: Picasso. In his earlier cubist works, Picasso sought inspiration from the primitivism of African masks, and later in the archetypal Mediterranean symbols of horses and particularly bulls (which surprisingly Griffin doesn't mention).
Gardening State
Following the exhaustive and enlightening dissection of modernism in Part One, Griffin explores the implications and applied politics in Part Two, where “modernity turbocharged by the conjuncture of the First World War, the Russian Revolution, the collapse of three absolutist regimes and a powerful monarchy, with an influenza epidemic that killed as many as 100 million people world wide had made the modernist drive to ward off the terror of the void – cultural, social and political – a phenomenon of mass culture. The new era would be a creatio ex profundis, an act of creativity defying the void.” Fascism aimed for a complete overhaul, in accordance with Emilio Gentile's observation of totalitarianism as “an experiment in political domination undertaken by a revolutionary movement.” Griffin introduces the idea of the pre-War Fascist and National Socialist regimes as 'gardening states' striking a successful balance between idyllic ruralism and technocratic modernism, the “compelling new imperative” that it obeyed “to clean up, to sterilize, to re-order, to eliminate dirt and dust” (Frances Saunders). Or neatly, if flippantly, summed up by Lars Lindholm, “For example, the Aryans (i.e. Germans, the blond and blue-eyed) are direct descendants from the Atlantean root-race, whereas the Jews, Negroes, Slavs, and anyone else for that matter, are unfortunate mutants, further away from Homo sapiens than the snottiest gorilla. The reason for all the troubles in this world is the presence of these unsavoury species that the master race should mercifully do away with so that peace and quiet could be restored and life imbued with a bit of style.” PILGRIMS OF THE NIGHT: Pathfinders of the Magical Way (Llewellyn, St. Paul MN, 1993). It was this same vision of hygienic modernity which inspired the building in London of bright new health centres in Peckham and Finsbury during the 1930s. But mild English pragmatism was no match for German determination, where public buildings were “an act of sacralization symbolized in the toned bodies of Aryan workers showering in the washrooms of newly built hygienic factories or playing football on a KdF sportsground, their camaraderie and zest for life expressing the hope for a young, healthy nation.”
Fascist aesthetics
Included in the book are illustrations of art and architecture not usually associated with the pre-War Fascist and National Socialist regimes: from the soaring arch designed by Adalberto Libera for the aborted EUR '42 exhibition in Rome (later ripped-off by Eero Saarinen for the St. Louis Gateway Arch), to the cool steel and glass structure designed by Morpugo encasing the Ara Pacis of Augustus, the 1933 blueprint for the new Reichsbank in Berlin by Gropius, or Baron Julius Evola's painterly experimentations with Dadaism. Goebbels is revealed as a fan of Edvard Munch and Fritz Lang, while Le Corbusier submitted plans for the new town of Pontinia in the recently-reclaimed Pontine Marshes. Fritz Todt celebrated Aryan technocratic power in his construction of autobahns and later the Atlantic Wall. Irene Guenther is quoted extolling 'Nazi Chic' with fashion displaying “another countenance, one that was intensely modern, technologically advanced, supremely stylized and fashionably stylish” and the Bauhaus influence on the new, burgeoning market in consumer durables is emphasised. Unlike previous historians of fascism with their simplistic and inflexible frameworks, Griffin admirably demonstrates that “fascism, despite the connotations of regression, reaction and flight from modernity it retains for some academics, is to be regarded as an outstanding form of political modernism”, encapsulating a “deadly serious attempt to realize an alternative logic, an alternative modernity and an alternative morality to those pursued by liberalism, socialism or conservatism”.
Ambition
Griffin is well aware of the boldness and ambition of his arguments. “Post-modern” academia is notoriously hostile to transdisciplinarity and historians today are loath to erect grand structures of interpretation and meaning. Few historians are less fashionable than Oswald Spengler, or even Samuel 'Clash of Civilizations' Huntington. Griffin is well aware of this problem, and in the introduction he specifically places MODERNISM AND FASCISM within the context of 'Aufbruch' (a breaking out of conventions). For this reason Griffin's style is reflexive: he is conscious of the fact that in proposing a new syncretic historical worldview he is in some ways mirroring the dynamics of fascism itself. Of course, European Identitarians and New Rightists will have no problem with the concept of evolutionary synthesis (it's no accident that one of the principal English-language New Right websites is called Synthesis), nevertheless Griffin is correctly keen to show and stress that his work is non-totalizing. Overall his style is extremely lucid and arguments that may appear at first to be mere flights of fancy are revealed as having firm foundations, unlike the convoluted, almost impenetrable and until recently-fashionable critical theory style of, say, Andrew Hewitt's POLITICAL INVERSIONS: Homosexuality, Fascism and the Modernist Imaginary (1996) or the late Lacoue-Labarthe's HEIDEGGER, ART AND POLITICS (1990).
The sky is falling on our heads
At the end of his book, Griffin draws attention to a BBC News report from September 1998. “The sky is falling” it announces dramatically (shades of Asterix and Obelix here) “The height of the sky has dropped by 8km in the last 38 years, according to scientists from the British Antarctic Survey. Greenhouse gasses like carbon dioxide are believed to be responsible for creating the effect.” He goes on to speculate, “Had Nietzsche been philosophizing at the beginning of the twenty-first century instead of the end of the nineteenth, amidst Swiss glaciers shrivelling under skies where the abstract art of vapour trails punctures illusions of transcending Good and Evil, maybe he would have 'rethought all his ideas' in a different, greener 'framework'. Instead of railing against the advent of 'nihilism', 'decadence' and 'the last man', he might have realized that the time for any sort of 'eternal return' is rapidly running out in a literal, not symbolic sense.” In the intervening 9 years since that ominous BBC report, our carbon emissions have escalated tremendously while our climate has deteriorated further, thanks to global capitalism, free market economics, liberalism, population increase, mass migration across borders and above all the profound weakness and myopia in confronting the issue which is inherent to liberal democracies. We need to get a grip.
*not the frivolous, glamourized Sally Bowles Weimar “decadence” that the word conjures up in the minds of many gay men, but rather the very real awareness of decay; that all our greatest achievements as a civilization – the Renaissance, the Age of Discovery, the Moonshots – are behind us.
00:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fascism, nouvelle droite, théorie politique, politologie, philosophie, sciences politiques, modernité, droite, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 octobre 2009
Gaps in Germany's New Right
GAPS IN GERMANY'S NEW RIGHT

REVIEW: GERMANY'S NEW RIGHT AS CULTURE AND POLITICS. Roger Woods (Palgrave, Basingstoke 2007)
In this clear and workmanlike report and assessment of the New Right in Germany, Roger Woods first of all examines the cultural background, then goes on to explore the problematic Conservative Revolutionary and National Socialist legacy, New Right values and programmes, before reaching a somewhat downbeat conclusion. “The New Right project of providing itself with a cultural dimension as a solid foundation for new political thinking has not gone according to plan” says Woods, early-on.
Woods outlines three phases of New Right development in Germany since 1968; firstly as a meta-political movement taking its lead from the French New Right interpretation of Gramsci and culture combined with 1970s ideology, then the period 1982-1989 when the New Right served as a right wing corrective to right wing German Federal and Land governments and also in the historians dispute, and finally from 1989, after the collapse of socialism, when issues of national identity came to the fore.
The most interesting parts of the book deal with the ambiguous inheritance of Conservative Revolutionary thinkers of the Weimar Republic and the background of cultural pessimism. Woods emphasizes the uncertainty many German New Right thinkers betray despite promoting traditional values such as the Church, Family, Nation/ State. The cultural pessimist insight is that all these ideas have been tried, and failed, and that modernity in all its aspects is irreversible. With the current ecological crisis of climate change and industrial pollution, as Botho Strauss points out, not even nature can be relied upon. The quest for institutions that can embody transcendental values is abandoned. It is this feeling of resignation that allows German New Right thinkers like Martin Schwarz to contemplate compromise with Islam: “In a speech to the right wing organization Synergon Deutschland Martin Schwarz declares that if Europeans were to adopt the principles of Islam their nations would flourish”. “We live in a time of chaos and disintegration. If we wish to survive we must not convince ourselves that our main aim is to confront those people who are being uprooted and tossed around as the old order disintegrates...There is no Islamic conspiracy to bring down the West!” - Martin Schwarz.
Opposed to this defeatism are a minority including Pierre Krebs of Thule Seminar: “In the land of Nietzsche and Wagner, Bach and Kant, Clausewitz and Thomas Münzer a single word could fan the red glow of history back to life, smash to pieces half a century of dictatorial 'reeducation' that thought it could displace this word from the mind of a whole people without encountering any resistance”.
From an English perspective, this cultural pessimism may seem a result of over-intellectualizing and the particular, awkward memory for Germans of the NSDAP. If, as it is commonly held, Europe is a Symphony of Nations, then we have already heard the majesty of Mussolini and the sombre, expressionist tones of German National Socialism; yet England, the Celtic lands, Scandinavia, central Europe and Russia have so far remained silent. Let Russia sing and England and France take up the reprise! (Britain's particular excuse for European dis-engagement has been its global empire, its invention of the modern world, and currently its maintenance through force, financial power and flim-flam of that same decaying world).
Unfortunately, there is a significant oversight of which this book is guilty. I would argue that the major fault with the German New Right, and Woods account of it, is a lack of awareness of our true, shared pre-Christian Aryan heritage. As for Christianity, there seems little point in falling back on the tradition of a religion if that religion is wrong; and not only wrong, but destructive. German religious traditionalists are still mainly Christian, thereby continuing the Semitic monotheist intrusion into Aryan spirituality. How can Germans “return” to a faith that caused them so much physical and mental harm, from encouraging Charlemagne to slaughter thousands of pagan Saxons in order to force conversion, or that wasted Germany for generations after the carnage of the Thirty Years War?
Neither Roger Woods nor the examples he cites have much time for the insights of European paganism and the apparent pre-Christian Aryan ideology uncovered by Indo-Europeanists like Georges Dumezil and Alby Stone. European pagan metaphysics in conjunction with the ideas of Western philosophers such as Nietzsche and Heidegger and the political outlook of Evola and Yockey can provide meaning, to resist the onslaught of nihilist modernism and the doubts and uncertainties expressed by New Right thinkers in Germany. This is where the German New Right, and the New Right across Europe, will find the “fixed points”, the traditions, the models for a functioning society, and the new elan – the new spirit of adventure, hope, and destiny – for which the German New Right, and many Europeans more generally, have been searching.
This new spirit must originate from and embody the European Faustean sensibility; it must embrace synthesis, science and technology: “The fascist is obsessed with an ideal of Modernity and youth: he wants to create a new man, a lover of sport and autosport, living in a new city which has been given new life by futuristic architecture. He is an admirer of Le Cobusier, Marinetti, Gropius. He loves motors, mechanical engineering and speed.” - Zeev Sternhell, quoted on p68.
I have just two caveats for a book that is otherwise fair as far as it goes:
- for a book published in mid-2007, the references don't extend beyond Summer 2004 at the latest, as far as I can see. I don't blame the author for this; publication schedules are often delayed.
- secondly, the front cover appears to be a (totally uncredited) photograph of the Holocaust memorial in Berlin. According to the text within, “For the New Right, however, the Holocaust memorial is 'the last testament of the generation of 68'. Before they retire they want to deal Germany a blow which will shake it to its core. Junge Freiheit quotes Rudolf Augustein's view that the memorial is aimed against the newly emerging Germany in Berlin and the sovereignty that Germany had taken so long to restore”. To choose this particular image to illustrate the cover of a book on Germany's New Right is singularly inappropriate, almost a calculated insult directed at the book's readers.
00:18 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, sciences politiques, allemagne, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La critica de Carl Schmitt al Parlementarismo
La Crítica de Carl Schmitt al Parlamentarismo
Por Luis Oro Tapia
El liberalismo propicia la publicidad y transparencia de la actividad política. El demoliberalismo quiso terminar con la política de gabinete y con los secretos de Estado, pero incurrió en dos prácticas análogas: la política de camarillas y el hermetismo del trabajo en comisiones. La burguesía, en su lucha contra la monarquía absoluta, opuso a la doctrina de la razón de estado y de los arcana imperii el ideal de la transparencia y de la publicidad de los actos de gobierno. Una de las finalidades originarias del parlamento era transparentar, mediante la antorcha de la razón pública y de la libre discusión, la manera como la autoridad gubernamental toma sus resoluciones.
Tal motivación tenía por meta superar la política secreta de los príncipes y de los consejos de gabinete. Este nuevo ideal concebía la política de gabinete, ejecutada por unas cuantas personas a puertas cerradas, como algo en sí mismo malvado y, por tanto, la publicidad de la vida política, por el mero hecho de ser tal, como algo bueno y saludable.
Sin embargo, la aspiración de transparencia y publicidad que pregonaba el liberalismo pronto devino en prácticas que negaban dicha expectativa. En efecto, en la Era Liberal las cada vez más pequeñas comisiones de partidos, o de coaliciones de partidos, deciden a puertas cerradas sobre aquello que afecta diariamente la vida de los ciudadanos. Más aún, los parlamentarios no deciden de manera autónoma, sino que deciden como representantes de los intereses del gran capital. Y estos últimos, a su vez, toman sus decisiones en un comité más limitado que afecta, quizás de manera mucho más significativa, la vida cotidiana de millones de personas. De hecho, las decisiones políticas y económicas, de las cuales depende el destino de las personas, no son (si es que alguna vez lo han sido) ni el fiel reflejo de la sensibilidad de la ciudadanía ni del debate público que en torno a ellas se pueda suscitar. Si la política de camarillas y el hermetismo del trabajo en comisiones se han convertido en la negación del discurso normativo liberal, que propiciaba la publicidad y la discusión, es natural que “la fe en la discusión pública tenía que experimentar una terrible desilusión”. En efecto, el funcionamiento del sistema demoliberal de gobierno ha resultado ser un fiasco, porque la evolución de la moderna democracia de masas ha convertido el eslogan de la discusión pública en una mera formalidad vacía.
Por cierto, la verdadera actividad política no se desarrolla en los debates públicos del pleno, puesto que las decisiones realmente importantes han sido tomadas previamente en las comisiones o “en reuniones secretas de los jefes de los grupos parlamentarios e, incluso, en comisiones no parlamentarias. Así, se origina la derivación y supresión de todas las responsabilidades, con lo que el sistema parlamentario resulta ser, al fin, sólo una mala fachada del dominio de los partidos y de los intereses económicos”.
Para Schmitt el Estado demoliberal es incapaz de actuar como unidad de decisión y de acción frente a situaciones límites. El liberalismo frente a un dilema que impele a tomar una determinación rápida queda atónito y elude tomar pronta y resueltamente un curso de acción a seguir. Así, por ejemplo, frente a la pregunta perentoria: “¿a quién queréis, a Barrabás o a Jesús?”, la urgencia de la respuesta queda aplazada con el nombramiento de una comisión parlamentaria investigadora que finalmente elude dar una respuesta concluyente. Para Schmitt, la esencia del liberalismo radica en la negociación y la indecisión permanente, puesto que tiene la expectativa de que en el debate parlamentario el problema se diluya, suspendiéndose así indefinidamente la resolución mediante la discusión eterna.
En el parlamentarismo, el pueblo como unidad orgánica, vale decir como totalidad, no está representado en el parlamento; por consiguiente, el régimen parlamentario no es democrático. Entonces, ¿a quiénes representan los parlamentarios? La respuesta teórica es a la nación, a la comunidad, a un todo orgánico. Sin embargo, en la práctica no es así, porque los parlamentarios representan a partidos políticos, tras los cuales están determinados intereses, y ellos están más preocupados de aumentar o de preservar sus cuotas de poder, que les permiten proteger sus respectivos intereses, que de velar por el bienestar del todo orgánico. Los partidos se relacionan entre sí “como poderosos grupos de poder social y económico, calculando los mutuos intereses y sus posibilidades de alcanzar el poder y llevando a cabo desde esta base fáctica compromisos y coaliciones”.
Schmitt afirma que en el parlamento no hay discusión, pero sí negociación y ajuste de intereses entre los partidos que tienen representación parlamentaria. Por tal motivo, Schmitt sostiene que afirmar que los parlamentarios alientan una genuina discusión pública sería faltar a la verdad. La brecha entre el ideal y la realidad es ostensible; en efecto, las relaciones entre los parlamentarios distan mucho del modelo de discusión pública que proponía Bentham. Este teórico del liberalismo sostenía que en el parlamento se encuentran las ideas y el contacto entre ellas hace saltar las chispas de la evidencia. Pero, en la práctica, no hay discusión razonada ni debate público, sino negociaciones de antesala en la que los partidos tienen por principal preocupación la defensa de sus intereses sectoriales y el cálculo estratégico de sus oportunidades para incrementar o conservar sus cuotas de poder.
Entonces, el debate público resulta ser una quimera. En efecto, en vez de prosperar una discusión en la que prevalece la argumentación racional, irrumpe la propaganda que tiene por objetivo seducir la emotividad del electorado. Así, la discusión pública primero es sustituida por la excitación de la sensibilidad e inmediatamente después por la movilización de las pasiones, lo cual se logra a través de afiches, carteles, consignas y otros medios que tienen por finalidad sugestionar a las masas.
¿Por qué el parlamentarismo está en crisis? Dicho en nuestro lenguaje: ¿Por qué la democracia liberal está en crisis? ¿Qué explica el desafecto que existe por ella? La democracia liberal como institución ha perdido sus raíces ciudadanas, manteniéndose sólo como un dispositivo formal vacío, como un organismo carente de un pathos, que funciona más por inercia y por falta de una mejor opción que por convicción. El languidecimiento del pathos del parlamentarismo ha debilitado la identidad existente entre representantes y representados; por consiguiente, el sistema demoliberal deviene, paradojalmente, en un régimen no democrático; concebida la democracia como la entiende Schmitt. ¿Qué es la democracia para Schmitt? Es, simplemente, la identidad que existe entre gobernantes y gobernados; entre la nación y el Estado; entre los seguidores y el líder; entre electores y elegidos, etc.
En las sociedades que poseen regímenes políticos demoliberales el afán de dar satisfacción a los intereses individuales y sectoriales en desmedro de la comunidad ha erosionado la moral pública. Tanto es así que en algunos Estados demoliberales “todos los asuntos públicos se han convertido en objeto de botines y compromisos entre los partidos y sus seguidores y la política, lejos de ser el cometido de una elite [de servidores públicos], ha llegado a ser el negocio, por lo general despreciado, de una, por lo general despreciada, clase”, concluye Schmitt.
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, parlementarisme, démocratie, partitocratie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, sociologie, révolution conservatrice, weimar, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook